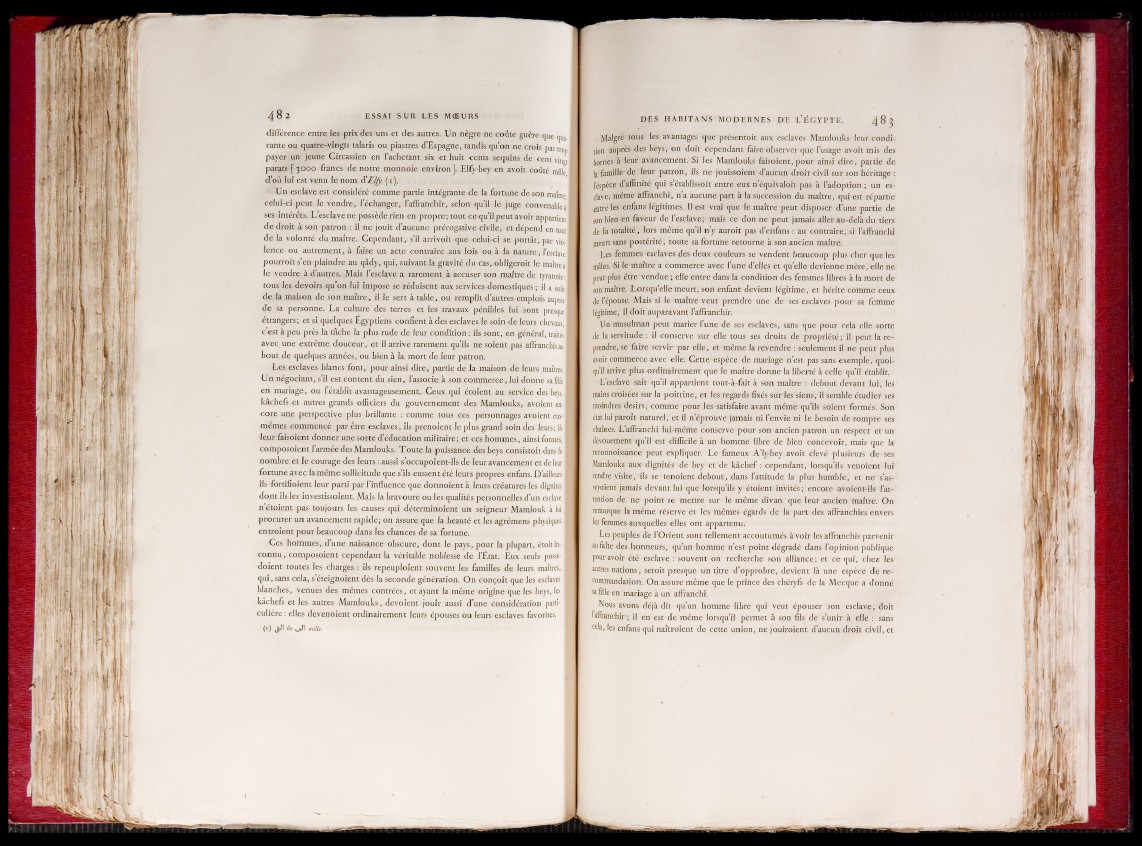
différence entre les prix des uns et des autres. Un nègre ne coûte guère que q^ I
rante ou quatre-vingts talaris ou piastres d’Espagne, tandis qu’on ne croit pas tro I
payer un jeune Circassien en l’achetant six et huit cents sequins de cent vingt!
parats [3000 francs de notre monnoie environ]. Elfy-bey en avoit coûté mille |
d’où lui est venu le nom d'Eljÿ ( 1 ).
Un esclave est considéré comme partie intégrante de la fortune de son maître' I
celui-ci peut le vendre, l’échanger, l’affranchir, selon qu’il le juge convenable à I
ses intérêts. L ’esclave ne possède rien en propre; tout ce qu’il peut avoir appartient I
de droit à son patron : il ne jouit d’aucune prérogative civile, et dépend en tout I
de la volonté du maître. Cependant, s’il arrivoit que celui-ci se portât, par vio-1
Jence ou autrement, à faire un acte contraire aux lois ou à la nature, l’esclaveI
pourroit s’en plaindre au qâdy, qui, suivant la gravité du cas, obligeroit le maître à I
le vendre à d’autres. Mais l’esclave a rarement à accuser son maître de tyrannie I
tous les devoirs qu’on lui impose se réduisent aux services domestiques ; il a soinl
de la maison de son maître, il le sert à table, ou remplit d’autres emplois auprès I
de sa personne. L a culture des terres et les travaux pénibles lui sont presque!
étrangers; et si quelques Egyptiens confient à des esclaves le soin de leurs chevaux I
c est à peu près la tâche la plus rude de leur condition : ils sont, en général, traités|
avec une extrême douceur, et il arrive rarement qu’ils ne soient pas affranchis au I
bout de quelques années, ou bien à la mort de leur patron.
Les esclaves blancs font, pour ainsi dire, partie de la maison de leurs maîtres. I
U n négociant, s’il est content du sien, l’associe à son commerce, lui donne sa fille I
en mariage, ou l’établit avantageusement. Ceux qui étoient au service des beys, I
kachefs et autres grands officiers du gouvernement des Mamlouks, avoient encore
une perspective plus brillante : comme tous ces personnages avoient eux-1
•mêmes commencé par être esclaves, ils prenoient le plus grand soin des leurs; ils I
leur fkisoient donner une sorte d’éducation militaire ; et ces hommes, ainsi formés, I
composoient l’armée des Mamlouks. T ou te la puissance des beys consistoit dans le I
nombre et le courage des leurs : aussi s’occupoient-ils de leur avancement et de leur I
fortune avec la même sollicitude que s’ils eussent été leurs propres enfans. D ’ailleurs ■
ils fortifioient leur parti par l’influence que donnoient à leurs créatures les dignités I
dont ils les investissoient. Mais la bravoure ou les qualités personnelles d’un esclave I
n’étoient pas toujours les causes qui déterminoient un seigneur Mamlouk à lui I
procurer un avancement rapide; on assure que la beauté et les agrémens physiques I
entroient pour beaucoup dans les chances de sa fortune.
C e s hommes, d’une naissance obscure, dont le pays, pour la plupart, étoitin- I
connu , composoient cependant la véritable noblesse de l’État. Eux seuls possé- I
doient toutes les charges : ils repeuploient souvent les familles de leurs maîtres, I
qui, sans cela, s’éteignoient dès la seconde génération. O n conçoit que les esclaves ■
blanches, venues des mêmes contrées, et ayant la même origine que les beys, les I
kâchefs et les autres Mamlouks, devoient jouir aussi d’une considération parti- I
culière : elles devenoient ordinairement leurs épouses ou leurs esclaves favorites. I
(1) ¿11 de <_>JI mille.
Malgré tous les avantages que présentoit aux esclaves Mamlouks leur condition
auprès des beys, on doit cependant faire observer que l’usage avoit mis des
bornes à leur avancement. Si les Mamlouks faisoient, pour ainsi dire, partie de
la famille de leur patron, ils ne jouissôient d’aucun droit civil sur son héritage :
l’espèce d’affinité qui s’établissoit entre eux n’équivaloit pas à l’adoption ; un esclave,
même affranchi, n’a aucune part à la succession du maître, qui est répartie
entre les enfans légitimes. Il est vrai que le maître peut disposer d’une partie de
son bien en faveur de l’esclave; mais ce don ne peut jamais aller au-delà du tiers
de la totalité, lors même qu’il n’y auroit pas d’enfans : au contraire, si l’affranchi
meurt sans postérité, toute sa fortune retourne à son ancien maître.
Les femmes esclaves des deux couleurs se vendent beaucoup plus cher que les
mâles. Si le maître a commerce avec l’une d’elles et qu’elle devienne mère, elle ne
peut plus être vendue ; elle entre dans la condition des femmes libres à la mort de
son maître. Lorsqu’elle meurt, son enfant devient légitime, et hérite comme ceux
de l’épouse. Mais si le maître veut prendre une de ses esclaves pour sa femme
légitime, il doit auparavant l'affranchir.
Un musulman peut marier l’une de ses esclaves, sans que pour cela elle sorte
de la servitude : il conserve sur elle tous ses droits de propriété; il peut la reprendre,
se faire servir par elle, et même la revendre : seulement il ne peut plus
avoir commerce avec elle. Cette espèce de mariage n’est pas sans exemple, quoiqu’il
arrive plus ordinairement que le maître donne la liberté à celle qu’il établit.
L’esclave sait qu’il appartient tout-à-fait à son maître : debout devant lui, les
mains croisées sur la poitrine, et les regards fixés sur les siens, il semble étudier ses
moindres désirs, comme pour les satisfaire avant même qu’ils soient formés. Son
état lui paroît naturel, et il n’éprouve jamais ni l’envie ni le besoin de rompre ses
chaînes. L ’affranchi lui-même conserve pour son ancien patron un respect et un
dévouement qu’il est difficile à un homme libre de bien concevoir, mais que la
reconnoissance peut expliquer. L e fameux A ’iy-bey avoit élevé plusieurs de ses
Mamlouks aux dignités de bey et de kâchef : cependant, lorsqu’ils venoient lui
rendre visite, ils se tenoient debout, dans l’attitude la plus humble, et ne s’asseoient
jamais devant lui que lorsqu’ils y étoient invités ; encore avoient-ils l’attention
de ne point se mettre sur le même divan que leur ancien maître. On
remarque la même réserve et les mêmes égards de la part des affranchies envers
les femmes auxquelles elles ont appartenu.
Les peuples de l’Orient sont tellement accoutumés à voir les affranchis parvenir
au faite des honneurs, qu’un homme n’est point dégradé dans l’opinion publique
pour avoir été esclave souvent on recherche son alliance; et ce qui, chez les
autres nations, seroit presque un titre d’opprobre, devient là une espèce de recommandation.
On assure même que le prince des chéryfs de la Mecque a donné
sa fille en mariage à un affranchi.
Nous avons déjà dit qu’un homme libre qui veut épouser son esclave, doit
Iaffranchir; il en est de même lorsqu’il permet à son fils de s’unir à elle : sans
cela, les enfans qui naîtroient de cette union, ne jouiroient d’aucun droit civil, et