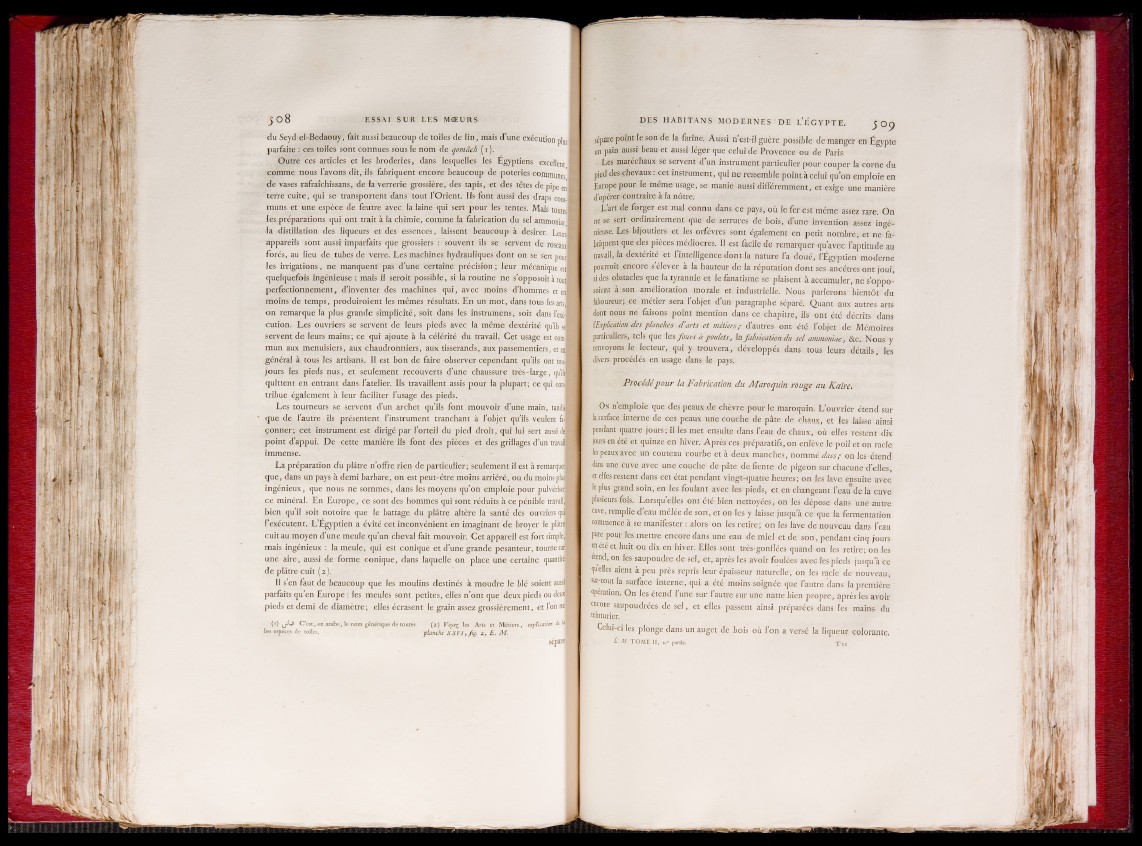
du Seyd el-Bedaouy, fait aussi beaucoup de toiles de lin, mais d’une exécution pM
parfaite : ces toiles sont connues sous le nom de qomâcli ( t ).
Outre ces articles et les broderies, dans lesquelles les Égyptiens excellent I
comme nous l’avons dit, ils fabriquent encore beaucoup de poteries communes j
de vases rafraichissans, de la verrerie grossière, des tapis, et des têtes de pipe enj
terre cuite, qui se transportent dans tout l’Orient. Us font aussi des draps com-j
muns et une espèce de feutre avec la laine qui sert pour les tentes. Mais toutes!
les préparations qui ont trait à la chimie, comme la fabrication du sel ammoniac I
la distillation des liqueurs et des essences, laissent beaucoup à desirer. LeutJ
appareils sont aussi imparfaits que grossiers : souvent ils se servent de roseauJ
forés, au lieu de tubes de verre. Les machines hydrauliques dont on se sert pouJ
les irrigations, ne manquent pas d’une certaine précision ; leur mécanique es«
quelquefois ingénieuse : mais il seroit possible, si la routine ne s’opposoit à tou«
perfectionnement, d’inventer des machines qui, avec moins d’hommes et enl
moins de temps, produiroient les mêmes résultats. En un mot, dans tous lesarlsl
on remarque la plus grande simplicité, soit dans les instrumens, soit dans l’exc]
cution. Les ouvriers se servent de leurs pieds avec la même dextérité qu’ils sa
servent de leurs mains; ce qui ajoute à la célérité du travail. C e t usage est con*
mua aux menuisiers, aux chaudronniers, aux tisserands, aux passementiers, et enl
général à tous les artisans. Il est bon de faire observer cependant qu’ils ont toiil
jours les pieds nus, et seulement recouverts d’une chaussure très-large, qu'il*
quittent en entrant dans l’atelier. Us travaillent assis pour la plupart; ce qui con*
tribue également à leur faciliter l’usage des pieds.
Les tourneurs se servent d’un archet qu’ils font mouvoir d’une main, tandi*
que de l’autre ils présentent l’instrument tranchant à l’objet qu’ils veulent fai
çonner; cet instrument est dirigé par l’orteil du pied droit, qui lui sert aussi d*
point d’appui. D e cette manière ils font des pièces et des grillages d’un travaifl
immense.
La préparation du plâtre n’offre rien de particulier; seulement il est à remarque*
que, dans un pays à demi barbare, on est peut-être moins arriéré, ou du moins plu*
ingénieux, que nous ne sommes, dans les moyens qu’on emploie pour pulvérise*
ce minéral. En Europe, ce sont des hommes qui sont réduits à ce pénible travail*
bien qu’il soit notoire que le battage du plâtre altère la santé des ouvriers qu*
l’exécutent. L ’Egyptien a évité cet inconvénient en imaginant de broyer le plâtre«
cuit au moyen d’une meule qu’un cheval fait mouvoir. C e t appareil est fort simple*
mais ingénieux : la meule, qui est conique et d’une grande pesanteur, tourne su*
une aire, aussi de forme conique, dans laquelle on place une certaine quantité*
de plâtre cuit (2).
Il s’en faut de beaucoup que les moulins destinés à moudre le blé soient aussi*
parfaits qu’en Europe : les meules sont petites, elles n’ont que deux pieds ou deuxl
pieds et demi de diamètre; elles écrasent le grain assez grossièrement, et l’on ne*
( 0 C’est, en arabe, le nom générique de toutes (2) Voyez les Arts et Métiers, explication à h
les espèces de toiles. 'planche A'XVI, Jig 2 , E. M.
sépara
s é p a r e point le son de la farine. Aussi n est-il guère possible de manger en Egypte
un pain aussi beau et aussi léger que celui de Provence ou de Paris.
Les maréchaux se servent dun instrument particulier pour couper la corne du
pied des chevaux : cet instrument, qui ne ressemble pointàcelu i qu’on emploie en
Europe pour le même usage, se manie aussi différemment, et exige une manière
d’opérer contraire à la nôtre.
L’art de forger est mal connu dans ce pays, où le fer est même assez rare. O n
ne se sert ordinairement que de serrures de bois, d’une invention assez ingénieuse.
Les bijoutiers et les orfèvres sont également en petit nombre, et ne fabriquent
que des pièces médiocres. II est facile de remarquer qu’avec l’aptitude au
travail, la dextérité et Iintelligence dont la nature la doué, 1 Égyptien moderne
pourroit encore s’élever à la hauteur de la réputation dont ses ancêtres ont joui,
si des obstacles que la tyrannie et le fanatisme se plaisent à accumuler, ne s’oppo-
soient à son amélioration morale et industrielle. Nous parlerons bientôt du
laboureur, ce metier sera 1 objet dun paragraphe séparé- Quant aux autres arts
dont nous ne faisons point mention dans ce chapitre, ils ont été décrits dans
i’Explication des planches d'arts et métiers; d’autres ont été l’objet de Mémoires
particuliers, tels que les fours a poulets, la fabricationdu sel ammoniac, &c. Nous y
renvoyons le lecteur, qui y trouvera, développés dans tous leurs détails, les
divers procédés en usage dans le pays.
Procédé p ou r Ici Fabrication du Maroquin rouge au Kaire.
On n’emploie que des peaux de chèvre pour le maroquin. L ’ouvrier étend sur
la surface interne de ces peaux une couche de pâte de chaux, et les laisse ainsi
pendant quatre jours; il les met ensuite dans l’eau de chaux, où elles restent dix
jours en été et quinze en hiver. Après ces préparatifs, on enlève le poil et on racle
| les peaux avec un couteau courbe et à deux manches, nommé dass; on les étend
dans une cuve avec une couche de pâte de fiente de pigeon sur chacune d’elles,
et elles restent dans cet état pendant vingt-quatre heures; on les lave ensuite avec
le plus grand soin, en les foulant avec les pieds, et en changeant l’eau*de la cuve
plusieurs fois. Lorsqu’elles ont été bien nettoyées, on les dépose dans une autre
cuve, remplie d eau mêlée de son, et on les y laisse jusqu’à ce que la fermentation
commence à se manifester : alors on les retire;1 on les lave de nouveau dans l’eau
pure pour les mettre encore dans une eau de miel et de son, pendant cinq jours
en été et. huit ou dix en hiver. Elles sont très-gonflées quand on les retire; on les
ctend, on les'saupoudre de sel, et, après les avoir foulées avec les pieds jusqu’à ce
quelles aient à peu près repris leur épaisseur naturelle, on les racle de nouveau,
sur-tout la surface interne, qui a été moins soignée que l’autre dans la première '
. opération. On les étend l’une sur l’autre sur une natte bien p ropre, après les avoir
encore saupoudrées de s e l, et elles passent ainsi préparées dans les mains du
teinturier.
Celui-ci les plonge dans un auget de bois où l’on a versé la liqueur colorante.
l æ i
i llj* ify ! !
m m
C M. TOME I c partie. T et
i 1 il <UV