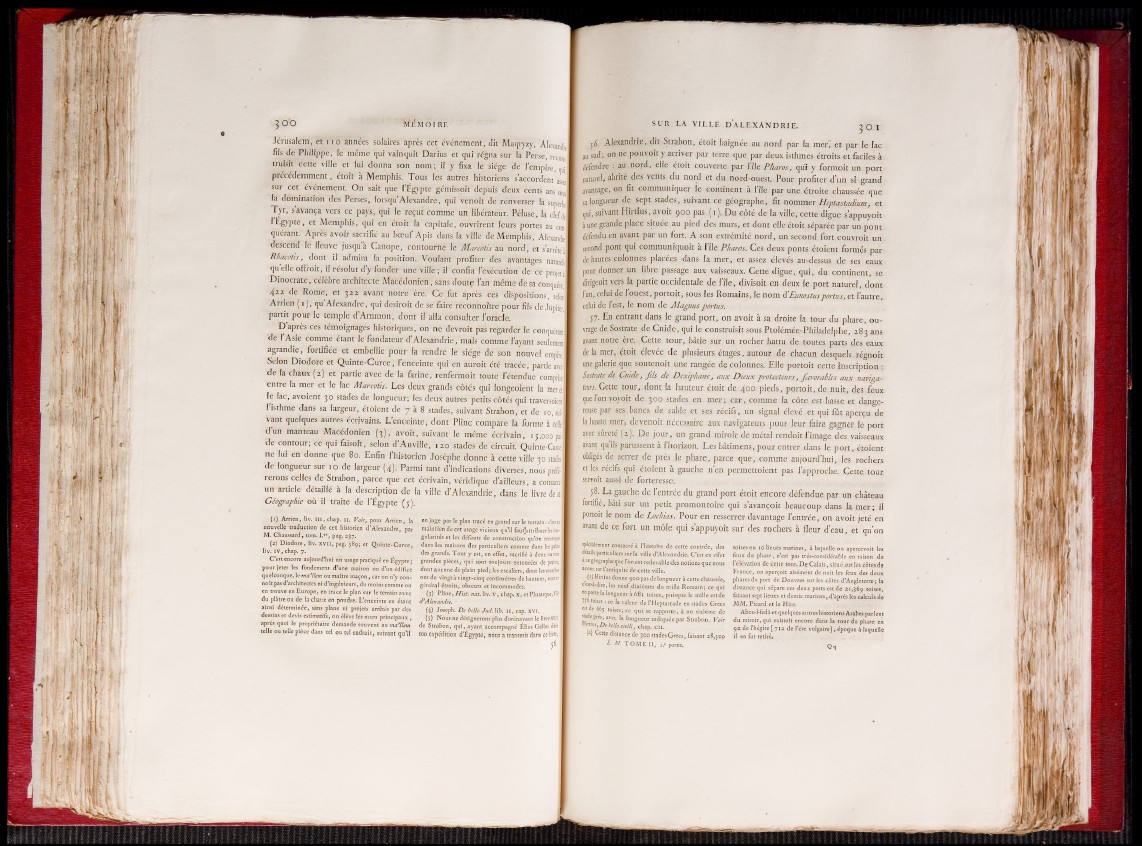
Jérusalem, et n o années solaires après cet événement, dit Maqryzy, AlexanJ,
fils de Philippe, Je même qui vainquit Darius et qui régna sur la Perse, recoj
truisit cette ville et lui donna son nom; il y fixa le siège de l’empire, J
précédemment, étoit à Memphis. Tous les autres historiens s’accordent assej
sur cet événement. On sait que l’Égypte gémissoit depuis deux cents ans soJ
la domination cíes Perses, lorsqu’Alexandre, qui venoit de renverser la superfj
T y r , s avança vers ce pays, qui le reçut comme un libérateur. Péluse, la clef êj 1 Egypte, et Memphis, qui en étoit la capitale, ouvrirent leurs portes au conf
quérant. Apres avoir sacrifié au boeuf Apis dans la ville de Memphis, Alexandre!
descend le fleuve jusqua Canope, contourne le Æarebüs au nord, et s’arrête il
Rhacotis, dont il admira la position. Voulant profiter des avantages naturels!
qu elle offroit, il résolut d’y fonder une ville ; il confia l’exécution de ce projetai
Dinocrate, célèbre architecte Macédonien, sans doute l’an même de sa conquête
de Rome, et 322 avant notre ère. Ce fut après ces dispositions, selon!
Arríen ( 1 ), qu Alexandre, qui desiroit de se faire reconnoître pour fils de Jupiter,
partit pour le temple d’Ammon, dont il alla consulter l’oracle.
D ’après ces témoignages historiques, on ne devroit pas regarder le conquérant
de 1 Asie comme étant le fondateur d Alexandrie, mais comme l’ayant seulement]
agrandie, fortifiée et embellie pour la rendre le siège de son nouvel empire
Selon Diodore et Qu inte-Curce , l’enceinte qui en auroit été tracée, partie avec]
de la chaux (2) et partie avec de la farine, renfermoit toute l’étendue comprise
entre la mer et le lac Marcotis. Les deux grands côtés qui longeoient la meretj
le lac, a voient 30 stades de longueur; les deux autres petits côtés qui traversoientj
l’isthme dans sa largeur, étoient de 7 à 8 stades, suivant Strabon, et de lo.suiJ
vant quelques autres écrivains. L ’enceinte, dont Pline compare la forme à ’celle!
dun manteau Macédonien (3), avoit, suivant le même écrivain, iy ,000 pas
de contour; ce qui fkisoft, selon d Anville, 120 stades de circuit. Quinte-Curcej
ne lui en donne que 80. Enfin l’historien Josèphe donne à cette ville 30 stades!
de longueur sur to de largeur (4). Parmi tant d’indications diverses, nous préfé-l
rerons celles de Strabon, parce que cet écrivain, véridique d’ailleurs, a consacré|
un article détaillé à la description de la ville d’Alexandrie, dans le livre desa|
Géographie où il traite de l’Égypte (y).
(1) Amen, hv. III, chap. II. Voir, pour Arrien, la en juge par le plan tracé en grand sur le terrain : c’tun
nouvelle traduction de cet historien d’Alexandre, par maintien decet nsage vicieux qu’il fautjattribuerloeim-l
M. Chaussard, tom. I. , pag. 237. gularites et les défauts de construction qu’on remarqnel
(2) Diodore, hv. X V I I , pag. 5S9; et Quinte-Curce, dans les maisons des particuliers comme dans les palais
*v' c aP* 7* _ ^ des grands. Tout y est, en effet, sacrifié à deux onaoli I C est encore aujourd’hui un usage pratiqué en Egypte; grandes pièces, qui sont toujours entourées de petiter, [
pour jeter les fondemens d’une maison ou d’un édifice dont aucune de plain pied; les escaliers, dont Ies marches I
quelconque, le ma'llem ou maître maçon, car on n’y con- ont de vingt à vingt-cinq centimètres de hauteur, sontea
noît pas d architectes ni d’ingénieurs, du moinscommeon général étroits, obscurs et incommodes,
en trouve en Europe, en trace le plan sur le terrain avec (3) Pline, Hist. nat. liv. V , chap. X, et Plutaique,R
du plâtre ou de la chaux en pondre. L’enceinte en étant d'Alexandre.
ainsi déterminée, sans plans ni projets arrêtés par des (4) Joseph. D e b e llo Jud. lib. 11, cap. XVI.
dessins et devis estimatifs, on élève les murs principaux , (5) Nous ne désignerons plus dorénavant le livre XVIII
après quoi le propriétaire demande souvent au ma'llem de Strabon, qui, ayant accompagné Élius Gallos d» |
telle ou telle piece dans tel ou tel endroit, suivant qu’il son expédition d'Égypte, nous a transmis dans ce
j 6. Alexandrie, dit Strabon, etoit baignée au nord par la mer, et par le lac
au sud; on ne pouvoit y arriver par terre que par deux isthmes étroits et faciles à
défendre : au nord, elle étoit couverte par 1 fie Pharos, qui y formoit un port
naturel, abrite des vents du nord et du nord-ouest. Pour profiter d’un si grand
avantage, on fit communiquer le continent à l’île par une étroite chaussée que
s a longueur de sept stades, suivant ce géographe, fit nommer Heptastadium, et
qui, suivant Hirtius, avoit 900 pas ( 1 ). Du côté de la ville, cette digue s’appuyoit
à une grande place située au pied des murs, et dont elle étoit séparée par un pont
défendu en avant par un fort. A son extrémité nord, un second fort couvroit un
second pont qui communiquoit à l’île Pharos. Ces deux ponts étoient formés par
de hautes colonnes placées dans la mer, et assez élevés au-dessus de ses eaux,
pour donner un libre passage aux vaisseaux. Cette digue, qui, du continent, se.
dirigeoit vers la partie occidentale de l’île , divisoit en deux le port naturel, dont
l’un, celui de l’ouest, portoit, sous les Romains, le nom à‘Eunostus portas, et l’autre,
celui de l’est, le nom de Magnus portas.
57* ÎPlIj entrant dans le grand port, on avoit a sa droite la tour du phare, ouvrage
de Sostrate de Cnide, qui le construisit sous Ptolémée-Philadelphe, 283 ans
avant notre ère. Cette tour, bâtie sur un rocher battu de toutes parts des eaux
delà mer, étoit élevée de plusieurs étages, autour de chacun desquels régnoit
une galerie que soutenoit une rangée de colonnes. Elle portoit cette inscription ;
Sostrate de Cnide, fils de Dexiphanc, aux Dieux protecteurs, favorables aux navigateurs.
Cette tour, dont la hauteur étoit de 4oo pieds, portoit, de nuit, des feux
que Ion voyoit d e -3 00 stades en mer; car, comme la côte est basse et dangereuse
par ses bancs de sable et ses récifs, un signal élevé et qui fût aperçu de
la haute mer, devenoit nécessaire aux navigateurs pour leur faire gagner le port
avec sûreté (2). De jo u r , un grand miroir de métal rendoit l’image des vaisseaux
avant quils parussent à l’horizon. Les bâtimens, pour entrer dans le port, étoient
obliges de serrer de près le phare, parce que, comme aujourd’hui, les rochers
et les récifs qui étoient à gauche n’en permettoient pas l’approche. Cette tout;
servoit aussi de forteresse.
y8. La gauche de l’entrée du grand port étoit encore défendue par un château
fortifié, bâti sur un petit promontoire qui s’avançoit beaucoup dans la mer; il
portoit le nom de Lochias. Pour en resserrer davantage l’entrée, on avoit jeté en
avant de ce fort un môle qui s’appuyoit sur des rochers à fleur d’eau, et qu’on
spécialement consacré à l’histoire de cette contrée, des
détails particuliers sur la ville d’Alexandrie. C ’est en effet
a ce géographe que l’on est redevable des notions que nous
avons sur l’antiquité de cette ville.
, (0 Hhtius donne 900 pas de longueur à cette chaussée,
cest-a-dire, les neuf dixièmes du mille Romain; ce qui
en porte la longueur à 681 toises, puisque le mille est de
7j6 toises : or la valeur de l’Heptastade en stades Grecs
est e 665 toises; ce qui se rapporte, à un sixième de
*ta e près, avec la longueur indiquée par Strabon. Voir
irtius, Debello civili, chap. c il.
(2) Cette distance de 300 stades Grecs, faisant 28,500
È- M. TOM E II, 2.c partie.
toises ou 10 lieues marines, à laquelle on apercevoit les
feux du phare, n’est pas très-considérable en raison de
l’élévation de cette tour. De Calais, situé sur les côtes de
France, on aperçoit aisément de nuit les feux des deux
phares du port de Douvres sur les côtes d’Angleterre; la
distance qui sépare ces deux ports est de 21,369 toises,
faisant sept lieues et demie marines, d’après les calculs de
MM. Picard et la Hire.
Abou-I-fedâ et quelques autres historiens Arabes parlent
du miroir, qui existoit encore dans la tour du phare en
92 de l’hégire [712 de l’ère vulgaire], époque à laquelle
il en fut retiré.
Qq