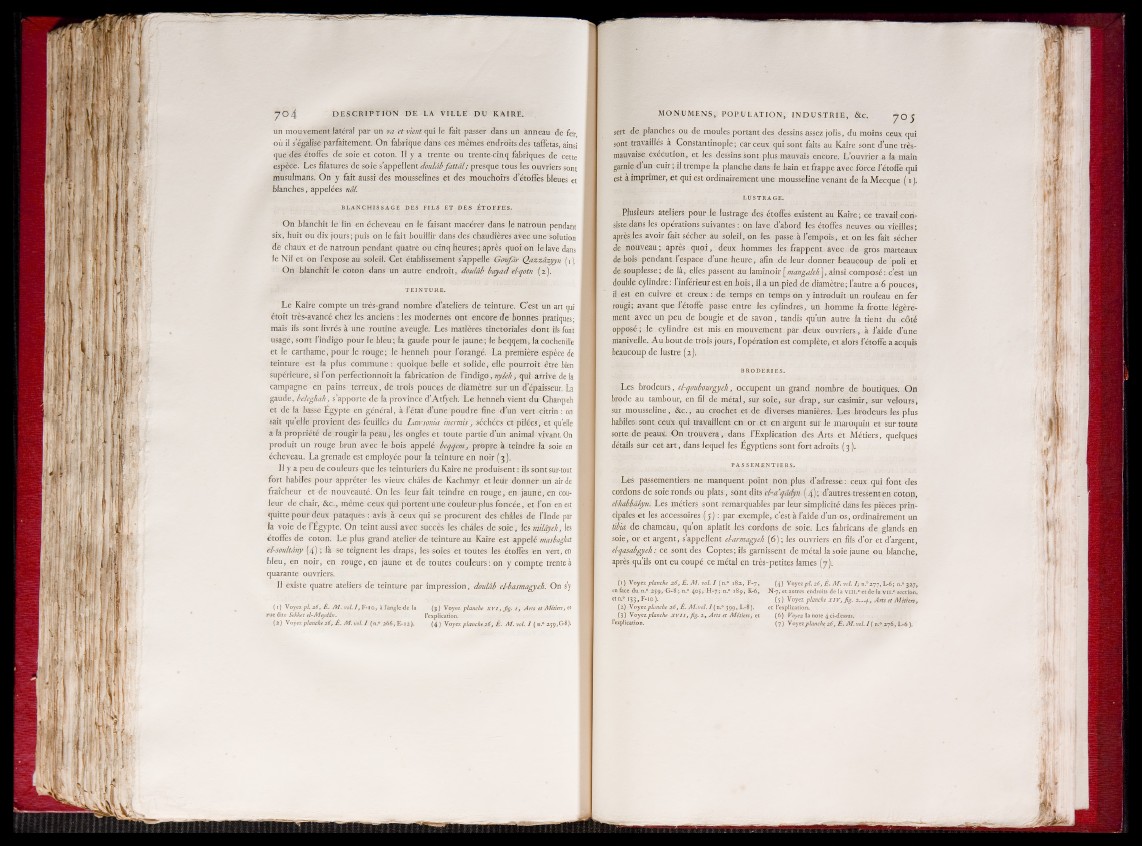
un mouvement latéral par un va et vient qui le fait passer dans un anneau de fer
où il s’égalise parfaitement. On fabrique dans ces mêmes endroits des taffetas, ainsi
que des étoffes de soie et coton. Il y a trente ou trente-cinq fabriques de cette
espèce. Les filatures de soie s’appellent doulâb fa ttâ l; presque tous les ouvriers sont
musulmans. On y fait aussi des mousselines et des mouchoirs d’étoffes bleues et
blanches, appelées nSl.
B L A N C H I S S A G E D E S F IL S E T D E S iT O F F E S .
On blanchit le lin en écheveau en le faisant macérer dans le natroun pendant
six, huit ou dix jours; puis on le fait bouillir dans des chaudières avec une solution
de chaux et de natroun pendant quatre ou cinq heures; après quoi on le lave dans
le Nil et on l’expose au soleil. Cet établissement s’appelle Goùfâr Qazzâzyyn (i).
On blanchit le coton dans un autre endroit, doulâb bayad el-qotn (2).
T E IN T U R E .
L e Kaire compte un très-grand nombre d’ateliers de teinture. C ’est un art qui
étoit très-avancé chez les anciens : les modernes ont encore de bonnes pratiques;
mais ils sont livrés à une routine aveugle. Les matières tinctoriales dont ils font
usage, sont l’indigo pour le bleu; la gaude pour le jaune ; le beqqem, la cochenille
et le carthame, pour le rouge; le henneh pour l’orangé. L a première espèce de
teinture est la plus commune : quoique belle et solide, elle pourroit être bien
supérieure, si l’on perfectionnoit la fabrication de l’indigo, nyleli, qui arrive de la
campagne en pains terreux, de trois pouces de diamètre sur un d’épaisseur. La
gaude, beleghah, s’apporte de la province d’Atfÿeh. L e henneh vient du Charqyeli
et de la basse Egypte en général, à l’état d’une poudre fine d’un vert citrin : on
sait qu’elle provient des feuilles du Lawsonia inermis, séchées et pilées, et qu’elle
a la propriété de rougir la peau, lés ongles et toute partie d’un animal vivant. On
produit un rouge brun avec le bois appelé beqqem, propre à teindre la soie en
écheveau. L a grenade est employée pour la teinture en noir (3).
Il y a peu de couleurs que les teinturiers du Kaire ne produisent : ils sontsur-tout
fort habiles pour apprêter les vieux châles de Kachmyr et leür donner un air de
fraîcheur et de nouveauté. On les leur fait teindre en rouge, en jaune, en couleur
de chair, &c., même ceux qui portent une couleur plus fon cé e , et l’on en est
quitte pour deux pataquès : avis à ceux qui se procurent des châles de l’Inde par
la voie de l’Egypte. On teint aussi avec succès les châles de soie, les milâyeli, les
étoffes de coton. L e plus grand atelier de teinture au Kaire est appelé masbaghat
el-soultâny (4) ; là se teignent les draps, les soies et toutes les étoffes en vert, en
bleu, en noir, en rouge, en jaune et de toutes couleurs: on y compte trente à
quarante ouvriers.
Il existe quatre ateliers de teinture par impression, doulâb el-basmagyeh. On s’y |
(1) Voyez pl. 26, É. M. vol.I, F-io, à l’angle de la (3) Voyez planche x v i , fig. t , Arts et Métiers, et
rue dite Sekhet el—JVleydan. l’explication.
(2) Voyez planche 2.6, É. M. vol./ (n.° ’ 66, E-12). (4 ) Voyez planche 2.6, È. M. vol. I (n.“ 2jç,G-8).
sert de planches ou de moules portant des dessins assez jolis, du moins ceux qui
sont travaillés à Constantinople ; car ceux qui sont faits au Kaire sont d’une très-
mauvaise exécution, et les dessins sont plus mauvais encore. L ’ouvrier a la main
garnie d un cuir; il trempe la planche dans le bain et frappe avec force l’étoffe qui
est à imprimer, et qui est ordinairement une mousseline venant de la Mecque ( i ).
L U S T R A G E .
Plusieurs ateliers pour le lustrage des étoffes existent au Kaire ; ce travail consiste
dans les opérations suivantes : on lave d’abord les étoffes neuves ou vieilles;
après les avoir fait sécher au soleil, on les passe à l'empois, et on les fait sécher
de nouveau ; après q u o i, deux hommes les frappent avec de gros marteaux
de bois pendant Iespace dune heure, afin de leur donner beaucoup de poli et
de, souplesse ; de la, elles passent au laminoir ^mangalehy ainsi composé : c’est un
double cylindre : l’inférieur est en bois, il a un pied de diamètre ; l’autre a 6 pouces,
il est en cuivre et creux : de temps en temps on y introduit un rouleau en fer
rougi; avant que l’étoffe passe entre les cylindres, un homme la frotte légèrement
avec un peu de bougie et de savon, tandis quun autre la tient du côté
opposé ; le cylindre est mis en mouvement par deùx ouvriers., à l’aide d’une
manivelle. A u bout de trois jours, l’opération est complète, et alors l’étoffe a acquis
beaucoup de lustre (2).
B R O D E R IE S .
Les brodeurs, el-qoubourgyeli, occupent un grand nombre de boutiques. On
brode au tambour, en fil de métal, sur soie, sur drap, sur casimir, sur velours,
sur mousseline, & c ., au crochet et de diverses manières. Les brodeurs les plus
habiles sont ceux qui travaillent en or et en argent sur le maroquin et sur toute
sorte de peaux. On trouvera, dans l’Explication des Arts et Métiers, quelques
détails sur cet a r t, dans lequel les Egyptiens sont fort adroits ( 3 ).
P A S S E M E N T IE R S .
Les passementiers ne manquent point non plus d’adresse : ceux qui font des
cordons de soie ronds ou plats, sont dits el-aqâdyn ( 4)4 d’autres tressent en coton,
el-habbâkyn. Les métiers sont remarquables par leur simplicité dans les pièces principales
et les accessoires (y) : par exemple, c’est à l’aide d’un os, ordinairement un
tibia de chameau, qu’on aplatit les cordons de soie, Les fabricans de glands en
soie, or et argent, s’appellent el-armagyeh (6) ; les ouvriers en fils d’or et d’argent,
el-qasabgyeh: ce sont des Coptes; ils garnissent de métal la soie jaune ou blanche,
après qu’ils ont eu coupé ce métal en très-petites lames (7).
(1) Voyez planche 26, É. M. vol. I (n.° 182, F - 7 , (4) Voyez p l. 26, É. M. vol. I ; n.°277, D 6 ; n.» 327,
en face du n.° 259, G>8 ; n.° 405, H - 7 ; n.° 189> K-6, N-7, et autres endroits dé la v i i i .c et de la vil.® section.
etn.° 133, F - 10). v ( 5 ) Voyez planche X IV , fig. 2....^, Arts et Métiers,
(2) Voyez planche 26, E. M. vol. / ( n.° 399, L-8 ). et l’explication.
(3 ) Voyez planche x v i i , fig. 2, Arts et Métiers, et (6) Voyez la iiote 4 ci-dessus.
l’explication. (7) Voyez planche 26, È.M. vol I f n.° 276, L-6 ).