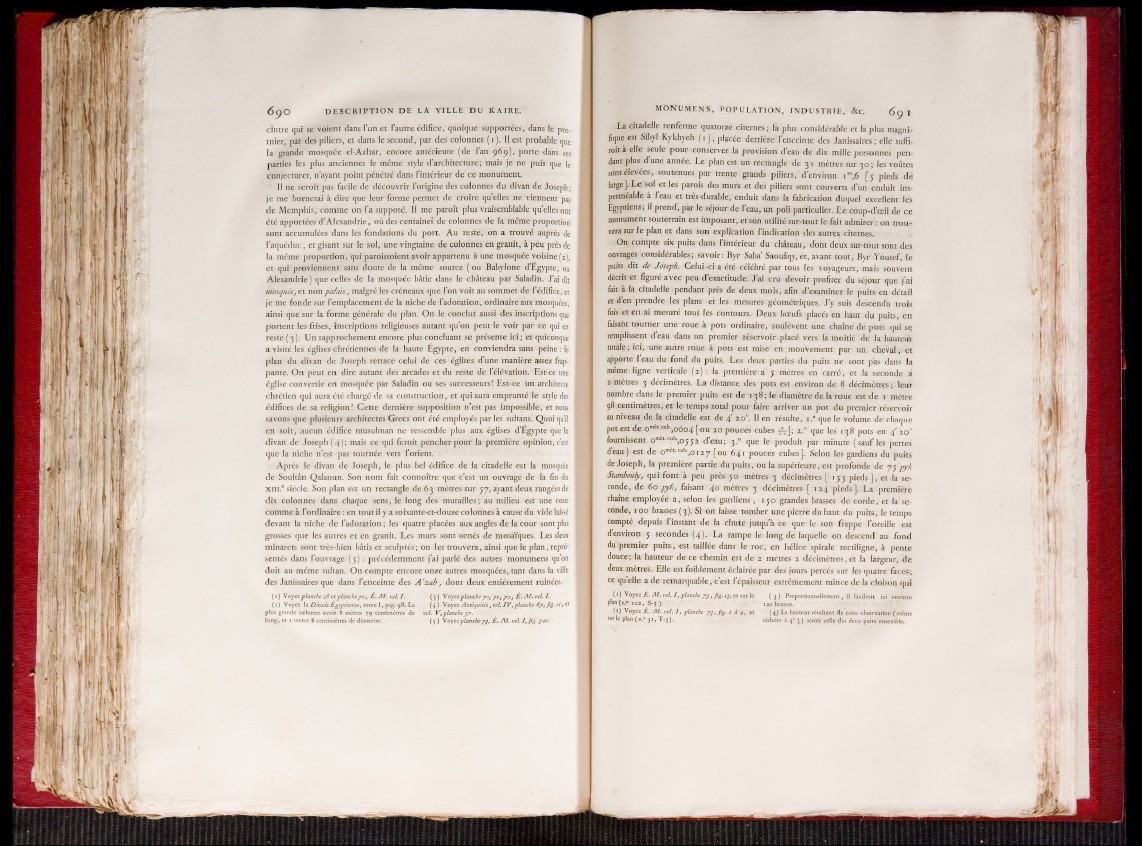
cintre qui se’ voient dans l’un et l’autre édifice, quoique supportées, dans le premier,
par des piliers, et dans le second, par des colonnes ( i ). Il est probable que
la grande mosquée el-Azhar, encore antérieure (de l’an 969), porte dans ses
parties les plus anciennes le même style d’architecture; mais je ne puis que le
conjecturer, n’ayant point pénétré dans l’intérieur de ce monument.
Il ne seroit pas facile de découvrir l’origine des colonnes du divan de Joseph;
je me bornerai à dire que leur forme permet de croire qu’elles ne viennent pas
de Memphis, comme on l’a supposé. Il me paroît plus vraisemblable qu’elles ont
été apportées d’Alexandrie, où des centaines de colonnes de la même proportion
sont accumulées dans les fondations du port. A u reste, on a trouvé auprès de
l’aquéduc, et gisant sur le sol, une vingtaine de colonnes en granit, à peu près de
la même proportion, qui paroissoient avoir appartenu à une mosquée voisine (2],
et qui proviennent sans doute de la même source (ou Babylone d’Egypte, ou
Alexandrie ) que celles de la mosquée bâtie dans le château par Saladin. J’ai dit
mosquée, et non palais, malgré les créneaux que l’on voit au sommet de l’édifice, et
je me fonde sur l’emplacement de la niche de l’adoration, ordinaire aux mosquées,
ainsi que sur la forme générale du plan. On le conclut aussi des inscriptions que
portent les frises, inscriptions religieuses autant qu’on peut le voir par ce qui en
reste ( 3 ). Un rapprochement encore plus concluant se présente ici ; et quiconque
a visité les églises chrétiennes de la haute Egypte, en conviendra sans peine : le
plan du divan de Joseph retrace celui de ces églises d’une manière assez frappante.
On peut en dire autant des arcades et du reste de l’élévation. Est-ce une
église convertie en mosquée par Saladin ou ses successeurs! Est-ce un architecte
chrétien qui aura été chargé de sa construction, et qui aura emprunté le style des
édifices de sa religionI Cette dernière supposition n’est pas impossible, et nous
savons que plusieurs architectes Grecs ont été employés par les sultans. Quoi qu’il
en soit, aucun édifice musulman ne ressemble plus aux églises d’Egypte que le
divan de Joseph (4); mais ce qui feroit pencher pour la première opinion, c’est
que la niche n’est-pas tournée vers l’orient.
Après le divan de Joseph, le plus bel édifice de la citadelle est la mosquée
de Soultân Qalaoun. Son nom fait connoître que c’est un ouvrage de la fin du
xm .“ siècle. Son plan est un rectangle de 63 mètres sur 57, ayant deux rangées de
dix colonnes dans chaque sens, le long des murailles; au milieu est une cour
comme à l’ordinaire : en tout il y a soixante-et-douze colonnes à cause du vide laissé
devant la niche de l’adoration ; les quatre placées aux angles de la cour sont plus
grosses que les autres et en granit. Les murs sont ornés de mosaïques. Les deux
minarets sont très-bien bâtis et sculptés; on les trouvera, ainsi que le plan, représentés
dans l’ouvrage (y) : précédemment j’ai parlé des autres monumens qu’on
doit au même sultan. On compte encore onze autres mosquées, tant dans la ville
des Janissaires que dans l’enceinte des A ’zab, dont deux entièrement ruinées.
( i ) Voyez planche 2.8 et planche 70, E. M, vol. 1. ( 3 ) Voyez planche 70, 71,72, E. M. vol. I.
(2) Voyez la Décade Egyptienne, tome I , pag. 98. La (4 ) Voyez Antiquités, vol. IV, planche 67, fig. ri, et
plus grande colonne a voit 8 mètres 79 centimètres de vol. V,planche37.
long, et 1 mètre 8 centimètres de diamètre. (5) V oyez planche 73, E. M. vol. I, fig. j-10.
La citadelle renferme quatorze citernes ; la plus considérable et la plus magnifique
est Sibyl Kykhyeh ( i ) , placée derrière l’enceinte des Janissaires ; elle suffi-
roit à elle seule pour conserver la provision d’eau de dix mille personnes pendant
p lu sd ’une année. Le plan est un rëctangle de 31 mètres sur 3 0 ; les voûtes
sont élevées, soutenues par trente grands piliers, d’environ r°i,6 ['5 pieds dé
large.]. L e sol et les parois des murs et des piliers sont couverts d’ùn enduit imperméable
à 1 eau et tres-durable, enduit dans la fabrication duquef excellent les
Égyptiens; il prend, par le séjour de l’eau, un poli particulier. L e coup-d’oeil de ce
monument souterrain est imposant, et son utilité sur-tout le fait admirer : on trouvera
sur le-plan et dans 'son explication l’indication des autres citernes.
On compte six puits dans 1 intérieur du château, dont deux sur-tout sont des
ouvrages considérables; savoir: Byr Saba’ Saouâqy, et, avant tout, Byr Yousef, le
puits dit de Joseph. Celui-ci a été célébré par tous les voyageurs:, mais souvent
décrit et figuré avec peu d exactitude. J’ai cru devoir profiter du séjour que j’ai
fait.a la citadelle pendant pfes de deux mois, afin d’examiner le jiuits en détail
et d en prendre les plans et les mesures géométriques. J’y suis descendu trois
fois et en ai mesure tous les contours. Deux boeufs placés en haut du puits, en
faisant tourner une roue a pots ordinaire, soulèvent une chaîne1 de pots qui se
remplissent d eau dans un premier réservoir placé vers la moitié dé la hâuteùf
totale ; ici, .une autre roue a pots est mise en mouvement par un, cheval, et
apporte 1 eau du fond du puits. Les deux parties du puits ne sont pas dans la
même: ligne verticale (2) : la première a 5 mètres en carré,, et la seconde a
2.métrés 3 décimètres. La distance des pots est environ de 8 décimètres; leur
nombre dans le premier puits est de 138 ; le:diamètre d e là roue est de r mètre
98 centimètres, et le temps ;total pour faire arriver un pot du premier réservoir
au niveau de la citadelle est de 4‘ 20”. II en résulte, 1.° que le volume de chaque
pot est de-ora“ -cub-,ooo4 [ou 2crpoucés cubes 2.0 que les 138 pots en 4 ' 20"
fournissent omc, cub-,oyy2 d’eau; 3.0 que le produit par minute (saufles pertes
d eau ) est de omeI' cllb,,o f2 7 [ ou 641 pouces cubes]. Selon les gardiens du puits
de Joseph, la première partie :du:puits, ou la supérieure, est profonde de 7 y pyk
Stambouly, qui fon t à peu près 50 mètres 3 décimètres I jy y pieds ], et la seconde,
d t 60 pyk, faisant 40 mètres 3 décimètres j[.: 124 pieds]. La première
chaîne employée a , selon les gardiens, 150 grandes brasses de corde, et la’ se-
cûnde, 100 brasses (3). Si on laisse tomber une pierre du haut du puits, le temps
compte depuis : I instant de la chute jusqu’à ce qu e'le, son frappe l’oreille est
d environ y secondes '>(-4 )• L a rampe le long de laquelle on descend au fond
du premier puits, est taillée dans le roc, en hélice spirale rectiligne; à pente
douce; la hauteur de ce chemin est de 2 mètres 2 décimètres, et la largeur, de
deuxmetreb. Elle est foiblement éclairée par des jours percés sur les quatre facés-;
ce qu elle a de' remarquable, c’est l’épaisseur extrêmement mince de la cloison qui
(1 ) Voyez E. M. vol. I , planche 73, fig, et sur le ( 3 ) Proportionnellement, il faudroit ici environ
plan (n.® 102, S-3 ).' | •- ■ 1 • 120'brasses.
(2) Voyez E. M. vol. I , planche 73, fig. 1 à 4, et : (4r) La hauteur résultant de cette obsérvation ( même
sur le plan ( n.° 51, T-3 ). réduite à 4 " £ ) seroit celle des deux puits ënsemble.