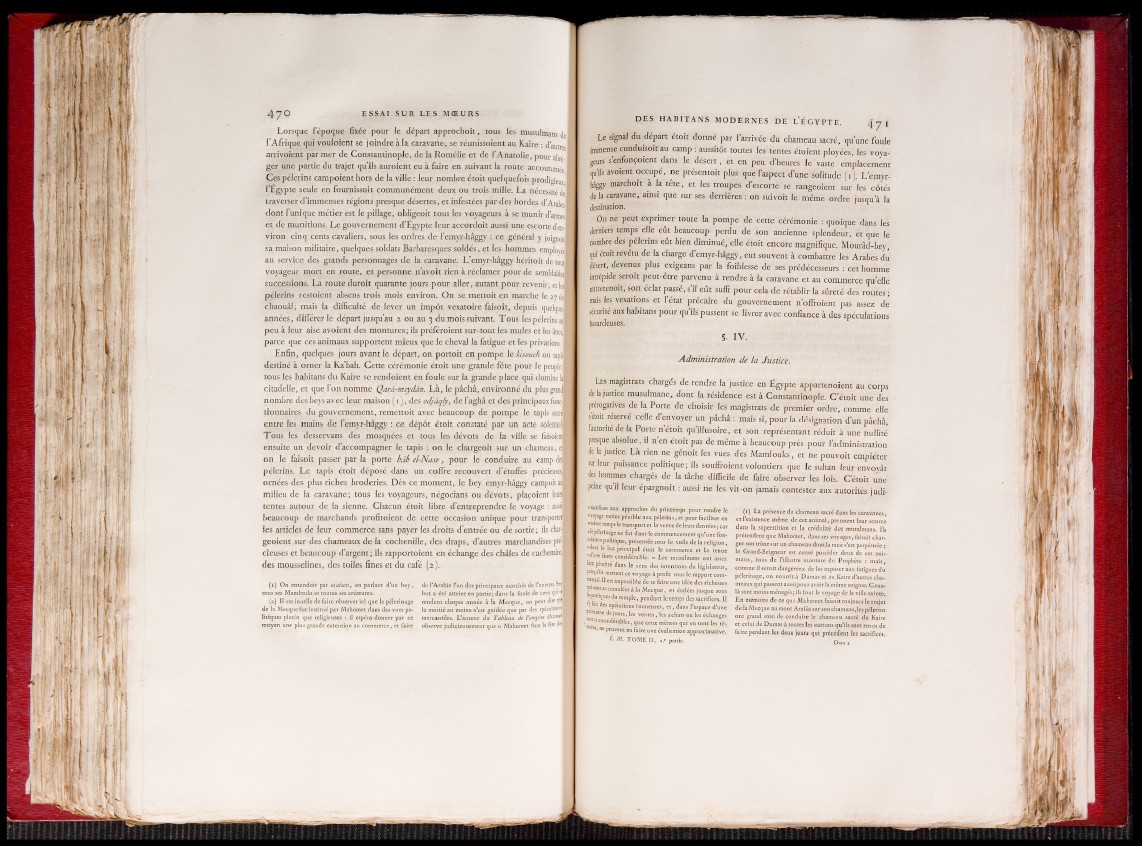
Lorsque l’époque fixée pour le départ approchoh, tous les musulmans d I
l’Afrique qui vouloient se joindre à la caravane, se réunissoient au Kaire : d’autres I
arrivoient par mer de Constantinople, de la Romélie et de l’Anatoiie, pour abré I
ger une partie du trajet qu’ils auroient eu à faire en suivant la route accoutumée I
Ces pèlerins campoient hors de la ville : leur nombre étoit quelquefois prodirieml
l’Egypte seule en fournissoit communément deux ou trois mille. La nécessité del
traverser d’immenses régions presque désertes, et infestées par des hordes d’Arabes«
dont l’unique métier est le pillage, obligeoit tous les voyageurs à se munir d’armes«
et de munitions. L e gouvernement d’Egypte leur accordoit aussi une escorte d’en-1
viron cinq cents cavaliers, sous les ordres de l’emyr-hâggy : ce général y joignoitfi
sa maison militaire, quelques soldats Barbaresques soldés, et les hommes employés*
au service des grands personnages de la caravane. L ’emyr-hâggy héritoit de tout!
voyageur mort en route, et personne n’avoit rien à réclamer pour de semblable™
successions. L a route duroit quarante jours pour aller, autant pour revenir, etles®
pèlerins restoient absens trois mois environ. O n se mettoit en marche le 27 défi
chaouâl; mais la difficulté de lever un impôt vexatoire faisoit, depuis quelques®
années, différer le départ jusqu’au 2 ou au 3 du mois suivant. T ou s les pèlerins un®
peu à leur aise avoient des montures; ils préféroient sur-tout les mules et les ânes®
parce que ces animaux supportent mieux que le cheval la fatigue et les privations. B
Enfin, quelques jours avant le départ, on portoit en pompe le kisoueh ou tapi®
destiné à orner la Ka’bah. Cette cérémonie étoit une grande fête pour le peuple B
tous les habitans du Kaire se rèndoient en foule sur la grande place qui domine la®
citadelle, et que l’on nomme Qarâ-?ncydân. L à , le pâchâ, environné du plusgran®
npmbre des beys avec leur maison ( t ), des odjâqly, de l’aghâ et des principaux foncB
tionnaires du gouvernement, remettoit avec beaucoup de pompe le tapis sacré®
entre les mains de l’emyr-hâggy : ce dépôt étoit constaté par un acte solennel®
Tous les desservans des mosquées et tous les dévots de la ville se faisoien®
ensuite un devoir d’accompagner le tapis : on le chargeoit sur un chameau, et®
on le faisoit passer par la porte bâb d-N asr, pour le conduire au camp des®
pèlerins. L e tapis étoit déposé dans un coffre recouvert d’étoffes précieuses®
ornées des plus riches broderies. Dès ce moment, le bey emyr-hâggy campoitau®
milieu de la caravane; tous les voyageurs, négocians ou dévots, plaçoient leur®
tentes autour de la sienne. Chacun étoit libre d’entreprendre le voyage : aussi®
beaucoup de marchands profitoient de cette occasion unique pour transporte®
les articles de leur commerce sans payer les droits d’entrée ou de sortie ; ils char®
geoient sur des chameaux de la cochenille, des draps, d’autres marchandises pré®
cieuses et beaucoup d’argent; ils rapportoient en échange des châles de cachemire®
des mousselines, des toiles fines et du café (2.).
(1) On entendoit par maison, en parlant d’un bey,
tous ses Mamlouks et toutes ses créatures.
(2) 11 est inutile de faire observer ici que le pèlerinage
de la Mecque fut institué par Mahomet dans des vues politiques
plutôt que religieuses : il espéra donner par ce
moyen une plus grande extension au commerce, et faire
de l’Arabie l’un des principaux marchés de l’univers.Son^
but a été atteint en partie; dans la foule de ceux qui st^
rendent chaque année à la Mecque, on peut direque^
la moitié au moins n’est guidée que par des spéculation™
mercantiles. L’auteur du Tableau de l’empire OttomMÆ
observe judicieusement que « Mahomet fixa la fête des •
D E S H A B I T A N S M O D E R N E S D E L ’ E G Y P T E . 4 ^ 1
Le signal du départ étoit donné par 1 arrivée du chameau sacré, qu’une foule
immense conduisoifau camp : aussitôt toutes les tentes étoient ployées, les voyageurs
senfonçoient dans le désert, et en peu d’heures le vaste emplacement
qu’ils avoient occupé, ne présentoit plus que l’aspect d’une solitude ( 1 ). L ’emyr-
hâggy marchoit à la tête, et les troupes d’escorte se rangeoient sur les côtés
de la caravane, ainsi que sur ses derrières : on suivoit le même ordre jusqu’à la
destination.
On ne peut exprimer toute la pompe de cette cérémonie : quoique dans les
derniers temps elle eût beaucoup perdu de son ancienne splendeur, et que le
nombre des pèlerins eut bien diminué, elle étoit encore magnifique. Mourâd-bey,
qui ctoitrevetu de la charge d emyr-hâggy, eut souvent à combattre les Arabes du
désert, devenus plus exigeans par la foibiesse de ses prédécesseurs : cet homme
intrépide seroit peut-être parvenu à rendre à la caravane et au commerce qu’elle
entretenoit, son éclat passé, s’il eût suffi pour cela de rétablir la sûreté des routes ;
mais les vexations et l’état précaire du gouvernement n’offioient pas assez de’
securité aux habitans pour qu ils pussent se livrer avec confiance à des spéculations
hasardeuses.
§. IV.
Administration de la Justice.
L e s magistrats chargés de rendre la justice en Égypte appartenoient au corps
de la justice musulmane, dont la résidence est à Constantinople. C ’étoit une des
prérogatives de la Porte de choisir les magistrats de premier ordre, comme elle
sétoit réservé celle d envoyer un pâchâ : mais si, pour la désignation d’un pâchâ,
Iautorité de la Porte n étoit qu’illusoire, et son représentant réduit à une nullité
presque absolue, il n en étoit pas de même à beaucoup près pour l’administration
de la justice. L a rien ne gênoit les vues des Mamlouks, et ne pouvoit empiéter
sur leur puissance politique; ils souffioient volontiers que le sultan leur envoyât
des hommes charges de la tache difficile de faire observer les lois. C ’étoit une
peine qu il leur épargnoit : aussi ne les vit-on jamais contester aux autorités judi-
»sacrifices aux approches du printemps pour rendre le
»voyage moins pénible aux pèlerins, et pour faciliter en
»meme temps le transport et la vente de leurs denrées ; car
» pèlerinage ne ^ut dans le commencement qu’une fon-
» dation politique, présentée sous le voile de la religion,
»dont le but principal étoit le'commerce et la tenue
» une foire considérable. » Les musulmans ont assez
ifn pénétré dans le sens des intentions du législateur,
pnisqu ils mettent ce voyage à profit sous le rapport com-
mercial. II est impossible de se faire une idée des richesses
qui sont accumulées à la Mecque, et étalées jusque sous
«portiques du temple, pendant le temps des sacrifices. II
syfait des opérations immenses, et, dans l’espace d’une
quinzaine de jours, les ventes, les achats ou les échanges
• °m s* C0nsidérables, que ceux mêmes qui en sont les té-,
lns> ne peuvent en faire une évaluation approximative.
E . A i. T O M E I I , 2.« partie.
(1) La présence du chameau sacré dans les caravanes,
et l’existence même de cet animal, prennent leur source
dans la superstition et la crédulité des musulmans. Ils
prétendent que Mahomet, dans ses voyages, faisoit charger
son trône sur un chameau dont la race s’est perpétuée ;
le Grand-Seigneur est censé posséder deux de ces animaux,
issus de l’illustre monture du Prophète : mais,
comme il seroit dangereux de les exposer aux fatigues du
pèlerinage, on nourrit à Damas et au Kaire d’autres chameaux
qui passent aussi pour avoir la même origine. Ceux-
là sont moins ménagés; ils font le voyage de la ville sainte.
En mémoire de ce que Mahomet faisoit toujours le trajet
de la Mecque au mont Arafat sur son chameau, les pèlerins
ont grand soin de conduire le chameau sacré du Kaire
et celui de Damas à toutes les stations qu’ils sont tenus.de
faire pendant les deux jours qui précèdent les sacrifices.