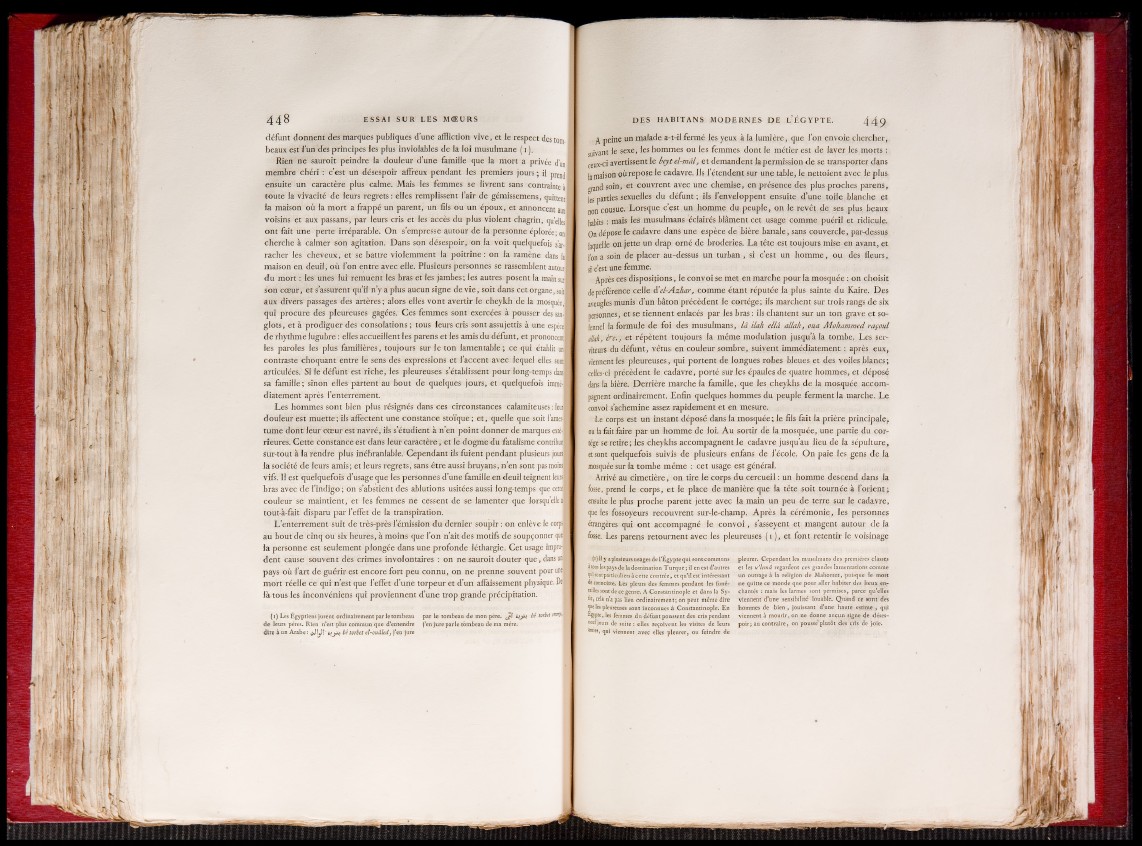
défunt donnent des marques publiques d’une affliction v iv e , et le respect des torn-1
beaux est l’un des principes les plus inviolables de la loi musulmane ( i ).
Rien ne sauroit peindre la douleur d’une famille que la mort a privée d’uni
membre chéri : c’est un désespoir affreux pendant les premiers jours ; il prend!
ensuite un caractère plus calme. Mais les femmes se livrent sans contrainte àl
toute la vivacité de leurs regrets : elles remplissent l’air de gémissemens, quittent!
la maison où la mort a frappé un parent, un fils ou un époux, et annoncent aux!
voisins et aux passans, par leurs cris et les accès du plus violent chagrin, qu’elles!
ont fait une perte irréparable. On s’empresse autour de la personne éplorée; on
cherche à calmer son agitation. Dans son désespoir, on la voit quelquefois s’ar!
racher les cheveux, et se battre violemment la poitrine: on la ramène dans la|
maison en deuil, où l’on entre avec elle. Plusieurs personnes se rassemblent autour!
du mort : les unes lui remuent les bras et les jambes; les autres posent la mainsurl
son coeur, et s’assurent qu’il n’y a plus aucun signe de v ie , soit dans cet organe, soit!
aux divers passages des artères; alors elles vont avertir le cheykh de la mosquée,!
qui procure des pleureuses gagées. Ces femmes sont exercées à pousser des san-!
glots, et à prodiguer des consolations ; tous leurs cris sont assujettis à une espèce!
de rhythme lugubre ; elles accueillent les parens et les amis du défunt, et prononcern!
les paroles les plus familières, toujours sur le ton lamentable ; ce qui établit un!
contraste choquant entre le sens des expressions et l’accent avec lequel elles sont|
articulées. Si le défunt est riche, les pleureuses s’établissent pour long-temps dan!
sa famille ; sinon elles partent au bout de quelques jours, et quelquefois fanmé!
diatement après l’enterrement.
Les hommes sont bien plus résignés dans ces circonstances calamiteuses : leur
douleur est muette; ils affectent une constance stoïque; e t , quelle que soit l’amer!
tume dont leur coeur est navré, ils s’étudient à n’en point donner de marques exté-fl
rieures. Cette constance est dans leur caractère, et le dogme du fatalisme contribue«
sur-tout à la rendre plus inébranlable. Cependant ils fuient pendant plusieurs jours!
la société de leurs amis; et leurs regrets, sans être aussi bruyans, n’en sont pas moins!
vifs. 11 est quelquefois d’usage que les personnes d’une famille en deuil teignent leursl
bras avec de l’indigo ; on s’abstient des ablutions usitées aussi long-temps que cette«
couleur se maintient, et les femmes ne cessent de se lamenter que lorsqu’elle ¡ 1
tout-à-fait disparu par l’effet de la transpiration.
L ’enterrement suit de très-près l’émission du dernier soupir : on enlève le corps«
au bout de cinq ou six heures, à moins que l’on n’ait des motifs de soupçonner quel
la personne est seulement plongée dans une profonde léthargie. Cet usage impru-l
dent cause souvent des crimes involontaires : on ne sauroit douter que, dans uni
pays où l’art de guérir est encore fort peu connu, on ne prenne souvent pour unt«
mort réelle ce qui n’est que l’effet d’une torpeur et d’un affaissement physique. DeH
là tous les inconvéniens qui proviennent d’une trop grande précipitation.
(i) Les Égyptiens jurent ordinairement par le tombeau par le tombeau de mon père. ^>1 üjjXj 'b&itonut wwÇ'B
de leurs pères. Rien n’est plus commun que d’entendre j’en jure parle tombeau de ma mère,
dire à un Arabe: oJIji!' âjjXj bé torbet el-ouâled, j’en jure
A peine un malade a-t-il fermé les yeux à la lumière, que l’on envoie chercher,
s u iv a n t le sexe, les hommes ou les femmes dont le métier est de laver les morts :
c e u x - c i avertissent le beyt el-mâl, et demandent la permission de se transporter dans
la m a i s o n oùrepose le cadavre. Us letendent sur une table, le nettoient avec le plus
„ndsoin, et couvrent avec une chemise, en présence des plus proches parens,
les parties sexuelles du défunt ; ils l’enveloppent ensuite d’une toile blanche et
non cousue. Lorsque c’est un homme du peuple, on le revêt de ses plus beaux
habits : mais les musulmans éclairés blâment cet usage comme puéril et ridicule.
On dépose le cadavre dans une espèce de bière banale, sans couvercle, par-dessus
la q u e lle on jette un drap orné de broderies. L a tête est toujours mise en avant, et
l’on a soin de placer au-dessus un turban, si c’est un homme, ou des fleurs,
si c’est une femme.
Après ces dispositions, le convoi se met en marche pour la mosquée ; on choisit
de préférence celle à’cl-Azhar, comme étant réputée la plus sainte du Kaire. Des
aveugles munis d’un bâton précèdent le cortège; ils marchent sur trois rangs de six
personnes, et se tiennent enlacés par les bras : ils chantent sur un ton grave et solennel
la formule de foi des musulmans, lâ ilali ellâ allah, oua Moliammtd raçoul
allai, & c-, et répètent toujours la même modulation jusqu’à la tombe, Les serviteurs
du défunt, vêtus en couleur sombre, suivent immédiatement : après eux,
viennent les pleureuses, qui portent de longues robes bleues et des voiles blancs;
celles-ci précèdent le cadavre, porté sur les épaules de quatre hommes, et déposé
dans la bière. Derrière marche la famille, que les cheykhs de la mosquée accompagnent
ordinairement. Enfin quelques hommes du peuple ferment la marche. L e
convoi s’achemine assez rapidement et en mesure.
Le corps est un instant déposé dans la mosquée; le fils fait la prière principale,
ou la fait faire par un homme de loi. A u sortir dè la mosquée, une partie du cortège
se retire; les cheykhs accompagnent le cadavre jusqu’au lieu de la sépulture,
et sont quelquefois suivis de plusieurs enfans de l’école. On paie les gens de la
mosquée sur la tombe même : cet usage est général.
Arrivé au cimetière, on tire le corps du cercueil : un homme descend dans la
fosse, prend le corps, et le place de manière que la tête soit tournée à l’o rient;
ensuite le plus proche parent jette avec la main un peu de terre sur le cadavre,
que les fossoyeurs recouvrent sur-le-champ. Après la cérémonie, les personnes
étrangères qui ont accompagné le c o n v o i, s’asseyent et mangent autour de la
fosse. Les parens retournent avec les pleureuses ( i ) , et font retentir le voisinage
(i) H y a plusieurs usages de l’Egypte qui sont communs pleurer. Cependant les musulmans des premières classées
a tpus les pays de la domination Turque; il en est d’autres et les u’iemâ regardent ces grandes lamentations comme
qui sont particuliers à cette contrée, et qu’il est intéressant un outrage à la religion de Mahomet, puisque le mort
connoître. Les pleurs des femmes pendant les funé- ne quitte ce monde que pour aller habiter des lieux e.nrtaiHes
sont de ce genre. A Constantinople et dans la Sy- chantés : mais les larmes sont permises, parce qu’elles
nej cela n’a pas lieu ordinairement; on peut même dire viennent d’une sensibilité louable. Quand ce sont des
<p»e les pleureuses sont inconnues à Constantinople. En hommes de bien, jouissant d’une haute estime , qui
%pte, les femmes du défunt poussent des cris pendant viennent à mourir, on ne donne aucun signe de désesneuf
jours de suite : elles reçoivent les visites de leurs poir; au contraire, on pousse^plutôt des cris de joie,
amies, qui viennent avec elles pleurer, ou feindre de