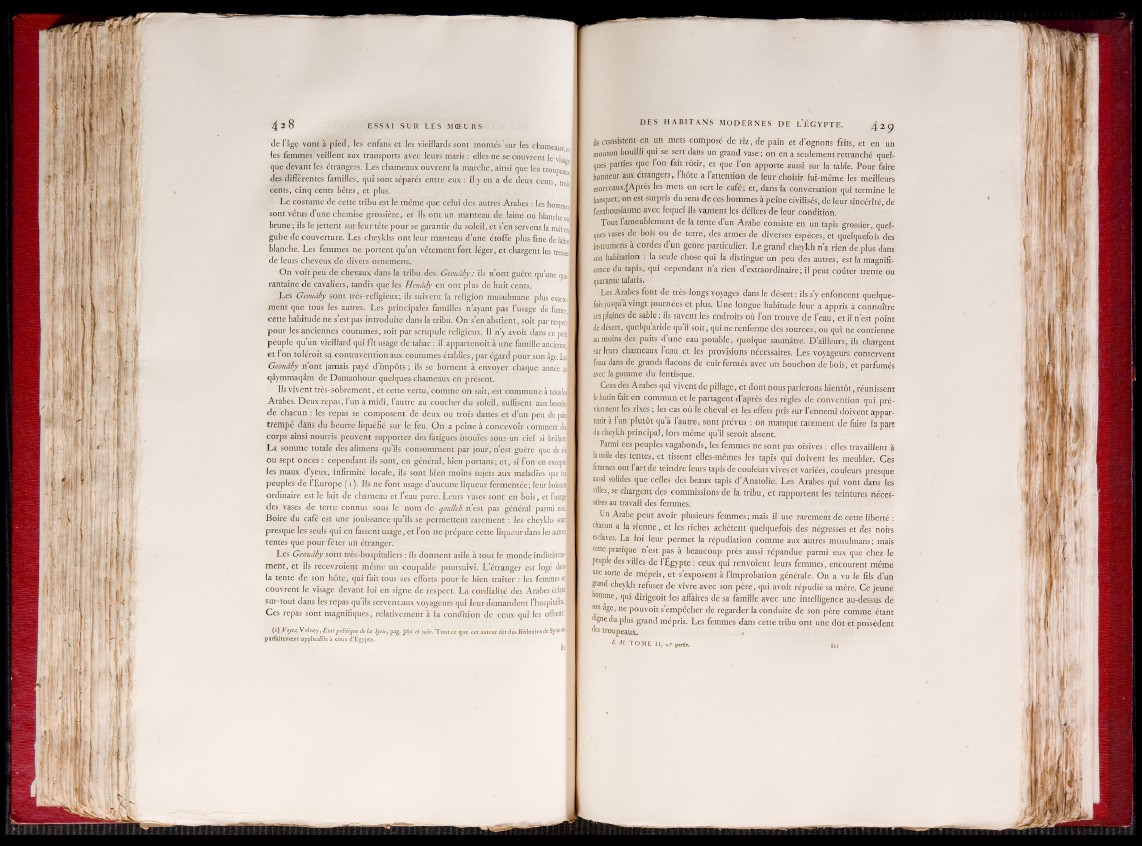
de l’âge vont à pied, les enfans et les vieillards sont montés'sur les chameaux
les femmes veillent aux transports avec leurs maris : elles ne se couvrent le visa»
que devant les étrangers. Les chameaux ouvrent la marche, ainsi que les troupeau'
des différentes familles, qui sont séparés entre eux : il y en a de deux cents, tro'
cents, cinq cents bêtes, et plus.
L e costume de cette tribu est le même que celui des autres Arabes : les homme
sont vêtus d’une chemise grossière, et ils ont un manteau de laine ou blanche oui
brune; ils le jettent sur leur tête pour se garantir du soleil, et s’en serventía nuit en
guise de couverture. Les cheykhs ont leur manteau d’une étoffe plus fine de laine
blanche. Les femmes ne portent qu’un vêtement fort léger, et chargent les tresses
de leurs cheveux de divers ornemens.
On voit peu de chevaux dans la tribu des Geouâby : ils n’ont guère qu’une qua-l
rantaine de cavaliers, tandis que les Henâdy en ont plus de huit cents.
Les Geouâby sont très-religieux; ils suivent la religion musulmane plus exacte-l
ment que tous les autres. Les principales familles n’ayant pas l’usage de fumer|
cette habitude ne s’est pas introduite dans la tribu. On s’en abstient, soit parrespeca
pour les anciennes coutumes, soit par scrupule religieux. II n’y avoit dans ce petit]
peuple qu’un vieillard qui fit usage de tabac : il appartenoit à une famille ancienne]
et l’on toléroit sa contravention aux coutumes établies, par égard pour son âge. Les!
Geouâby n’ont jamais payé d’impôts.; ils se bornent à envoyer chaque année aul
qâymmaqâm de Damanhour quelques chameaux en présent.
Ils v ivent très-sobrement, et cette vertu, comme on sait, est commune à touslej
Arabes. Deux repas, l’un à midi, l’autre au coucher du soleil, suffisent aux besoins]
de chacun : les repas se composent de deux ou trois dattes et d’un peu de paiJ
trempe dans du beurre liquéfié sur le feu. O n a peine à concevoir comment des]
corps ainsi nourris peuvent supporter des fâtigues inouïes sous un ciel si brûlant]
L a somme totale des alimens qu’ils consomment par jour, n’est guère que de s ij
ou sept onces : cependant ils sont, en général, bien portans; e t, si l’on en excepte]
les maux d’yeux, infirmité locale, ils sont bien moins sujets aux maladies que les]
peuples de l’Europe ( i ). Ils ne font usage d’aucune liqueur fermentée; leur boisson]
ordinaire est le lait de chameau et l’eau pure. Leurs vases sont en bois, et l’usage]
des vases de terre connus sous le nom de qoulleh n’est pas général p arm i eux]
Boire du café est une jouissance qu’ils se permettent rarement : les cheykhs sont]
presque les seuls qui en fassent usage, et l’on ne prépare cette liqueur dans les autres]
tentes que pour fêter un étranger.
Les Geouâby sont très-hospitaliers : ils donnent asile à tout le monde indistincte-]
ment, et ils recevroient même un coupable poursuivi. L ’étranger est logé dans]
la tente de son hôte, qui fait tous ses efforts pour le bien traiter : les femmes se]
couvrent le visage devant lui en signe de respect. L a cordialité des Arabes éclat*
sur-tout dans les repas qu’ils servent aux voyageurs qui leur demandent l’hospitalité]
Ces repas sont magnifiques, relativement à la condition de ceux qui les offrent:]
( i ) Voye.z Volney, Etat politique de la Syrie, pag. 361 et suiv. T out ce que cet auteur dit des Bédouins de Syrie cttl
parfaitement applicaEle à ceux d’Égypte.
ils consistent en un mets compose de riz , de pain et d’ognons frits, et en un
m o u to n bouilli qui se sert dans un grand vase ; on en a seulement retranché quelques
parties que 1 on fait rôtir, et que l’on apporte aussi sur la table. Pour faire
h o n n e u r aux étrangers, lh ote a l attention de leur choisir lui-même les meilleurs
n to r c e a u x .|Après les mets on sert le café; et, dans la conversation qui termine le
banquet, on est surpris du sens de ces hommes à peine civilisés, de leur sincérité, de
l’enthousiasme avec lequel ils vantent les délices de leur condition.
Tout 1 ameublement de la tente d’un Arabe consiste en un tapis grossier, quelques
vases de bois ou de terre, des armes de diverses espèces, et quelquefois des
instrumens à cordes d’un genre particulier. L e grand cheykh n’a rien de plus dans
son habitation : la seule chose qui la distingue un peu des autres, est la magnificence
du tapis, qui cependant n a rien d extraordinaire ; il peut coûter trente ou
quarante talaris.
Les Arabes font de tres-longs voyages dans le désert : ils s’y enfoncent quelquefois
jusqu a vingt journées et plus. Une longue habitude leur a appris à connoître
ces plaines de sable. ils savent les endroits ou 1 on trouve de 1 eau, et il n’est point
de désert, quelqu’aride qu’il soit, qui ne renferme des sources, ou qui ne contienne
au moins des puits d’une eau potable, quoique saumâtre. D ’ailleurs, ils chargent
sur leurs chameaux 1 eau et les provisions nécessaires. Les voyageurs conservent
l’eau dans de grands flacons de cuir fermés avec un bouchon de bois, et parfumés
avec la gomme du lentisque.
Ceux des Arabes qui vivent de pillage, et dont nous parlerons bientôt, réunissent
le butin fait en commun et le partagent d après des réglés de convention qui préviennent
les rixes ; les cas ou le cheval et les effets pris sur l’ennemi doivent appartenir
a 1 un plutôt qu à 1 autre, sont prévus : on manque rarement de faire la part
du cheykh principal, lors même qu’il seroit absent.
Parmi ces peuples vagabonds, les femmes ne sont pas oisives : elles travaillent à
la toile des tentes, et tissent elles-mêmes les tapis qui doivent les meubler. C e s
femmes ont 1 art de teindre leurs tapis de couleurs vives et variées, couleurs presque
aussi solides que celles des beaux tapis d’Anatolie. Les Arabes qui vont dans les
villes, se chargent des commissions de la tribu, et rapportent les teintures nécessaires
au travail des femmes.
Un Arabe peut avoir plusieurs femmes; mais il use rarement de cette liberté :
chacun a la sienne, et les riches achètent quelquefois des négresses et des noirs
esclaves. La loi leur permet la répudiation comme aux autres musulmans; mais
cette pratique n’est pas à beaucoup près aussi répandue parmi eux que chez le
peuple des villes de l’Égypte : ceux qui renvoient leurs femmes, entourent même
une sorte de mépris, et s’exposent à l’improbation générale. On a vu le fils d’un
grand cheykh refuser de vivre avec son père, qui avoit répudié sa mère. C e jeune
omme, qui dirigeoit les affaires de sa famille avec une intelligence au-dessus de
son âge, ne pouvoit s’empêcher de regarder la conduite de son père comme étant
<%ne du plus grand mépris. Les femmes dans cette tribu ont une dot et possèdent
□es troupeaux. •
iW, TOME II, a.« partie. jjj