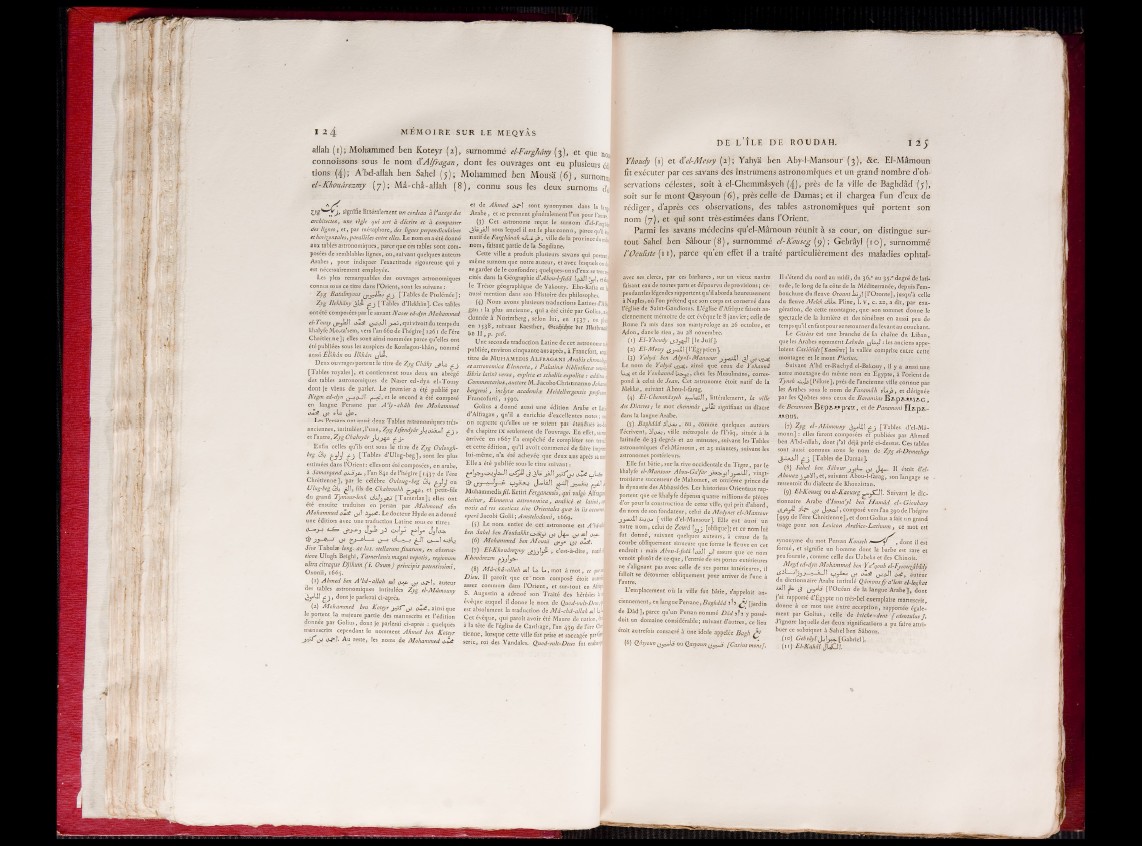
m PII
*â
m . ; 'V w
i l
I l M ! M . ' ;
m i t ¡ m
i f
i f iijr
aBra
allah (1) ; Mohammed ben Koteyr (2), surnommé el-Farghâny (3), et que n o j
connoissons sous le nom SAlfragan, dont les ouvrages ont eu plusieurs cdiï
lions (4); A ’bd-allah ben Sahel (y ) ; Mohammed ben Mousa ( 6 ) , surnomj
tl-Khonârezmy ( 7 ) ; Mâ-châ-allah ( 8 ) , connu sous les deux surnoms d'il
signifie littéralement un cordeau à l’usage du
architectes, une rigle qui sert à décrire et- à compasser
des lignes, et, par métaphore, des lignes perpendiculaires
et horizontales,parallèles entre elles. Le nom en a été donné
aux tablés astronomiques, parce que ces tables sont composées
de semblables lignes, ou, suivant quelques auteurs
Arabes , pour indiquer l’exactitude rigoureuse qui y
est nécessairement employée.
Les plus remarquables des ouvrages astronomiques
connus sous ce titre dans l’Orient, sont-les suivans :
Zyg Batalmyous [Tables de Ptolémée];
Zyg Ilekhâny 3UI g j [Tables d’IIekhân]. Ces tables
ont été composées par le savant Naser ed-dyn Mohammed
el-Tousy , qui vivoit du temps d u
khalyfe Mo.»ta’sem, vers l’an 660 de l’hégire [ 1261 de l’ère
Chrétier.ne]; elles sont ainsi nommées parce qu’elles ont
été publiées sous les auspices de Koulagou-khân, nommé
aussi Elkhân ou Ilhhân m
Deux ouvrages portent le titre de Zyg Châhy js la
[Tables royales], et contiennent tous deux un abrégé
des tables astronomiques de Naser ed-dyn el-Tousy
dont je viens de parler. Le premier a été publié par
JVegm ed-dyn f-sf, et le second a été composé
en langue Persane par A ’iy-châh ben Mohammed
oLà J ü .
Les Persans ont aussi deux Tables astronomiques très-
anciennes, intitulées,l’une, Zyg lsfendyâr ,
et l’autre, Zyg Chahryâr ^ j .
Enfin celles qu’ils ont sous le titre de Zyg Oulough-
% ê b [Tables d’UIug-beg], sont les plus
estimées dans l’Orient: elles ont été composées, en arabe,
à Samarqand > l’an 841 de l’hégire [1437 de l’ère
Chrétienne], par le célèbre Ouloug-beg ¿L ou
Ulug-beg ¿L fils de Chahroukh j g , et petit-fils
du grand Tymour-lenk [Tamerlan]; elles ont
été ensuite traduites en persan par Mahmoud ebn
Mohammed ¿ U Le docteur Hyde en a donné
une édition avec une traduction Latine sous ce titre :
A-^=» c[y-k
& J J Q ■» Oi ^ J î o — I « u â L
Sive Tabulae long, aclat. stellarum fixatum, ex observa-
tione. Ulugh Beighi, Tamerlanis magni nepotis, région uni
ultra ci traque Djihum (i. Oxum) principis potentissimi,
Oxonii, 1665.
(1) Ahmed ben A ’bd-allah «jf ^ o^-f, auteur
des tables astronomiques intitulées Zyg el-Mâmouny
3j*UI g j , dont je parlerai ci-après.
(2) Mohammed ben Koteyr oZ*, ainsi que
le portent la majeure partie des manuscrits et l’édition
donnée par Golius, dont je parlerai ci-après : quelques
manuscrits cependant le nomment Ahmed ben Koteyr
Au reste, les noms de Mohammed oZd
et de Ahmed sont synonymes dans la Ianfl
Arabe, et se prennent généralement l’un pour l’autre. ■
(3) Cet. astronome reçut le surnom à’el-FarghiÆ
3,U>J| sous lequel il est le plus connu, parce qu’il
natif de Farghânah «üLcjS, ville de la province du mflfl
nom, faisant partie de la Sogdiane.
Cette ville a produit plusieurs savans qui portent i
même surnom que notre auteur, et avec lesquels on d S
se garder de le confondre ; quelques-uns d’eux se trourifl
cités dans la Géographie d’Abou-l-fedâ loJJî ^j|, et ¿ 9
le Trésor géographique de Yakouty. Ebn-Kafta en H
aussi mention dans son Histoire des philosophes. |
(4) Nous^ avons plusieurs traductions Latines d’AIfo;
gan : la plus ancienne, qui a été citée par Golius,
donnée à Norimberg, selon lui, en 1537, ou pfofl
en 1538, suivant Kaesther, ©csdjtdjte ber 311ati;ciniÜI
bb I I , p. yo6.
Une seconde traduction Latine de cet astronome s j f l
publiée, environ cinquante ans après, à Francfort, sonJ
titre de M u h a m e d i s A l f r a g a n i Arabischrono/<$-'
et astronomica Elementa, è Palatines bibliothecæ veiàir.
libris latine versa, expleta et scholiis expolita : additm-
Commentarius, auctore M. Jacobo Christmanno JolmùI
bergensi , inçlytce academiee Heidelbergensis professa^Ê
Francofurti, 1590.
Golius a donné aussi une édition Arabe et Laiir* '•
d’AIfragan, qu’il a enrichie d’excellentes notes ; J -
on regrette qu’elles ne se soient pas étendues aii-dlÉ'"
du chapitre IX seulement de l’ouvrage. En effet, saikJ
arrivée en 1667 l’a empêché de compléter son traval|:f;-
et cette édition, qu’il avoit commencé de faire impriaH
lui-même, n’a été achevée que deux ans après sa nr
Elle a été publiée sous le titre suivant :
j ¿U oZ^ 0^= I
& cre?—ü— —1® piill! - ,
Muhammedis^/. Ketiri Ferganensis, qui vulgo AlfragaF.
dicitur, Elementa astronomica, arabicè et latine, «me.
notis ad res exoticas sive Orientales quee in iis occurne
opéra Jacobi Golii; Amstelodami, 1669.
(5) Le nom. entier de cet astronome est A ’bd-ab
ben Sahel ben Noubakht o ^ j ^ ^ I
(6) Mohammed ben Mousà q j oZd!,
(7) El-Khouârezjny , c’est-à-dire, natif
Khouàrezm
(8) Ma-châ-allah am| L; Lo, mot à mot, ce <7//^ V
Dieu. II paroît que ce * nom composé étoit autrefs^H
assez commun dans l’Orient, et sur-tout en Afrifj
S. Augustin a adressé son Traité des hérésies à F
eveque auquel il donne le nom de Quod-vulfrDeus,^<1
est absolument la traduction de Mâ-châ-allah wl L'l>:
Cet évêque, qui paroît avoir été Maure de nation,
à la tête de l’église de Carthage, l’an 439 de l’ère CIb|||.
tienne, lorsque cette ville fut prise et saccagée par
série, roi des Vandales. Quod-vult-Deus fut enibaif^B
Yhoudy (1) et Sel-Mesry (2); Yahya hen Aby-i-Mansour' (3 ), &c. El-Mâmoun
fit exécuter par ces savans des instrtimens astronomiques et un grand nombre d’observations
célestes, soit à el-Cheminâsyeh (4), près de la ville de Baghdâd (y),
soit sur le mont Qasyoun ( 6 ), près celle de Damas ; et il chargea l’un d’eux de
rédiger, d’après ces observations, des tables astronomiques qui portent son
nom (7 ), et qui sont très-estimées dans l’Orient.
Parmi les savans médecins qu’el-Mâmoun réunit à sa cour, on distingue surtout
Sahel ben Sâbour(8), surnommé el-Kouseg [9 ) ; Gebrâyl (10), surnommé
l'Oculiste (11), parce qu’en effet il a traité particulièrement des maladies ophtalavec
ses clercs, par ces barbares, sur un vieux navire
faisant eau de toutes parts et dépourvu de provisions ; cependant
les légendes rapportent qu’il aborda heureusement
àNapIes,où l’on prétend que son corps est conservé dans
l’église de Saint-Gaudiosus. L’église d’Afrique faisoit anciennement
mémoire de cet évêque Iè 8 janvier; celle de
Rome l’a mis dans son martyrologe au 26 octobre, et
Adon, dans le sien, au 28 novembre.
P ( 1 ) El- Yhoudy ^ I [ le J uif].
(2) El-Mesry [l’Égyptien],
. (3) Yahya ben Aby-l-Mansour 3 ! ^
Le nom de Yahya ainsi- que ceux de Yohannâ
L4: et de Youhannâ » chez les Musulmans, correspond
à celui de Jean. Cet astronome étoit natif de la
Mekke, suivant Abom-l-farag.
(4) El-Chemmâsyeh ¿Ly-UiJI, littéralement, la ville
des Diacres ; le mot chemmâs signifiant un diacre
dans la langue Arabe.
(5) Baghdâd , ou , comme quelques auteurs
Récrivent, ville métropole de l’Iraq , située à la
latitude de 33 degrés et 20 minutes, suivant les Tables
astronohiiques d’el-Mâmoun, et 25 minutes, suivant les
astronomes postérieurs.
Elle fut bâtie, sur la rive occidentale du Tigre, par le
khalyfe el-Mansour Abou-Gdfar vingttroisième
successeur de Mahomet, et onzième prince de
la dynastie des Abbassides. Les historiens Orientaux rapportent
que ce khalyfe dépensa quatre millions de pièces
d’or pour la construction de cette ville, qui prit d’abord,
du nom de son fondateur, celui de Medynet el-Mansour
ÂÂJtV» [ville d’el-Mansour]. Elle eut aussi un
autre nom, celui de Zourâ tjjj [oblique]; et ce nom lui
fut donne, suivant quelques auteurs, à cause de la
courbe obliquement sinueuse que forme le fleuve en cet
endroit : mais Abou-l-fedâ loJJI j j | assure que ce nom
venoit plutôt de ce que, l’entrée de ses portes extérieures
ne s alignant pas avec celle de ses portes intérieures, il
falloit se détourner obliquement pour arriver de l’une à
l’autre.
L’emplacement où la ville fut bâtie, s’appeloit anciennement,
en langue Persane, Baghdâd > 1 ) [jardin
de Dâd],parce qu’un Persan nommé Dâd )lj*y possé-
doit un domaine considérable; suivant d’autres, ce lieu
étoit autrefois consacré à une idole appelée Bagh £*
(6) Qasyoun ou Qasyoun 0 ^ 3 fCasius mons].
Il s’étend du nord au midi, du 36.° au 35.® degré de latitude
, le long de la côte de la Méditerranée, depuis l’embouchure
du fleuve Orount Ljj\ [l’Oronte], jusqu’à celle
du fleuve Melek eslL. Pline, I. V, c. 22, a dit, par exagération,
de cette montagne, que-son sommet donne le
spectacle'de la lumière et des ténèbres en aussi peu de
temps qu’il en faut pour se retourner du levant au couchant.
Le Casius est une branche de la chaîne du Liban,
que les Arabes nomment Lebnân yU J : les anciens appe-
loient Casibtide [KaojaTtf] la vallée comprise entre cette
montagne et le mont Pierius.
Suivant A’bd er-Rachyd el-Bakouy, il y a aussi une
autre montagne du même non! en Egypte, à l’orient de
Tyneh AiJâ [Péluse], près de l’ancienne ville connue par
les Arabes sous le nom de Faramâh « L p , et désignée
par les Qobtes sous ceux de Baramias B z -P X ju lü C ,
de Beramrun BEpZ.-Up'ttT, et de Paramoni ïlz-p fc.-
AX OUÏ.
(7) Zyg el-Mâmouny 3j»Ui [Tables d’el-Mâ-
, moun ] : elles furent composées et publiées par Ahmed
beri A’bd-allah, dont j’ai déjà parlé ci-dessus. Ces tables
sont aussi connues sous le nom de Zyg el-Demechqy
JuîuooJî ay [Tables de Damas].
(8) Sahel ben Sâbour ¿ y L ^ II étoit de/-
Ahouazyyi\, et, suivant Abou-l-farag, son langage se .
ressentoit du dialecte de Khouzistan.
(9) El-Kouseg ou el-Kaouseg Suivant le dictionnaire
Arabe d’Isma’yl ben Hamâd el- Giouhary
& Jiouwf, composé vers l’an 390 de l’hégire
[999 de l’ère Chrétienne], et dontGolius a fait un grand
usage pour son Lexicon Arabico-Latinum , ce mot est
synonyme du mot Persan Kouseh , dont il est
forme, et signifie un homme dont la barbe est rare et
peu fournie, comme celle des Uzbeks et des Chinois. '
Megd ed-dyn Mohammed ben Ya’qoub el-Fyroujâbâdy
fr-aJî 0^, auteur
du dictionnaire Arabe intitulé Qâmousjy a'iem èl-loghat
|A» (j (j^y»Lsî [l’Océan de la langue Arabe], dont
j ai rapporté d Egypte un très-bel exemplaire manuscrit,
donne à ce mot une autre acception, rapportée également
par Golius, celle de brèche - dent [ edentulus ].
J’ignore laquelle des deux significations a pu faire attribuer
ce sobriquet à Sahel ben Sâbour.
( 1 o) Gebrâyl J j [Gabriel ].
. (11) £T/-A^z/i<Î/ jUCJf.
' ■ 'Vl ,