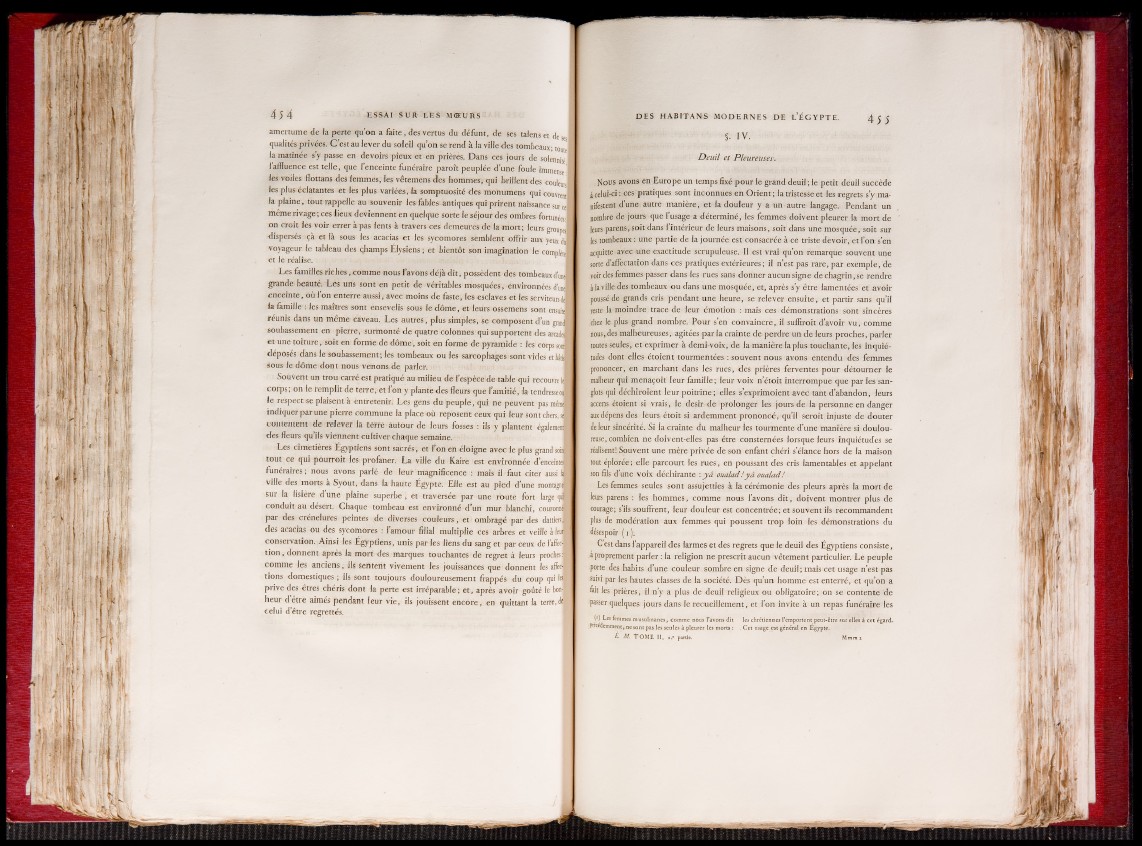
amertume de la perte qu’on a faite, des vertus du défunt, de ses talens et de
qualités privées. C ’est au lever du soleil qu’on se rend à la ville des tombeaux' tout I
la matinée s’y passe en devoirs pieux et en prières. Dans ces jours de solennité I
l’affluence est telle, que l’enceinte funéraire paroît peuplée d’une foule immens 'I
les voiles flottans des femmes, les vétemens des hommes, qui brillent des coulerJ
les plus éclatantes et les plus variées, la somptuosité des monumens qui couvrent!
la plaine, tout rappelle au souvenir les fables antiques qui prirent naissance sur ce!
même rivage ; ces lieux deviennent en quelque sorte le séjour des ombres fortunées!
on croit les voir errer à pas lents à travers ces demeures de la mort; leurs groupe!
dispersés çà et la sous les acacias et les sycomores semblent offrir aux yeux d !
voyageur le tableau des çhamps Élysiens ; et bientôt son imagination le complet!
et le réalise.
Les familles riches, nomme nous l’avons déjà d it , possèdent des tombeaux d’un!
grande beauté. Les uns sont en petit de véritables mosquées, environnées d’un!
enceinte, où l’on enterre aussi, avec moins de faste, les esclaves et les serviteurs!
la famille ; les maîtres sont ensevelis sous le dôme, et leurs ossemens sont ensuii!
réunis dans un même caveau. Les autres, plus shnples, se composent d’un g r a !
soubassement en pierre, surmonté de quatre colonnes qui supportent des arcade!
et une toiture, soit en forme de dôme, soit en forme de pyramide ; les corps son!
déposés dans le soubassement; les tombeaux ou les sarcophages sont vides e tM l!
sous le dôme dont nous venons de parler.
Souvent un trou carré est pratiqué au milieu de l’espèce de table qui recouvre !
corps; on le remplit de terre, et l’on y plante des fleurs que l’amitié, la tendresseo!
le respect se plaisent a entretenir. Les gens du peuple, qui ne peuvent pas mên!
indiquer par une pierre commune la place où reposent ceux qui leur sont ch e r s ,!
contentent de relever la terre autour de leurs fosses : ils y plantent également!
des fleurs qu’ils viennent cultiver chaque semaine.
Les cimetieres Égyptiens sont sacrés, et 1 on en éloigne avec le plus grand s o i !
tout ce qui pourroit les1 profaner. La ville du Kaire est environnée d’enceinte!
funéraires ; nous avons parlé de leur magnificence : mais il faut citer aussi !
ville des morts a Syout, dans la haute Egypte. Elle est au pied d’une montage!
sur la lisière d une plaine superbe , et traversée par une route fort large g !
conduit au desert. Chaque tombeau est environné d’un mur blanchi, couronnB
par des crenelures peintes d e diverses couleurs, et ombragé par des dattiers!
des acacias ou des sycomores : 1 amour filial multiplie ces arbres et veille à leur
conservation. Ainsi les Égyptiens, unis par les liens du sang et par ceux de M e c !
t io n , donnent après la mort des marques touchantes de regret à leurs proches!
comme les anciens, ils sentent vivement les jouissances que donnent les affec*
tions domestiques ; ils sont toujours douloureusement frappés du coup qui les
prive des etres chéris dont la perte est irréparable ; et, après avoir goûté Je hon-H
heur d être aimés pendant leur v ie, ils jouissent encore, en quittant la terre,éefl
celui d’être regrettés.
§. IV .
D eu il et Pleureuses.
Nous avons en Europe un temps fixé pour le grand deuil; le petit deuil succède
à celui-ci: ces pratiques sont inconnues en Orient; la tristesse et les regrets s’y manifestent
d’une, autre manière, et la douleur y a un autre langage. Pendant un
nombre de jours que l’usage a déterminé, les femmes doivent pleurer la mort de
leurs parens, soit dans l’intérieur de leurs maisons, soit dans une mosquée, soit sur
les tombeaux : une partie de la journée est consacrée à ce triste devoir, et l’on s’en
acquitte avec une exactitude scrupuleuse. Il est vrai qu’on remarque souvent une
sorte d’affectation dans ces pratiques extérieures ; il n’est pas rare, par exemple, de
voir des femmes passer dans les rues sans donner aucun signe de chagrin, se rendre
à la ville des tombeaux ou dans une mosquée, et, après s’y être lamentées et avoir
poussé de grands cris pendant une heure, se relever ensuite, et partir sans qu’il
reste la1 moindre trace de leur émotion : mais ces démonstrations sont sincères
chez le plus grand nombre. Pour s’en convaincre, il suffiroit d’avoir vu, comme
nous,des malheureuses, agitées parla crainte de perdre un de leurs proches, parler
toutes seules, et exprimer à demi-voix, de la manière la plus touchante, les inquiétudes
dont elles étoient tourmentées : souvent nous avons entendu des femmes
prononcer, en marchant dans les rues, des prières ferventes pour détourner le
malheur qui menaçoit leur famille; leur voix n’étoit interrompue que par les sanglots
qui déchiroient leur poitrine ; elles s’exprimoient avec tant d’abandon, leurs
accens étoient si vrais, le désir de prolonger les jours de la personne en danger
aux dépens des leurs étoit si ardemment prononcé, qu’il seroit injuste de douter
de leur sincérité. Si la crainte du malheur les tourmente d’une manière si douloureuse,
combien ne doivent-elles pas être consternées lorsque leurs inquiétudes se
réalisent! Souvent une mère privée de son enfant chéri s’élance hors de la maison
tout éplorée; elle parcourt les rues, en poussant des cris lamentables et appelant
son fils d’une voix déchirante : y â oualad!yâ oiialad!
Les femmes seules sont assujetties à la cérémonie des pleurs après la mort de
leurs parens : les hommes, comme nous l’avons d i t , doivent montrer plus de
courage; s ils souffrent, leur douleur est concentrée; et souvent ils recommandent
plus de modération aux femmes qui poussent trop loin les démonstrations du
désespoir ( i ).
C est dans l’appareil des larmes et des regrets que le deuil des Égyptiens consiste,
a proprement parler : la religion ne prescrit aucun vêtement particulier. L e peuple
porte des habits d’une couleur sombre en signe de deuil; mais cet usage n’est pas
suivi par les hautes classes de la société. Dès qu’un homme est enterré, et qu’on a
fait les prières, il n’y a plus de deuil religieux ou obligatoire; on se contente de
passer quelques jours dans le recueillement, et l’on invite à un repas funéraire les
(■) tes femmes musulmanes, comme nous l’avons dit les chrétiennes l’emportent peut-être sur elles à cet égard,
précédemment, ne sont pas les seules à pleurer les morts : . Cet usage est général en Egypte.
É. M. TOM E II, s.= partie. Mmm x