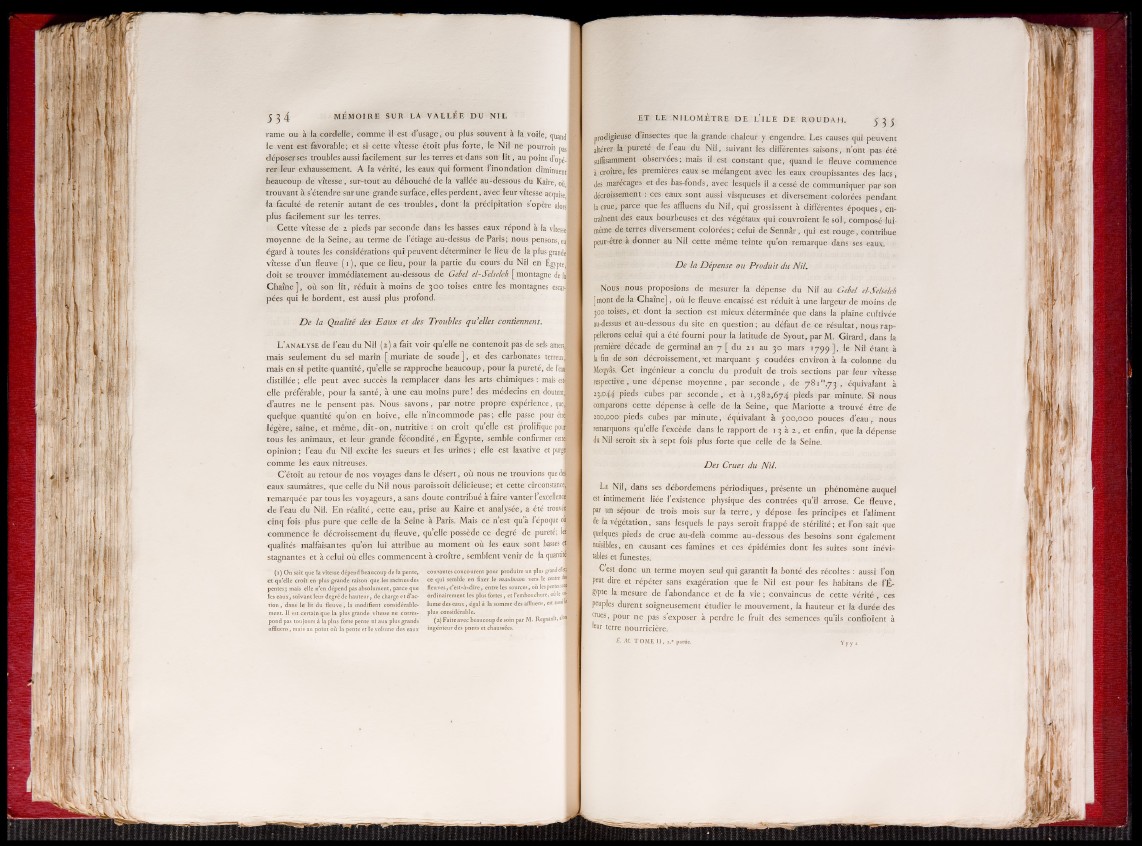
rame ou à la cordelle, comme il est d’usage, ou plus souvent à la voile, quand J
le vent est favorable; et si cette vîtesse étoit plus forte, le Nil ne pourroit pasj
déposer ses troubles aussi facilement sur les terres et dans son l it , au point d’opé-J
rer leur exhaussement. A la vérité, les eaux qui forment l’inondation diminuent!
beaucoup de vîtesse, sur-tout au débouché de la vallée au-dessous du Kaire, où I
trouvant à s’étendre sur une grande surface, elles perdent, avec leur vîtesse acquise |
la faculté de retenir autant de ces troubles, dont la précipitation s’opère alors!
plus facilement sur les terres.
Cette vîtesse de 2 pieds par seconde dans les basses eaux répond à la vitesse!
moyenne de la Seine, au terme de l’étiage au-dessus de Paris; nous pensons,eu!
égard à toutes les considérations qui peuvent déterminer le lieu de la plus grand«
vîtesse d’un fleuve ( 1 ) , que ce lieu, pour la partie du cours du Nil en Egypte!
doit se trouver immédiatement au-dessous de Gebel el-Selseleh [montagne delà!
C h a în e ] , où son lit, réduit à moins de 300 toises entre les montagnes escar!
pées qui le bordent, est aussi plus profond.
D e la Q ualité des E a u x et des Troubles q u ’elles contiennent.
L ’ a n a l y s e de l’eau du Nil ( 2 ) a fait voir qu’elle ne contenoit pas de sels am e n *
mais seulement du sel marin [ muriate de soude ] , et des carbonates terreur*
mais en si petite quantité, qu elle se rapproche beaucoup, pour la pureté, d e l’eai*
distillée ; elle peut avec succès la remplacer dans les arts chimiques : mais esfl
elle préférable, pour la santé, à une eau moins pure! des médecins en d o u te n t*
d’autres ne le pensent pas. Nous savons, par notre propre expérience, que*
quelque quantité qu’on en boive, elle n’incommode pas; elle passe p o u r c t r f l
légère, saine, et même, d it -o n , nutritive : on croit qu’elle est prolifique pool
tous les animaux, et leur grande fécondité, en Egypte, semble confirmer c e t t *
opinion; l’eau du Nil excite les sueurs et les urines; elle est laxative etpurg*
comme les eaux nitreuses.
C ’étoit au retour de nos voyages dans le désert, où nous ne trouvions que de*
eaux saumâtres, que celle du Nil nous paroissoit délicieuse; et cette circonstance*
remarquée par tous les voyageurs, a sans doute contribué à faire vanter 1 excellenc*
de l’eau du Nil. En réalité, cette eau, prise au Kaire et analysée, a été trouvé*
cinq fois plus pure que celle de la Seine à Paris. Mais ce n’est qu’à 1 époque oi||
commence le décroissement du. fleuve, qu’elle possède ce degré de pureté; le®
qualités malfaisantes qu’on lui attribue au moment où les eaux sont basses et
stagnantes et à celui où elles commencent à croître, semblent venir de la quanti*
(1) On sait que la vitesse dépend beaucoup de la pente, courantes concourent pour produire un plus grand cfiet;
et qu’elle crott en plus grande raison que les racines des ce qui semble en fixer le maximum vers le centre d *
pentes; mais elle n’en dépend pas absolument, parce que fleuves, c’est-à-dire, entre les sources, ou les pentes sont
les eaux, suivant leur degré de hauteur, de charge et d’ac- ordinairement les plus fortes, et l’embouchure, ou le v *
tion , dans le lit du fleuve, la modifient considérable- lume des eaux, égal à la nomme des affluens, est auttiH
ment. II est certain que la plus grande vîtesse ne corres- plus considérable. ■
pond pas toujours à la pins forte pente ni aux plus grands (2) Faite avec beaucoup desoin par M. Regnault, aolj
affluens, mais au point où la pente et le volume des eaux ingénieur des ponts et chaussées.
prodigieuse d insectes que la grande chaleur y engendre. Les causes qui peuvent
altérer la pureté de leau du N il, suivant les différentes saisons, n’ont pas été
s u f f i s a m m e n t observées; mais il est constant que, quand le fleuve commence
à croître, les premières eaux se mélangent avec les eaux croupissantes des lacs,
des marécages et des bas-fonds, avec lesquels il a cessé de communiquer par son
décroissement ; ces eaux sont aussi visqueuses et diversement colorées pendant
la crue, parce que les affluens du Nil, qui grossissent à différentes époques, entraînent
des eaux bourbeuses et des végétaux qui couvraient le so l, composé lui-
même de terres diversement colorées ; celui de Sennâr, qui est roug e , contribue
peur-être a donner au Nil cette même teinte qu’on remarque dans ses eaux.
D e la Dépense ou Produit du N i l.
Nous nous proposions de mesurer la dépense du Nil au G e b e l e l-S e ls e le h
[mont de la C h a în e ], où le fleuve encaissé est réduit à une largeur de moins de
300 toises, et dont la section est mieux déterminée que dans la plaine cultivée
au-dessus et au-dessous du site en question; au défaut de ce résultat, nous rappellerons
celui qui a été fourni pour la latitude de Syout, par M. Girard, dans la
première décade de germinal an 7 [ du 21 au 30 mars 1 7 9 9 ] , le Nil étant à
la fin de son décroissement, -et marquant y coudées environ à la colonne du
Meqyâs. Cet ingénieur a conclu du produit de trois sections par leur vîtesse
respective , une dépense moyenne, par se conde , de 7 8 im,7 3 , équivalant à
t3.o44 pieds cubes par seconde , et à 1,382,674 pieds par minute. Si nous
comparons cette dépense à celle de la Seine, que Mariotte a trouvé être de
200,000 pieds cubes par minute, équivalant à y 00,000 pouces d’eau, nous
remarquons quelle l’excède dans le rapport de 13 à 2 , et enfin, que la dépense
du Nil seroit six à sept fois plus forte que celle de la Seine.
D es Crues du N i l.
L e Nil, dans ses débordemens périodiques, présente un phénomène auquel
est intimement liée l’existence physique des contrées qu’il arrose. C e fleuve,
par un séjour de trois mois sur la terre, y dépose les principes et l’aliment
de la végétation, sans lesquels le pays seroit frappé de stérilité; et l’on sait que
quelques pieds de crue au-delà comme au-dessous des besoins sont également
nuisibles, en causant ces famines et ces épidémies dont les suites sont inévitables
et funestes.
Cest donc un terme moyen seul qui garantit la bonté des récoltes : aussi l’on
peut dire et répéter sans exagération que le Nil est pour les habitans de l'Egypte
la mesure de l’abondance et de la vie ; convaincus de cette vérité , ces
peuples durent soigneusement étudier le mouvement, la hauteur et la durée des
erues, pour ne pas s’exposer à perdre le fruit des semences qu’ils confîoient à
'eur terre nourricière.
Ê. M. TOM E I I , a.® partie. Y j y a