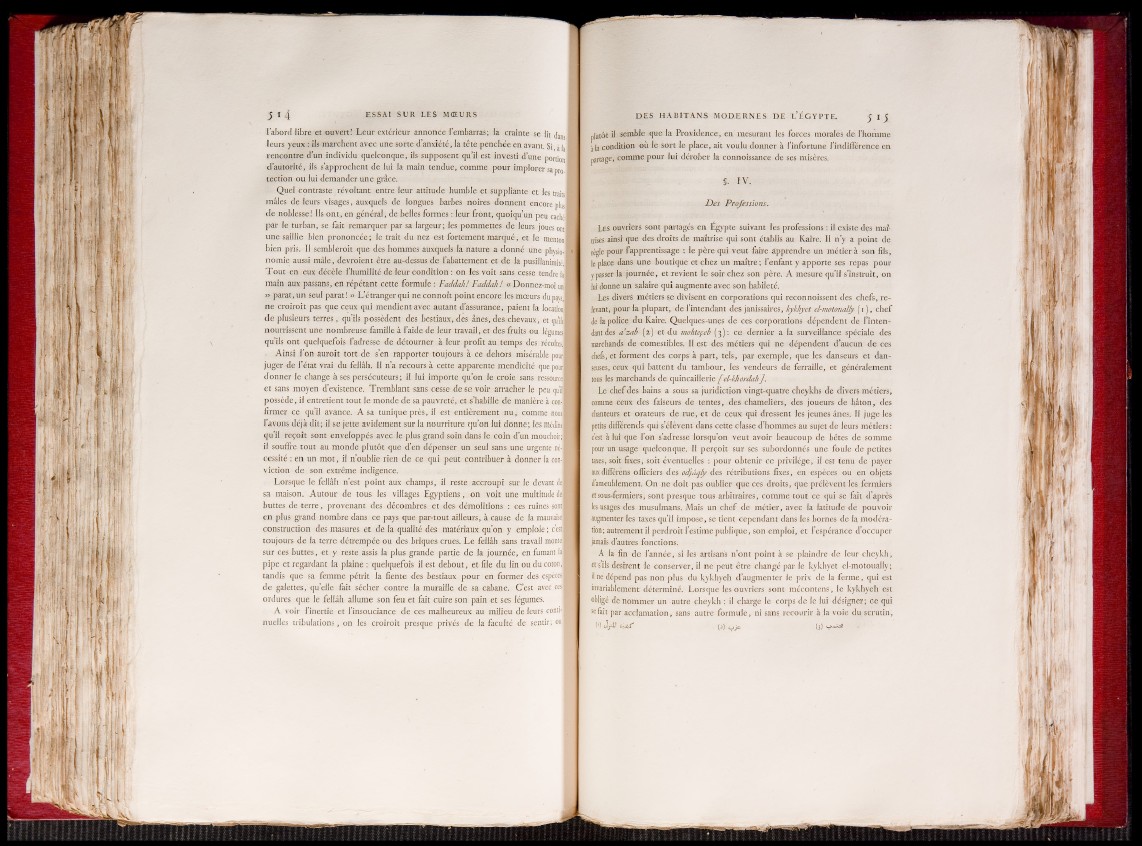
l’aborcl libre et ouvert! Leur extérieur annonce l’embarras; la crainte se lit dai I
leurs yeux : ils marchent avec une sorte d’anxiété, la tête penchée en avant. Si à |al
rencontre d’un individu quelconque, ils supposent qu’il est investi d’une portionI
d’autorité, ils s’approchent de lui la main tendue, comme pour implorer sa pro I
tection ou lui demander une grâce.
Quel contraste révoltant entre leur attitude humble et suppliante et les traits!
mâles de leurs visages, auxquels de longues barbes noires donnent encore p lu s l
de noblesse! Ils ont, en général, de belles formes : leur front, quoiqu’un peu c a c h é !
par le turban, se fait remarquer par sa largeur; les pommettes de leurs joues o n t !
une saillie bien prononcée; le trait du nez est fortement marqué, et le m e n to n !
bien pris. Il semblerait que des hommes auxquels la nature a donné une p h y s io - l
nomie aussi mâle, devroient être au-dessus de l’abattement et de la pusillanimité!
T o u t en eux décèle l’humilité de leur condition : on les voit sans cesse tendre l a !
main aux passans, en répétant cette formule : Faddah! Faddah! «Donnez-moi u n !
» parat,un seul parat ! » L ’étranger qui ne connoît point encore les moeurs du pays!
ne croirait pas que ceux qui mendient avec autant d’assurance, paient la lo c a t io n !
de plusieurs terres, qu’ils possèdent des bestiaux, des ânes, des chevaux, et qu’ils !
nourrissent une nombreuse famille à l’aide de leur travail, et des fruits ou lé g u m e s !
qu’ils ont quelquefois l’adresse de détourner à leur profit au temps des r é c o lt e s .!
Ainsi l’on aurait tort de s’en rapporter toujours à ce dehors misérable p o u r !
juger de l’état vrai du fellâh. Il n’a recours à cette apparente mendicité que p o u r !
donner le change à ses persécuteurs; il lui importe qu’on le croie sans r e s s o u r c e !
et sans moyen d’existence. Tremblant sans cesse de se voir arracher le peu q u i«
possède, il entretient tout le monde de sa pauvreté, et s’habille de manière à c o n - |
firmer ce qu’il avance. A sa tunique près, il est entièrement nu, comme n o u s *
l’avons déjà dit; il se jette avidement sur la nourriture qu’on lui donne; les m c d i n *
qu’il reçoit sont enveloppés avec le plus grand soin dans le coin d’un m o u c h o i r ; !
il souffi-e tout au monde plutôt que d’en dépenser un seul sans une urgente n é !
cessité : en un mot, il n’oublie rien de ce qui peut contribuer à donner la c o n !
viction de son extrême indigence.
Lorsque le fellâh n’est point aux champs, il reste accroupi sur le devant defl
sa maison. Autour de tous les villages Égyptiens, on voit une multitude d e *
buttes de terre, provenant des décombres et des démolitions : ces ruines s o n !
en plps grand nombre dans ce pays que par-tout ailleurs, à cause de la mauvaise!
construction des masures et de la qualité des matériaux qu’on y emploie ; c e s !
toujours de la terre détrempée ou des briques crues. L e fellâh sans travail monte!
sur ces buttes, et y reste assis la plus grande partie de la journée, en fumant l a !
pipe et regardant la plaine ; quelquefois il est debout, et file du lin ou du coton,!
tandis que sa femme pétrit la fiente des bestiaux pour en former des espèces!
de galettes, qu’elle fait sécher contre la muraille de sa cabane. C ’est avec c e s !
ordures que le fellâh allume son feu et fait cuire son pain et ses légumes.
A voir l’inertie et l’insouciance de ces malheureux au milieu de leurs conu-B
nuelles tribulations, on les croiroit presque privés de la faculté de sentir; o n *
plutôt il semble que la Providence, en mesurant les forces morales de l’homme
jja condition où le sort le place, ait voulu donner à l’infortune l'indifférence en
partage, comme pour lui dérober la connoissance de ses misères.
s. IV .
D es Professions.
Les ouvriers sont partagés en Egypte suivant les professions : il existe des maîtrises
ainsi que des droits de maîtrise qui sont établis au Kaire. Il n’y a point de
règle pour l’apprentissage : le père qui veut faire apprendre un métier à son fils,
le place dans une boutique et chez un maître ; l’enfant y apporte ses repas pour
y passer la journée, et revient le soir chez son père. A mesure qu’il s’instruit, on
lui donne un salaire qui augmente avec son habileté.
Les divers métiers se divisent en corporations qui reconnoissent des chefs, relevant,
pour la plupart, de l’intendant des janissaires, kykhyet el-motoually ( i ), che f
de la police du Kaire. Quelques-unes de ces corporations dépendent de l’intendant
des a'zab (2) et du mohtefeb (3): ce dernier a la surveillance spéciale des
marchands de comestibles. Il est des métiers qui ne dépendent d’aucun de ces
chefs, et forment des corps à part, tels, par exemple, que les danseurs et danseuses,
ceux qui battent du tambour, les vendeurs de ferraille, et généralement
tous les marchands de quincaillerie [ el-lhordah].
Le chef des bains a sous sa juridiction vingt-quatre cheykhs de divers métiers,
comme ceux des faiseurs de tentes, des chameliers, des joueurs de bâton, des
chanteurs et orateurs de rue, et de ceux qui dressent les jeunes ânes. Il juge les
petits différends qui s’élèvent dans cette classe d’hommes au sujet de leurs métiers:
c’est à lui que l’on s’adresse lorsqu’on veut avoir beaucoup de bêtes de somme
pour un usage quelconque. Il perçoit sur ses subordonnés une fouie de petites
taxes, soit fixes, soit éventuelles : pour obtenir ce privilège, il est tenu de payer
auxdifférens officiers des odjâqly des rétributions fixes, en espèces ou en objets
d’ameublement. On ne doit pas oublier que ces droits, que prélèvent les fermiers
et sous-fermiers, sont presque tous arbitraires, comme tout ce qui se fait d’après
les usages des musulmans. Aiais un che f de métier, avec la latitude de pouvoir
augmenter les taxes qu’il impose, se tient cependant dans les bornes de la modération;
autrement il perdrait l’estime publique, son emploi, et l’espérance d’occuper
jamais d’autres fonctions.
A la fin de l’année, si les artisans n’ont point à se plaindre de leur cheykh,
et s ils désirent le conserver, il ne peut être changé par le kykhyet el-motoually;
il ne dépend pas non plus du kykhyeh d’augmenter le prix de la ferme, qui est
invariablement déterminé. Lorsque les ouvriers sont mc-contens, le kykhyeh est
obligé de nommer un autre cheykh : il charge le corps de le lui désigner; ce qui
se fait par acclamation, sans autre formule, ni sans recourir à la voie du scrutin,
(0 cïrfl ïtaf" il) , . lit