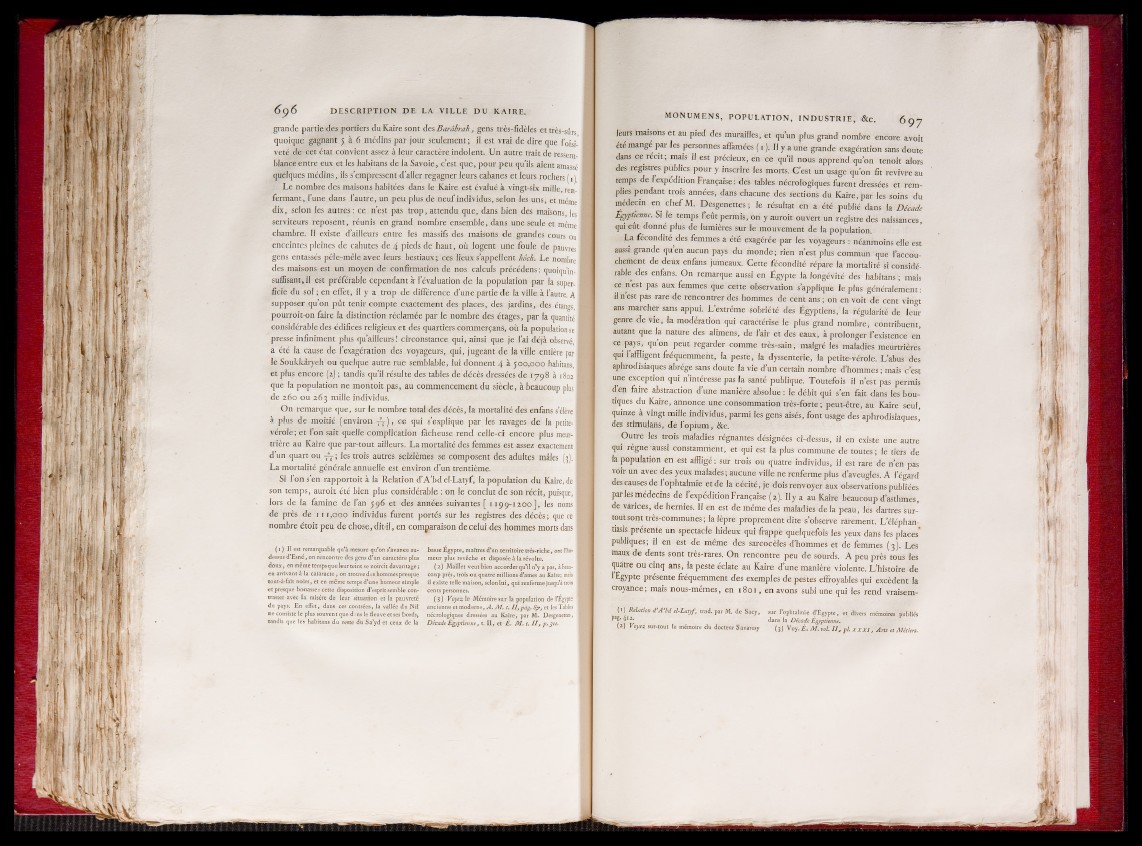
grande partie des portiers du Kaire sont desBarâbrah, gens très-fidèies e t très-sûrs
quoique gagnant 5 à 6 médins par jour seulement ; il est vrai de dire que l’oisj
veté de cet état convient assez à leur caractère indolent. Un autre trait de rèssem
blance entre eux et les habitans de la Savoie, c’est que, pour peu qu’ils aient amassé
quelques médins, ils s’empressent d’aller regagner leurs cabanes et leurs rochers
L e nombre des maisons habitées dans le Kaire est évalué à vingt-six mille, ren_
fermant, l’une dans l’autre, un peu plus de neuf individus, selon les uns, et même
dix, selon les autres: ce n’est pas trop, attendu que, dans bien des maisons les
serviteurs reposent, réunis en grand nombre ensemble, dans une seule et même
chambre. Il existe d’ailleurs entre les massifs des maisons de grandes cours ou
enceintes pleines de cahutes de 4 pieds de haut, où logent une foule de pauvres
gens entassés pêle-mêle avec leurs bestiaux; ces lieux s’appellent hoch. Le nombre
des maisons est un moyen de confirmation de nos calculs précédens: quoiqu'insuffisant,
il est préférable cependant à: l’évaluation de la population par la superficie
du sol ; en effet, il y a trop de différence d’une partie de la ville à l’autre. A
supposer qu’on pût tenir compte exactement des places, des jardins, des étangs
pourroit-on faire la distinction réclamée par le nombre des étages, par la quantité I
considérable des édifices religieux et des quartiers commerçans, où la population se
presse infiniment plus qu’ailleurs! circonstance qui, ainsi que je l’ai déjà observé
a été la cause de l’exagération des voyageurs, qui, jugeant de la ville entière par
le Soukkâryeh ou quelque autre rue semblable, lui donnent 4 à 500,000 habitans, |
et plus encore (2); tandis qu’il résulte des tables de décès dressées de 1798 à 1802
que la population ne montoit pas, au commencement du siècle, à beaucoup plus
de 260 ou 263 mille individus.
O n remarque que, sur le nombre total des décès, la mortalité des enfans s’élève
à plus de moitié (environ t j ) , ce qui s’explique par les ravages de la petite-
vérole; et l’on sait quelle complication fâcheuse rend celle-ci encore plus meurtrière
au Kaire que par-tout ailleurs. L a mortalité des femmes est assez exactement
d’un quart ou 4E-; les trois autres seizièmes se composent des adultes mâles (3).
L a mortalité générale annuelle est environ d’un trentième.
Si l’on s’en rapportoit à la Relation d’A ’bd el-Latyf, la population du Kaire, de
son temps, auroit été bien plus considérable : on le conclut de son récit, puisque,
lors de la famine de l’an 596 et des années suivantes [ 1 19 9 -12 0 0 ] , les noms
de près de 11 1,000 individus furent portés sur les registres des décès ; que ce
nombre étoit peu de chose, dit-il, en comparaison de celui des hommes morts dans
( 1 ) II est remarquable qu’à mesure qu’on s’avance au-
dessus d’Esné, on rencontre des gens d’un caractère plus
doux, en même temps que leur teint se noircit davantage j
en arrivant a la cataracte, on trouve des hommes presque
tout-à-fait noirs, et en même temps d’une humeur simple
et presque bonasse : cette disposition d’esprit semble contraster
avec la misère de leur situation et la pauvreté
du pays. En effet, dans ces contrées, la vallée du Nil
ne consiste le plus souvent que dans le fleuve et ses bords,
tandis que les habitans du reste du Sa’yd et ceux de la
basse Egypte, maîtres d’un .territoire très-riche, ont l’humeur
plus revêche et disposée à la révolte.
(2) Maillet veut bien accorder qu’il n’y a pas, à beaucoup
près, trois ou quatre millions d’ames au Kaire; mais
il existe telle maison, selon lui, qui renferme jusqu’à trois
cents personnes.
(3 ) Voyez le Mémoire sur la population d é l’Egypte
ancienne et moderne, A. M . t. II, pag. 8y, et les Tables
nécrologiques dressées au Kaire, par M. Desgenettes,
Décade Egyptienne, t. I I , e t M. t. I l , p, j//.
leurs maisons ét au pred des murailles, èt qu’un plus grand nombre encore avoit
été mangé par les personnes affamées ( 1 ). I1 y a une grande exagération sans doute
dans ce récit; mais il est précieux, en ce qu’il nous apprend qu’on tenoit alors
des registres publics pour y inscrire les morts. C ’est un usage qu’on fit revivre au
temps de 1 expédition Française: des tables nécrologiques furent dressées et remplies
pendant trois années, dans chacune des sections du Kaire, par les soins du
médecin en ch e f M . Desgenettes ; le résultat en a été publié dans la Décade
Egyptienne. Si le temps l’eût permis, on y auroit ouvert un registre des naissances,
qui eut donné plus de lumières sur le mouvement de la population.
La fécondité des femmes a été exagérée par les voyageurs : néanmoins elle est
aussi grande quen aucun pays du monde; rien n’est plus commun que l’accouchement
de deux enfans jumeaux. Cette fécondité répare la mortalité si considérable
des enfans. O n remarque aussi en Égypte la longévité des habitans ; mais
cé nest pas aux femmes que cette observation s’applique le plus généralement:
il n est pas rare de rencontrer des hommes de cent ans ; on en voit dé cent vingt
ans marcher sans appui. L ’extrême sobriété des Égyptiens, la régularité de leur
genre de v ie , la modération qui caractérise le plus grand nombre, contribuent,
autant que la nature des alimens, de l’air et des eaux, à prolonger l’existence en
cé^pays, qu’on peut regarder comme très-sain, malgré les maladies meurtrières
qui l’affligent fréquemment, la peste, la dyssenterie, la petite-vérole. L ’abus des
aphrodisiaques abrège sans doute la vie d’un certain nombre d’hommes ; mais c’est
une exception qui n’intéresse pas la santé publique. Toutefois il n’est pas permis
d en faire abstraction d une manière absolue : le débit qui s’en fait dans les boutiques
du Kaire, annonce une consommation très-forte ; peut-être, au Kaire seul,
quinze à vingt mille individus, parmi les gens aisés, font usage des aphrodisiaques,
des stimulans, de l’opium, &c.
Outre les trois maladies régnantes désignées ci-dessus, il en existe une autre
qui règne-aussi constamment, et qui est la plus commune de toutes; le tiers de
la population en est affligé : sur trois ou quatre individus, il est rare de n’en pas
voir un avec des yeux malades; aucune ville ne renferme plus d’aveugles. A l’égard
des causes de 1 ophtalmie et de la cécité, je dois renvoyer aux observations publiées
par les médecins de 1 expédition Française (2). Il y a au Kaire beaucoup d’asthmes,
de varices, de hernies. II en est de même des maladies de la peau, lés dartres surtout
sont très-communes; la lèpre proprement dite s’observe rarement. L ’éléphan-
tiasis présente un spectacle hideux qui frappe quelquefois les yeux dans les places"
publiques; il en est de même des sarcocèles d’hommes et de femmes (3). Les
maux de dents sont très-rares. On rencontre peu de sourds. A peu près tous les
quatre ou cinq ans, la peste éclate au Kaire d’une manière violente. L ’histoire de
l’Égypte présente fréquemment des exemples de pestes ef&oyabies qui excèdent la
croyance; mais nous-mêmes, en 18 0 1 , en avons subi une qui les rend vraisem-
(1) Relation d'A’bi el-Latyf, trad. par M. de Sacy, sur l’ophtalmie d’Égypte, et divers mémoires publiés
pag. 412. dans la Décade Egyptienne.
U ) Voyez sur-tout le mémoire du docteur Savaresy (3) Voy. É. M. vol I I, pl. x x x i , Arts et Métiers.