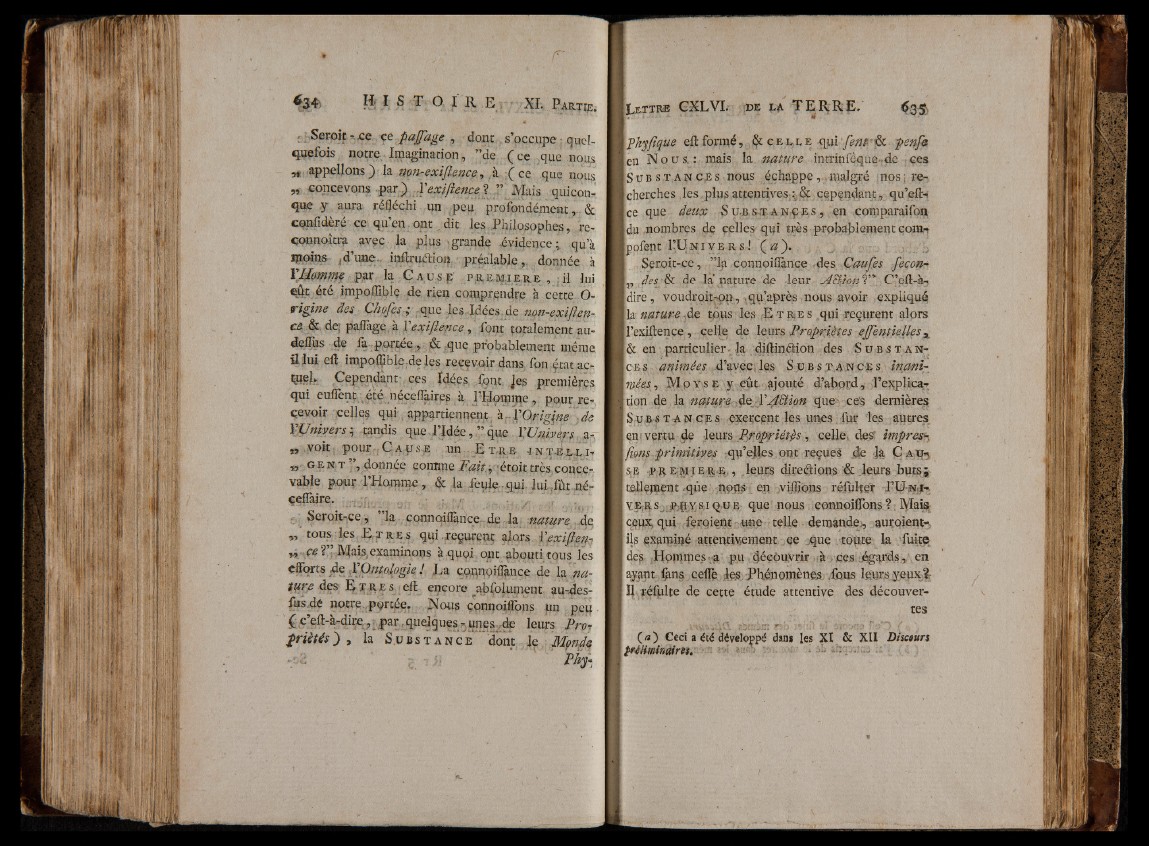
«l Seroit 5 4 e. çe p a fa g e , dont., s'occupe ; quelquefois
notre Imagination, ”de (ce .que nous
m appelions ) la nm-exijlence, ,à ;( ce. que nous
* concevons ^ K ^ X e x iJ k w x . l ’^l^ais qukom
que ,y aura réfléchi un ..peu "^profondément,- &
cpniidèré ce qu’en ont. dit les Philosophes, .reconnaîtra
avec la plus -grande évidence; qua
jp.cùtts jd une., inilruchon ■ préalable,, donnée à
Y J gm m Pa?; la G a u s p ^ e ^ J L r e , ¿ il im
^jt .été ipipoffible de rien comprendre à cette G-
rig in e âes_ Chafesj, : que JLes .-Idées , de n$n-exift.en-
c& &, dej paflàge. a Xexi/iepcey Pont foralement au-
deiTus de ia.:ppi$éq,?i:§t. .que probablement même
£<Iui eii impoi^biede ies reeçyqir daiiS; fon état ac-
©éh Cependant- ces Idées, font. Jes premières
qui enflent ^ pté néçeflàirps tà- r-gpmmre, pour recevoir
celles qqi , appartiennent, ànr O r ig in e ] de
Ypjnivers 5 tandis que d’idée, ” que W m v \r s u a-,
„ v o it . pour .CAps^E un :ETrR.E m J t j t.
70 c e n t ], donnée cointne Fait.-, ’étoit très, concevable
pour l'Homme, & la ièide.qui. lui dut né-
çeflaire. : «■/? .... V 1.-
sj Seroit-ce, ”la connqiflànce- de la nature de
tous les E t re s qqi .reçurent alqrs Yexifîeffî
v> (te ' . .Mais, examinons a quoi, ont abouti tous les
ïK fàto fy ëk / Pa cçmnçhîànce de la.xa-
tW’£ des E r.k s. : cfl encore a-bfolument au-des-
fusde notre „ portée. Nous çonnoiflons un peq
leurs P r$T
p r iè t é s } , la S . ü b s t a n c e "d o n t le Mçn^a
\P h fiq u e cil: formé, c e l l e qui f e n fü c penfa
■en N o u s . mais la nature intrinfèque d e , ces
■S u b s t a n c e s nous é ch ap p e , . malgré ; nos i re-
■cherches les . plus attenrives;^& cependant , qu’eft-î
■ce que deux b u b s t . a n - ç e s , en comparaifon
■du nombres de celles qui très probablement corn«
Ipofent I’U n i v e r s ! ( » ) . , A J : >, 3
S eroit-ce, ’ ’lq .connoiflànce d e s Qaufes feçon-
| 5, Jes/fy. de là nature 'de -leur ABiipn C ’pft-àn
■dire , voudroit^pn, .qu’aprpsnous avoir expliqué
lia nature d e tp.us le s E t r è s qui reçurent alprs
■l’exiftence , celle de leurs Propriétés ejjentiettesx
l& en particulier » la diftinction des 'S u b s t a n -
I c e s \animées d’avec, les S u b s t a n c e s;- in^ni-
Imées, M.p Y\S e y eût. ajouté d’abord, l ’explica?.
Ition de la n a t u r e - A £ i i ° n flue ces dernière^
I S u b s t a n c e s exercent les unes fur des autres
len fv fr tu de leurs.■-Jp£Qp?i4t$sx celle, des’ impresn
YpQnxprim'kives ^ n ’e g e s . on t -reçue! de ja C au-^
IsjE a.R EM1 E n p , , leurs directions de leurs b u ts i
I teMffnent -que nons i en jvilflpns réfuliei -Mlêftfa
I YE(R s3r.ftfey(g(i q u e que nous çonnoiflons ? ; IVIa^
[ceux.qui ferqient une telle demande^ auroient"
[ ils examiné attentivement pe que toute la 'fuit£
[dep. Hommes va p u découvrir à . ces .égards,, .en
[ayjqit. ^n& cefle les) Phénomènes,,fous leurs yeux-?:
I II vréfplte de cette étude attentive des découvertes
( « ) Ceci a été développé dan* les XI & XII Dhctun
préliminaires, «a tsî ? ■ ;. . . .1. ihayaci