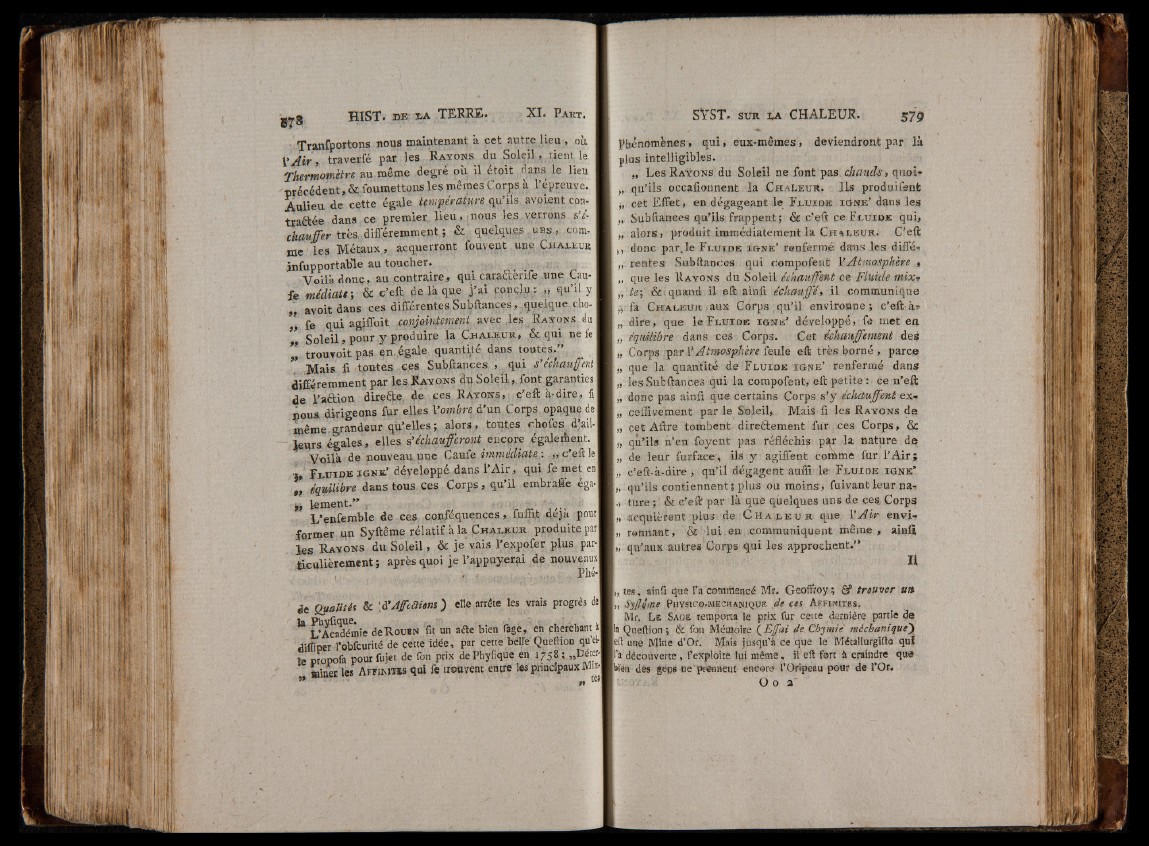
Tranfportons nous maintenant à cet autre lieu , où
Y A i r , traverfé par les R a y o n s du S o le il, tient le
Thermomètre au même degré où il étoit dans le lieu
précédent,& foumettons le? mêmes Corps à l’épreuve.
Aulieu de cette égale température.qu’Ws av.oient ccrn-
traftée dans ce premier lie u , ;nous Ses verrons s’e-
chauffer très, différemment ; & quelques uns, corn-
me les Mé tau x, acquerront fouvent une C h a le u r
jnfupportable au toucher. ^ ^........... ,
Voilà donc, au contraire, qui cara&erife une Cau-
fe médiate ; & c ’ e f t de là que j ’ ai conclu,: „ qu’il y
„ avoit dans ces différentes Subftances, quelque çho-
£e qUj agiffoit conjom tenm i avec les R a yon s , du
' S o le il, pour y produire la C h a le u r , & qui nefe
” trouvoit pas en. égale quantité dans toutes.”
jVIais fi toutes ces Sqbftanqes , qp.i s échauffent.
différemment par les R a y o n s dq S o le îl, font garanties
de l ’ adion directe de ces R a y o n s , c’eft à -dire, fi
nous, dirigeons fur elles Vombre d’ un Corps opaque ce
m ê m e , grandeur qu’ elles y alors, toutes chofes d’ail-
leurs égales, elles s’ échapfferotit epepre égalpthept.
V o ilà de nouveau.une Caufe immédiate : „ c’ eft le
. F lu id e ig n e ’ développé, dans l’A i r , qui fe met en
équilibre dans tous Ces Corps, qu’il embraffe égal
e m e n t . ”
L ’ enfemble de ces conféquences, fuffit déjà po\;r
former un Syftême relatif à la C h a l e u r produite par
le s R a y o n s du S o le il, & je'vais l’expofer plus particulièrement;
après quoi je l’appuyerai de nouveaux
y S B ■ y y B I | piiéj
de Qualités & [à’J fe t lw n ) elle arrête les vrais progrès d
îa Phvfique. ;■■ . ; , , : '
L ’Acadéinie de R ouen fit un a fte bien Page, en cherchant
diiîiper l’obfcurité d e cette id é e , par cette belle Queflion qu’elîe
propofa pour fujet de fon prix dePbyfique en 1758 ; „Dé®
„ miner les A f f in i t é s qui fe trouvent entre les principaux M®
phénomènes, qu i, eux-mêmes, deviendront par là
plus intelligibles.
„ Les R a yo n s du Soleil ne font pas d ia n d s , quoi»
j, qu’ils occaiionnent la C h a l e u r . Ils produifeut
,. cet Effet, en dégageant le F lu id e i g n e ’ dans les
Subftances qu’ ils frappent; & c’eft ce F lu id e qui,
alors, produit immédiatement la C h » e e u r . C’eft
donc par. le F lu id e i g n e ’ renfermé dans les diffé»
rentes Subftances qui compofent Y Atmosphère ,
que les R a y o n s du Soleil échauffent ce Flu id e mix*
‘te", &îquand il eft ainft échauffé, il .communique
fa C h a l e u r aux Corps qu’il enviroupe ; c’eft-à*
dire, que le F lu id e i g n e ’ développé, fe met en
équilibre dans ces Corps. Cet échauffement des
Corps par Y Atmosphère feule eii très borné , parce
que la quantité de F lu id e i g n e ’ renfermé dans
les Subftances qui la compofent, eft petite : ce n’eft
donc pas ainft que certains Corps s’y échauffent ex»
ceifivement par le Soleil,. Mais fi les R a y o n s de
cet Aftre tombent directement fur ces Corps, &
qu’ ils n’en foyent pas réfléchis par la nature de
de leur furface, ils y agiffent corPme fur l’A i r ;
c’eft-à-dire , qu’il dégagent aufli le F lu id e i g n e ’
qu’ils contiennent ; plus ou moins, fuivant leur na-*
tare ; & c’eft par là que quelques uns de ces Corps
acquièrent plus de C h a l e u r que Y A i r envi-r
reunant, <ôc lui en communiquent même , ainû
qu’aux autres Corps qui les approchent.’*
Il
L tes, ainfi que fa commencé Mr. Geoffroy; & trouver utt
y Syjiftne PHYiicorMEèHAMiQUE de ces Affinités.
Mr> Le Sage remporta le prix fur cette dernière partie de
la Queftion; & foti Mémoire ( EJfai de Cbymie méchanique'y
eft une Mine d’Or. Mais jusqu’à ce que le Métallurgifte quf
la découverte, l’exploite lui même, il eft fort à craindre que
bien des gens ne pcenaeut encore1 l’Oripeau pour de l’Or.
O o a '