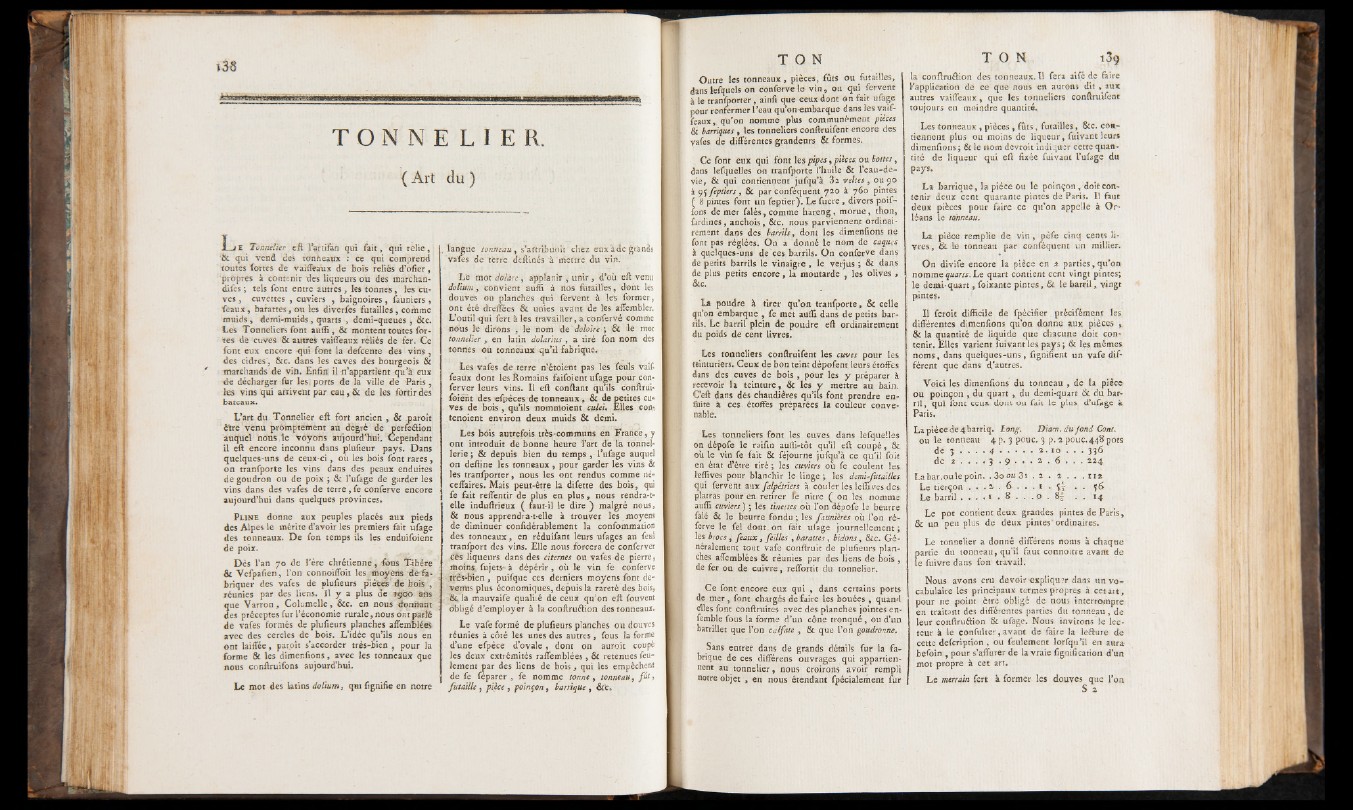
T O N N E L I E R .
( Art du )
L E Tonnelier eft l’arnfan qui fait, qui relie,
qui vend des tdnheatïx : ce qui comprend
toutes fortes de vaiffeaux de bois reliés d’ofier,
propres à contenir des liqueurs où des marchan-
difes ; tels font entre autres, les tonnes, les cuves
, cuvettes , cuviers 9 baignoires , faùniers ,
féaux, barattes , ou les diverfes futailles , comme
muids, demi-muids , quarts , demi-queues , &c.
Les Tonneliers font auffi, & montent toutes fortes
de cuves & autres vaiffeaux reliés de fer. Ce
font eux encore qui font la defcente des vins ,
des cidres, &c. dans les caves des bourgeois &
marchands de vin. Enfin; il -n’appartient qu'à' eux
de décharger für les, ports de la ville de Paris,
les vins qui arrivent par eau, Si de les fôrtir des
bateaux.
L’art du Tonnelier eft fort ancien , & paroît
être venu promptement au degré de perfeôion
auquel nous le Voyons aùjourd*hui. Cependant
il eft encore inconnu dans plufieur pays. Dans
quelques-uns de ceux-ci, où les bois font rares ,
on tranfporte les vins dans des peaux enduites
de goudron ou de poix ; & l’ufage de garder les
vins dans des vafes de terre, fe conferve encore
aujourd’hui dans quelques provinces.
Pline donne aux peuples placés aux pieds
des Alpes le mérite d’avoir les premiers fait ufage
des tonneaux. De fon temps ils les enduifoient
de poix.
Dès l’an 70 de l’ère chrétienne, fous Ifibère
& Vefpafien, l’on connoiffoit les ;moyèns de fabriquer
des vafes de plufieurs pièces’ de bois .,
réunies par des liens. Il y a plus de égo;ô ans
que Varron, Columelle, &c. en nous donnant
des préceptes fur l’économie rurale, nous ont parlé
de vafes formés de plufieurs planches affemblées
avec des cercles de bois. L ’idée qu’ils nous en
ont laiffée, paroît s’accorder très-bien , pour la
forme & les dimenfions, avec les tonneaux que
nous conftruifons aujourd’hui.
Le mot des latins dolium, qui fignifie en notre
langue tonneau, s’attribiioit chez eûx à de grands
vafes de t’erre de fîmes à mettre du vin.
Le mot dolàre, appîanîr , unir, d’où eft venu
dolium, convient auffi à nos futailles, dont les
douves ou planches qui fervent à les former,
ont été dreffées & unies avant de les affembler.
L’outil qui fert à les travailler, a confervé comme
nous le dirons | le nom de 'doloire', & le mot
tonnelier ,; en latin dolarius , a tiré fon nom des
tonnes ou tonneaux qu’ri fabrique.
Les vafes de terre n’étoient pas les fêùls Va if*
féaux dont les Romains faifoient ufage pour con-
ferver leurs vins. Il eft confiant qu’ils conftriii*
foiënt des efpèces de tonneaux, & de petites cuves
de bois , qu’ils uomnioient culei. Elles con*
tenoient environ deux muids & demi.
Les bois autrefois très-communs en France, y
ont introduit de bonne heure l ’art de la tonnellerie
; & depuis bien du temps , l ’ufage auquel
on deftine les tonneaux, pour garder les vins &
les tranfporter, nous les ont rendus comme né-
ceffaires. Mais peut-être la difette des bois, qui
fe fait reffentir de plus en. plus, nous rendra-t-
elle induftrieux ( faut-il le dire ) malgré nous,
& nous apprendra-t-elle à trouver les moyens
de diminuer confidérablement la confommation
des tonneaux, en réduifant leurs ufages au féal
tranfport des vins. Elle nous forcera de conferver
cés liqueurs dans des citernes ou vafes de pierre,
moins, fujets* à dépérir, où le vin fe conferve
très-bien, puifque ces derniers moyens font devenus
plus économiques, depuis la rareté des bois,
la mauvaife qualité de ceux qu’on eft fouvent
obligé d’employer à la conftru&ion des tonneaux.
Le vafe formé de plufieurs planches ou douves
réunies à côté les unes des autres, fous la forme
d’une efpèce d’ovale , dont on auroit coupé
les deux extrémités raffemblées , & retenues feulement
par des liens de bois, qui les empêchent
de fe feparer , fe nomme tonne , tonneau, fût 1
futaille , pièce , poinçon, barrique , & ‘c.
Outre les tonneaux , pièces, fûts ou futailles,
dans lefquels on conferve le v in , ou qui fervent
à le tranfporter, ainfi que ceux dont on fait ufage
pour renfermer l ’eau qu’on embarque dans les yaif-
feaux, qu’on nomme plus communément pièces
& barriques , les tonneliers conftruifent encore des
vafes de différentes grandeurs & formes.
Ce font eux qui font les pipes, pièces ou bottes,
dans lefquelles on tranfporte l’huile & l’eau-de-
vie, & qui contiennent jufqu’à 3æ veltes , ou 90
à 95 feptiers , & par eonféquent 720 à 760 pintes
( 8 pintes font un feptier). Le fucre, divers poif-
lons de mer falés,comme hareng, morue, thon,
fardines, anchois, &c. nous parviennent ordinairement
dans des barrils, dont les dimenfions ne
font pas réglées. On a donné le nom de caques
à quelques-uns de ces barrils. On conferve dans
de petits barrils le vinaigre, le verjus ; & dans
de plus petits encore, la moutarde , les olives ,
&c.
La poudre à tirer qu’on tranfporte, & celle
qu’on embarque , fe met aùffi dans de petits barrils.
Le barril plein de poudre eft ordinairement
du poids de cent livres.
Les tonneliers conftruifent les cuves pour les
teinturiers. Ceux de bon teint dépofent leurs étoffes
dans des cuves de bois , pour les y préparer à
recevoir la teinture, & les y mettre au bain.
Ç’eft dans dès chaudières qu’ils font prendre en-
fuite à ces étoffes préparées la couleur convenable.
Les tonneliers font les cuves dans lefquelles
on dèpofe le raifin auffi-tôt qu’il eft coupé, &
où le vin fe fait & féjourne jufqu’à ce qu’il foit
en état d’être tiré ; les cuviers où fe coulent les.
leffives pour blanchir le linge ; les demi-futailles
qui fervent aux falpétriers à couler les leflives des
platras pour en retirer fe nitre ( on les nomme
auffi cuviers,) ; les tinettes où l’on dépofe le beurre
falé & le beurre fondu ; les fiunières où l’on ré-
ferve le fel dont-on fait ufage journellement;
les brocs , féaux, fêilles , barattes, bidons, &c. Généralement
tout vafe conftruit de plufieurs planches
affemblées & réunies par des liens de bois ,
de fer ou de cuivre, reffortit du tonnelier.
Ce font encore eux qui , dans certains ports
de mer , font chargés de faire les bouées , quand
elles font conftruites avec des planches jointes en-
femble fous la forme d’un cône tronqué, ou d’un
barrillet que l’on calfate , & que l’on goudronne.
Sans entréf dans de grands détails fur la fabrique
de ces différens ouvrages qui appartiennent
au tonnelier, nous croirons avoir rempli
notre objet , en nous étendant fpécialement fur
la conftruélion des tonneaux. Il fera aifé de faire
l’application de ce que nous en aurons dit , aux
autres vaiffeaux, que les tonneliers conftruifent
toujours en moindre quantité*
Les tonneaux , pièces, fûts, futailles, &c. contiennent
plus ou moins de liqueur, fuivant leurs
dimenfions ; & le nom devroit indiquer eette quantité
de liqueur qui eft fixée fuivant L’ufage du
pays.
La barrique, la pièce ou le poinçon, doit contenir
deux cent quarante pintes de Paris. Il faut
deux pièces pour faire ce qu’on appelle à Orléans
le tonneau.
La pièce remplie de v in , pèfe cinq cents livres,
& le tonneau par eonféquent un millier.
On divife encore la pièce en tt parties, qu’on
nomme quarts. Le quart contient cent vingt pintes;
le demi-quart, foixante pintes, & le barril,. vingt
pintes.
Il feroit difficile de fpécifier précifément les
différentes dimenfions qu’on donne aux pièces
& la quantité de liquide que chacune doit contenir.
Elles varient fuivant les pays ; & les mêmes
noms, dans quelques-uns, figninent un vafe différent
que dans d’autres.
Voici les dimenfions du tonneau , de la pièce
ou poinçon du quart , du demi-quart Ôç du barril,
qui font ceux dont on fait le plus d’ufage à
Paris.
Lapiècede4barriq. Long. Diam. du fond Cont.
ou le tonneau 4 p. 3 pouc. 3 p. 2 pouc. 448 pots
de 3 . . . . 4 ..............2 . 1 0 . . . 3 36
de 2 9 . . . 2 . 6 . . . 224
Labar.oulepoin. . 3o o « 3 i . 2 . 2 . . .1 1 2
Le tierçon . . . 2 . 6 . . . i .
Le barril . . . . 1 . 8 . . . o . . . 14
Le pot contient deux grandes pintes de Paris,
& un peu plus de deux pintes* ordinaires.
Le tonnelier a donné différens noms à chaque
partie du tonneau, qu’il faut connoitre avant de
le fuivre dans fon travail.
Nous avons cru devoir expliquer dans un vocabulaire
les principaux termes propres a cet art,
pour ne point être obligé de nous interrompre
en traitant des différentes parties du tonneau, de
leur conftrudion & ufage. Nous invitons le lecteur
à le confulter, avant de faire la leélure de
cette defeription, ou feulement lorfqu’il en aura
befoin , pour s’^ffurer de la vraie fignification d’un
mot propre à cet art.
Le merrain fert à former les douyes que l’on
S a