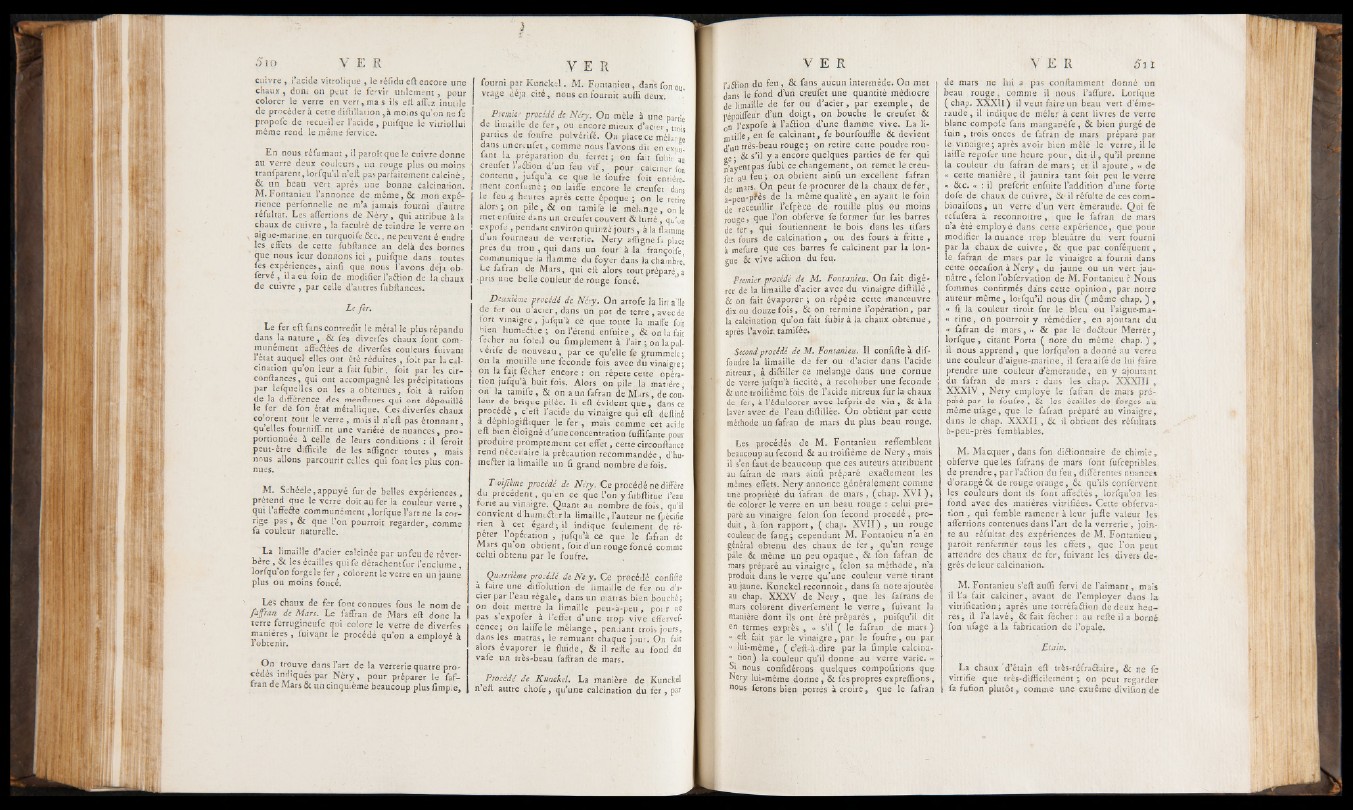
»
cuivre , i’âctde vitrolique , le réfidu eft encore une
chaux , dom on peut fe fervir utilement, pour
colorer le verre en v ert, ma s ils elt affez inutile
de procéder à cette diftillation ,à moins qu’on ne fe
propofe de recueilier l’acide , puifque le vitriol lui
même rend le même fervice.
En nous réfumant, il paroît que le cuivre donne
au verre deux couleurs, un rouge plus ou moins
tranfparent, lorfqu’il n’eft pas parfaitement calciné,
& un beau vert après une bonne calcination.
M. Fontanieu l’annonce de même, & mon expérience
perfonnelle ne m’a jamais fourni d’autre
réfultat. Les affertions de N é ry , qui attribue à la
chaux de cuivre , la faculté de teindre le verre on
aigue-marine, en turquoife & c ., ne peuvent é endre
les effets de cette fubftance au delà des bornes
que nous leur donnons i c i , puifque dans toutes
fes expériences, ainfi que nous l’avons déjà ob-
fervé, il a eu foin de modifier l’a&ion de la chaux
de cuivre , par celle d’autres fubftances.
Le fer.
Le fer eft fans contredit le métal le plus répandu
dans la nature , & fes diverfes chaux font communément
affe&ées de diverfes couleurs fuivant
l’état auquel elles ont été réduites , foit par la calcination
qu’on leur a fait fubir, foit par les cir-
confiances, qui ont accompagné les précipitations
par lefquelles on les a.obtenues, foit à raifon
de la différence des menftrues qui ont -dépouillé
le fer de fon état métallique. Ces diverfes chaux
colorent tout le verre, mais il n’eft pas étonnant,
quelles fourniff-nt une variété de nuances, proportionnée
a celle de leurs conditions : il feroit
peut-etre difficile de les affigner toutes , mais
nous allons parcourir celles qui font les plus con- ;
nues.
M. Scheele, appuyé fur de belles expériences ,
prétend que le verre doit au fer la couleur verte ,
qui l’affede communément, lorfque l’art ne la corrige
pas , & que l’on pourroit regarder, comme
fa couleur naturelle.
La limaille d’acier calcinée par un feu de réverbère
, & les écailles qui fe detachentfur l’enclume,
lorfqu’on forge le fer , colorent le verre en un jaune
plus ou moins foncé.
Les chaux de fer font connues fous le nom de
fatfran de Mars. Le faffran de Mars eft donc la
terre ferrugineufe qui colore le verre de diverfes
manières , fuivant le procédé qu’on a employé à
l’obtenir. :
On trouve dans l’art de la verrerie quatre procèdes
indiques par Né ry, pour préparer le faffran
de Mars & un cinquième beaucoup plus fimpie,
fourni par Kunckel. M. Fontanieu, dans fon ou,
vrage déjà cité, nous en fournit aufli deux.
Premier procédé de Néry. On mêle à une partie
de limaille de fer, ou encore mieux d’acier, trois
parties de foufre pulvérifé. On place ce mélange
dans un creufet, comme nous l’avons dit enexuo-
fant la préparation du ferret ; on fait fubir au I
creufet l’adion d’un feu v if , pour calciner fon
contenu, jufqu’à ce que le foufre foit entièrement
confumc ; on laiffe encore le creufet dans I
le feu 4 heures après cette époque ; on le retire
alors ; on pile, & on tamife le mélange, on le
met enfuite dans un creufet couvert & lutté , qu’un I
expofe , pendant environ quinze jours, à la flamme
d’un fourneau de verrerie. Nery afligne fa place
prés du trou , qui dans un four à la françoife, I
communique la flamme du foyer dans la chambre.
Le fafran de Mars, qui eft alors tout préparé a
-pris une belle couleur de rouge foncé. 1
Deuxième procédé de Néry. On arrofe la lin aile
de fer ou d’acier, dans un pet de terre , avec de i
fort vinaigre, jufqu’à ce que toute la maffe foit
bien humedée ; on l’étend enfuite , & on la fait
fécher au foleil ou Amplement à l’air ; on lapul-
vérife de nouveau, par ce qu’elle fe grummele;
on la mouille une fécondé fois avec du vinaigre;
pn la fait fecher encore : on répété cette opération
jufqu’à huit fois. Alors on pile la matière,'
i on la tamife, & on a un fafran de M<<rs, de couleur
de brique pilée. Il eft évident que, dans ce
procédé , c’eft l’acide du vinaigre qui eft deftiné
^n^P^^°,^^;i<î uer ^er > mais comme cet acide
eft bien éloigné d’une concentration fuffifante pour
produire promptement cet effet, cette circonftance I
rend néceilaire la précaution recommandée , d’hu-
mefter la limaille un fi grand nombre de fois.
Troijîeme procédé de Néry. Ce procédé ne diffère
du précédent, qu'en ce que l’on y fubftitue l’eau
forte au vinaigre. Quant au nombre de fois , qu’il f
convient d'humtébr la limaille, l’auteur ne fpécifie
rien a^cet egard; il indique feulement de répéter
1 operation , jufqu’à ce que le fafran de
Mars qu on obtient, foit d’un rouge foncé comme
celui obtenu par le foufre.
Quatrième procédé de N e r y . Ce procédé confiée
à faire une diffolution de limaille de fer ou d’acier
par l’eau régale, dans un matras bien bouché;)
on doit mettre la limaille peu-à-peu , pour ne
pas s expofer à l’effet d’ une trop vive effervef-
cence; on laiffe le mélange, penoant trois jours,
dans les matras, le remuant chaque jour. On fait
alors évaporer le fluide, & il refte au fond du
vafe un très-beau faffran de mars.
t Procédé de Kunckel. La manière de Kunckel
n’eft autre chofe, qu’une calcination du fe r , par
l’adion du feu, & fans aucun intermède. On met
dans le fond d’un creufet une quantité médiocre
de limaille de fer ou d’acier, par exemple, de
pépaiffeur d’un doigt, on bouche le creufet &
on l’expofe à l’adion d’une flamme vive. La limaille,
en fe calcinant , fe bourfouffle & devient
d’un très-beau rouge ; on retire cette poudre rou-
e • & s’il y a encore quelques parties de fer qui
payent pas fubi ce changement, on remet le creu-
fe t aufeu; on obtient ainfi un excellent fafran
de mars- Peut fe procurer de la chaux dé fe r ,
^.pgu-pfès de la même qualité , en ayant le foin
de receuillir l’efpèce de rouille plus ou moins
rouee > l’on obferve fe former fur les barres
de fer , qui foutiennent le bois dans les tifars
des fours de calcination , ou des fours à fritte ,
à mefure que ces barres fe calcinent par la longue
& vive adion du feu.
Premier procédé de M. Fontanieu. On fait digérer
de la limaille d’acier avec du vinaigre diftillé ,
& on fait évaporer ; on répète cette manoeuvre
dix ou douze fois , & on termine l’opération, par
la calcination qu’on fait fubir à la chaux obtenue,
après ravoiCv tamifée.
Second procédé de M. Fontanieu. Il confifte à dif-
foudre la limaille de fer ou d’acier dans l’acide
nitreux, à diftiller ce mélange dans une cornue
de verre jufqu’à ficcité, à recohober une fécondé
& une troifième fois de l’acide nitreux fur la chaux
de fer, à l’édulcorer avec lefprit de vin , & à la
laver avec de l’eau diftillée. On obtient par cette
méthode un fafran de mars du plus beau rouge.
Les procédés de M. Fontanieu reffemblent
beaucoup au fécond & au troifième de Ne ry, mais
il s’en faut de beaucoup que ces auteurs attribuent
au fafran de mars ainfi préparé exadement les
mêmes, effets. Nery annonce généralement comme
une propriété du fafran de mars , (chap. XVI ) ,
de colorer le verre en un beau rouge : celui préparé
au vinaigre félon fon fécond procédé , produit
; à fon rapport, (chap. XVII) , un rouge
couleur.de fang; cependant M. Fontanieu n’a en
général obtenu des chaux de fe r , qu’un rouge
pâle & même un peu opaque, & fon fafran de
mars préparé au vinaigre , félon sa méthode, n’a
produit dans le verre qu’une couleur verte tirant
au jaune. Kunckel reconnoit, dans fa note ajoutée
au chap. XXXV de Nery , que les fafrans de
mars colorent diverfement le verre , fuivant la
manière dont ils ont été préparés , puifqu’il dit
en termes exprès , « s’il ( le fafran de mars )
« eft fait par le vinaigre, par le fo u fr e o u par
“ lui-même, ( .c’eft-à-dire par la fimpie calcina-
« tion) la couleur qu’il donne au verre varie. ||
Si nous confidérons quelques compofitions que
Nery lui-même donne, & fes propres expreffions,
nous ferons bien portés à croire , que le fafran
de mars ne lui a pas conftamment donné un
beau rouge, comme il nous i’aflure. Lorfque
(chap. XXXÏI) il veut faire un beau vert d’émeraude
, il indique de mêler à cent livres de verre
blanc compofe fans manganéfe, & bien purgé de
fuin , trois onces de fafran de mars préparé par
le vinaigre ; après avoir bien mêlé le verre, il le
laiffe repofer une heure pour, dit i l , qu’il prenne
la couleur du fafran de mars; et il ajoute, « de
« cette manière, il jaunira tant foit peu le verre
« &c. «c : il preferit enfuite l’addition d’une forte
dofe de chaux de cuivre, &■ il réfulte de ces com-
binaifons, un verre d’un vert émeraude. Qui fe
refufera à reconnoitre , que le fafran de mars
n’a été employé dans cette expérience, que pour
modifier la nuance trop bleuâtre du vert fourni
par la chaux de cuivre, & que par conféquent,
le fafran de mars par le vinaigre a fourni dans
cette occafion à Ne ry, du jaune ou un vert jaunâtre
, félon l’obfervation de M. Fontanieu ? Nous
fommes confirmés da'ns cette opinion, par notre
auteur même, lorfqu’il nous dit ( même chap. ) ,
« fi la couleur tiroit fur le bleu ou l’aigue-ma-
« rine, on pourroit y remédier, en ajoutant du
« fafran de mars, «« & par le dodeur Merret,
lorfque, citant Porta ( note du même chap. ) ,
il nous apprend, que lorfqu’on a donné au verre
une couleur d’aigue-marine, il feraaiféde lui faire
prendre une couleur d’émeraude, en y ajoutant
du fafran de mars : dans les chap. XXXIII ,
XXXIV , Nery employé le fafran de mars préparé
par le foufre , & les écailles de forges au
même ufage, que le fafran préparé au vinaigre,
dans le chap. X X X I I , & il obtient des réfultats
à-peu-près femblables.
M. Macquer, dans fon di&ionnaire de chimie ,
obferve que les fafrans de mars font fufcepribles,
de prendre, par l’adion du feu, différentes nuances
d’orangé St de rouge orange, & qu’ils confervent
les couleurs dont ils font affeélés, lorfqu’on les
fond avec des matières vitrifiées. Cette obferva-
tion, qui femble ramener à leur jufte valeur les
affertions contenues dans l’art de la verrerie , jointe
au réfultat des expériences de M. Fontanieu ,
paroit renfermer tous les effets , que l’on peut
attendre des chaux de fer, fuivant les divers degrés
de leur calcination.
M. Fontanieu s’eft auffi fervi de l’aimant, mais
il Fa fait calciner, avant de l’employer dans la
vitrification ; après une torréfadion de deux heures,
il l’a lavé, & fait fécher: au refte il a borné
fon ufage à la fabrication de l’opale.
Etain.
La chaux d’étain eft très-rèfradraire, & ne fe
vitrifie que très-difficilement : on peut regarder
fa fufion plutôt, comme une extrême divifion de