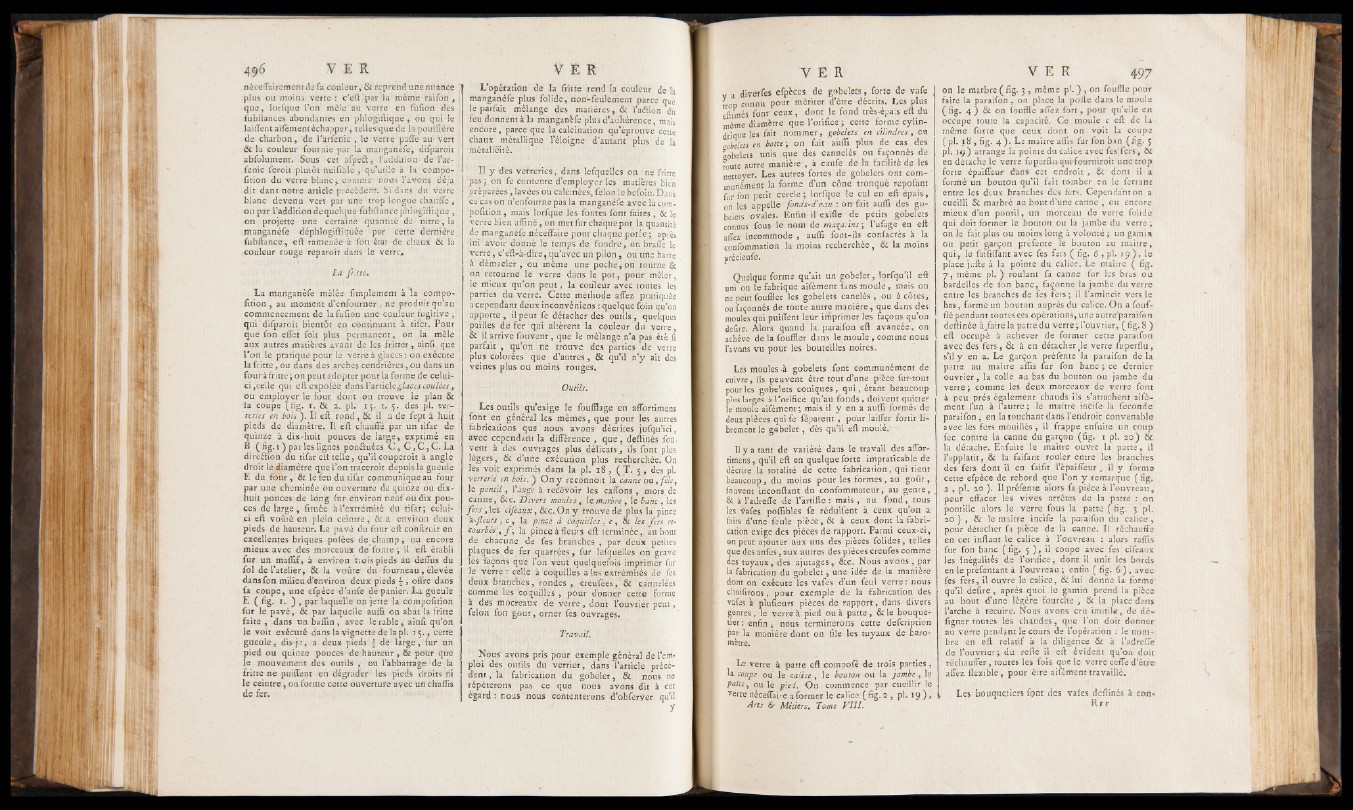
néceffairemem de fa couleur, & reprend une nuance
plus ou moins verte-: c’eft par la même raifon ,
que, lorfque l’on mêle au verre en fufion des
fubftances abondantes en phlogiftique, ou qui le
laiffent aifémentéchapper, telles que de la pouïiière
de charbon, de Tarfenic , le verre pafle au- vert
& la couleur fournie par la mangahèfe, difparoit
abfolumenr. Sous cet a fp e â, Faddition- de l’ar-
fenic feroit plutôt nuifible , qu’utile à la compo-
fition du verre blanc N comme fions l’avons déjà
dit dans notre article précédent. Si dans du verre
blanc devenu vert par une trop longue chauffe,
ou par l’addition de quelque fübflance phlogiftique ,
on projette une certaine' quantité de nitre,la
manganèfe déphlogiftiquée par cette dernière,
fubftance, eft ramenée à fon état de chaux & la
couleur rouge reparoîr dans le verre*
La fritte.
La manganèfe mêlée Amplement à la compo-
fxtion , au moment d’enfourner , ne produit qu’au
commencement de la fufion une couleur fugitive ,
qui difparoît bientôt en continuant à tifer. Pour
que fon effet foit plus permanent, on la mêle
aux autres matières avant de les fritter, ainfi que
l*on le pratique pour le verre à glaces : on exécute
la fritte, ou dans des arches cendrières, ou dans un
four à fritte’; on peut adopter pour la forme de celui-
ci,celle qui eftexpofée dans Partiel& glaces coulées 3
ou employer le four dont on trouve le plan &
la coupe (fig. x. & 2. pl. 15. t. 5. des pl. verreries
en bois ). Il eft rond, & il a de fept à huit
pieds de diamètre. Il eft chauffé par un tifar de
quinze à dix-huit pouces de large, exprimé en
B ( fig. i ) par les lignes ponctuées C , C , C , C. La
direéHon du tifar elt telle, qu’il couperoit à angle
droit le diamètre que l’on traceroit depuis la gueule
E du fôïir , & le feu du tifar communique au four
par une cheminée ou ouverture de quinze ou dix-
huit pouces de long fur environ neuf ou dix pouces
de la rge, fituée à l’extrémité du tifar; celui-
ci eft voûté en plein ceintre, & a environ deux
pieds de hauteur. Le pavé du four eft conftruit en
excellentes briques pofées de champ, ou encore
mieux avec des morceaux de fonte ; il eft établi
fur un maftif, à environ trois pieds au deffus du
fol de l’atelier, & la voûte du fourneau, élevée
dans fon milieu d’environ deux pieds offre dans
fa coupe, une efpèce d’anfe de panier. La gueule
E ( fig. 1. ) , par laquelle on jette la compofition
fur le pavé, & par laquelle aufti on abat la fritte
faite , dans un baflin , avec le rable, ainfi qu’on
le voit exécuté dans la vignette de la pl. 15 ., cette
gueule, dis-je, a deux pieds \ de large, fur un
pied ou quinze pouces de hauteur, & pour que
le mouvement des outils, ou l’abbattage-de lia
fritte ne puiffent en dégrader les pieds droits ni
le ceintre, on forme cette ouverture avec un chaflis
de fer.
L’opération de la fritte rend la couleur de la
manganèfe plus folide, rion-feülement parce que
le parfait mélange des matières, & l’aélion du
feu donnent à la manganèfe plus d’adhérence, mais
encore, parce que la calcination qu’éprouve cette
chaux métallique l’éloigne d’autant plus de la
métallëitè.
Il y des verreries, dans Iefquelles on ne fritte
pas; on fe contente d’employer les matières bien
préparées, lavées ou calcinées, félon le befoin. Dans
ce cas on n’enfourne pas la manganèfe avec la com-
pofition , mais lorfque les fontes font faites , & le
verre bien affiné, on met fur chaque pot la quantité
de mangapèfe néceffaire pour chaque potée ; après
lui avoir donné le temps de fondre, on braffe le
verre, c’eft-à-dire, qu’avec un pilon, ou une barre
à démacler , ou même une poche, on tourne &
on retourne le verre dans le pot, pour mêler,
le mieux qu’on peut, la couleur avec toutes les
parties du verre. Cette méthode affez pratiquée
a cependant deux inconvéniens : quelque foin qu’on
apporte , il peut fe détacher des outils , quelques
pailles de fer qui altèrent la couleur du verre,
& il arrive fouvent, que le mélange n’a pas été fi
parfait , qu’on ne trouve des parties de verre
plus colorées que d’autres, & qu’il n’y ait des
veines plus ou moins rouges.
Outils.
Les outils qu’exige le foufflage en affortimens
font en général les mêmeis, que pour les autres
fabrications que nous avon$- décrites jufqu’ici,
avec cependant la différence , que, deftinés foui
vent à des ouvrages plus délicats , ils font plus
légers, & d’une exécution plus recherchée. On
les voit exprimés dans la pl. 18 , ( T. 5, des pl.
verrerie en bois. ') O n y rëconnoît la canne ou, fele,
le ipontil, \'àuge à recevoir les caffons , mors de
canne, &c. Divers moules, le marbre , le banc , les
fers , les cifeaux, Sec. On y trouve de plus la pince
à\fleurs , c , la pince a coquilles , e , & les fers recourbés',
ƒ ; la pince à fleurs eft terminée, au bout
de chacune de fes branches , par deux petites
plaques de fer. quarrées, fur Iefquelles on grave
les Façons que l’on veut quelquefois imprimer fur
le verrç: céllè à coquilles a les extrémités de fes
deux branchés, rondes creufées, & cannelées
comme les coquilles , pour donner cette forme
à des mocreàux de verre, dont l’ouvrier peut,
félon fon goût, orner fes ouvrages.
Travail.
Nous avons pris pour exemple général de l’emploi
dés outils du verrier, dans l’article précédent,
la fabrication du gobelet, & nous ne
répéterons pas ce que nous avons dit à cet
égard : nous nous contenterons d’obferver qu’il I ■ y
y a diverfes efpèces de gobelets, forte de vafe
trop connu pour mériter d’être décrits. Les plus
eftimés fonr ceux, dont le fond très-épais eft du
même diamètre que l’orifice ; cette forme cylindrique
les fait nommer, gobelets en cilindres, ou
gobelets en botte ; on fait aùfli plus de cas des
gobelets unis que des cannelés ou façonnés de
toute autre manière , à caufe de la facilité de les
nettoyer. Les autres fortes de gobelets ont communément
la forme d’un cône tronqué repofant
fur fon petit cercle; lorfque le cul en eft épais,
on les appelle fonds-d'eau : on fait aufti des gobelets
ovales. Enfin il exifte de petits gobelets
connus fous le nom de m a r in s , l’ufage en eft
aflèz incommode , aufti font-ils contactés à la
confommation la moins recherchée, & la' moins
précieufe.
Quelque forme qu’ait un gobelet, lorfqu’il eft
uni on le fabrique aifément fans moule, mais on
ne peut fouffler les gobelets canelés , ou à côtes,
ou façonnés de toute autre manière, que dans des
moules qui puiffent leur imprimer les façons qu’on
defire. Alors quand la. paraifon eft avancée, on
achève de la fouffler dans le moule, comme nous
l’avons vu pour les bouteilles noires.
Les moules à gobelets font communément de
cuivre, ils peuvent être tout d’une pièce fur-tout
pour les gobelets coniques, qui, étant beaucoup
plus larges à l’orifice qu’au fonds , doivent quitter
le moule aifément; mais il y en a aufti formés de
deux pièces qui fe féparent , pour laiffer fortir librement
le gobelet, dès qu’il eft moulé.
Il y a tant de variété dans le travail des affortimens
, qu’il eft en quelque forte impraticable de
décrire la totalité de cette fabrication, qui tient
beaucoup, du moins pour les formes, au goût,
fouvent inconftant du confommateur, au genre ,
& à l’adreffe de l’àrtifte : mais , au fond, tous
les Ÿafes poflibles fe réduifent à ceux qu’on a
faits d’une feule pièce, & à ceux dont la fabrication
exige des pièces de rapport. Parmi ceux-ci|
on peut ajouter aux uns des pièces folides, telles
que des anfes, aux autres des pièces creufes comme
des tuyaux, des ajutages, &c. Nous avons, par
la fabrication dû gobelet, une idée de la manière
dont on exécute les vafes d’un feul verre: nous-
choifirons, pour exemple de la fabrication des
vafes à plufieurs pièces de rapport, dans divers
genres , le verre à pied ou à patte, & le bouque-
tier : enfin , nous terminerons 'cette defeription
par la manière dont on file les tuyaux de baromètre.
Le verre à patte eft compofé de trois parties,
la coupe ou le calice , le bouton ou la jambe, 1?
patte, ou le pied. On commence par cueillir le J
verre néceffaire a former le calice ( fig. 2 , pl. 19 ) * i
Arts & Métiers, Tome V lll.
on le marbre ( fig. 3 , même pl. ) , on fouffle pour
faire la paraifon, on place la polie dans le moule
( fig. 4 ) & on fouffle affez fort, pour qu’elle en
occupe toute la,capacité. Ce moule c eft de la
même forte que ceux dont on voit la coupe
( pl. 18 , fig. 4 ). Le maître a {fis fur fon ban (fig. 5
pl. 10) arrange la pointe du calice avec fes;fers, &
en détache le verre fuperflu qurfoùrniroit une trop
forte épaiffeur dans cet endroit , & dont il a
formé un bouton qu’il fait tomber en le ferrant
entre les deux branches des fers. Cependant on a
cueilli & marbré au bout d’une canne , ou encore
mieux d’un pontil, un morceau de verre folide'
qui doit former le bouton ou la jambe du verre ;
on le fait plus ou moins long à volonté ; un garnis
ou petit garçon préfente le bouton au maître,
qui, le faififfant avec fes fers ( fig. 6 , pl. 1 9 ) , le
place jtîfte à la pointe du calice. Le maître ( fig.
7 , même pl.).roulant fa canne fur les bras ou
bardelles de fon banc, façonne la jambe du verre
entre les branches de fes fers ; il l’amincit vers le
bas, forme un bouton auprès du calice. On a fouf-
flé pendant toutes ces opérations, une autreparaifon
deftinée à/aire la patte du verre; l’olivrier, (fig. 8 )
eft occupé à achever de former cette paraifon
avec des fers , & à en détacher Je verre fuperflu,
s’il y en a. Le garçon préfente la paraifon de la
patte au maître aflis fur fon banc ; ce dernier
ouvrier, la colle au bas du bouton ou jambe du
verre; comme les deux morceaux de verre font
à peu près également chauds ils s’attachent aifément
l’un à l’autre ; le maître incife la fécondé
paraifon , en la touchant dans l’endroit convenable
avec les fers mouillés, il frappe enfuite un coup
fec contre la canne du garçon (fig. 1 pl. 20) &
la détache. Enfuite le maître ouvre la patte, il
l’applatit, & la faifant rouler entre les branches
des fers dont il en faifit l’épaiffeur f il y forme
cette efpèce de rebord que l’on y remarque ( fig,
2 , pl. 20 ). Il préfente alors fa pièce à l’ouvreau,
pour effacer les vives arrêtes de la patte : on
pontille alors le verre fous la patte ( fig. 3 pl.
20 ) , & le maître incife la paraifon du calice,
pour détacher fa pièce de la canne. Il réchauffe
en cet inftant le calice à l’ouvreau : alors rafiis
fur fon banc (fig. 5 ) , il coupe avec fes cifeaux
les inégalités de l’orifice, dont il unit les bords
en le préfentant à l’ouvreau ; enfin ( fig. 6 ) , avec
fes fers, il ouvre le calice, & lui donne la forme
qu’il defire, après quoi le gamin prend la pièce
au bout d’une légère fourche , & la place dans
l’arche à recuire. Nous avons cru inutile, de dé-
figner toutes les chaudes, que l ’on doit donner
au verre pendant le cours de l’opération : le nombre
en eft relatif à la diligence & à l’adreffe
de l’ouvrier; du refte il eft évident qu’on doit
réchauffer, toutes les fois que le verre ceffe d’être
affez flexible, pour être aifément travaillé.
Les bouquetiers font des vafes deftinés â con-
R r r