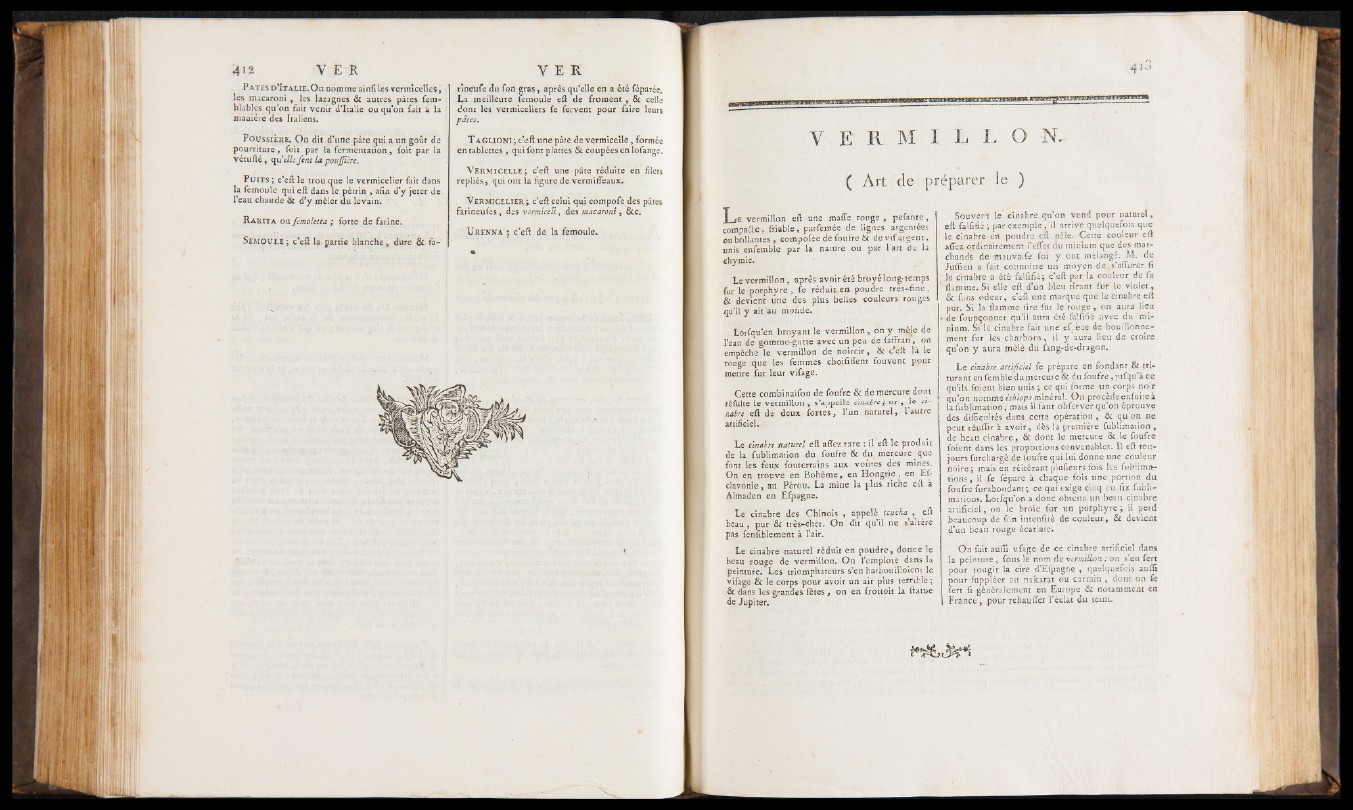
•412 V E R
Pâtes d’Italie. On nomme ainfi les vermicelles l les macaroni , les lazagnes & autres pâtes fem-
blables qu’on fait venir d’Italie manière des Italiens. ou qu’on fait à la
Pôussïère. On dit d’une pâte qui a un goût de
vpéotuurfrtiétu, rqeu, foit par la fermentation, foit par la 'elle fient la poujjîère.
P uits ; c’eft le trou que le vermicelier fait dans
la femoule qui eft dans le pétrin , afin d’y jeter de
l’eau chaude ôc d’y mêler du levain. r
Rarita ou femoletta ; forte de farine.
Sem oule; c’eft la partie blanche, dure 6c fa-
V E E
rïneirfe du fon gras, après qu’elle en a été féparée.
La meilleure femoule eft de froment , & celle
dont les vermiceliers fe fervent pour faire leurs
p â te s .
T aglioni ; c’eft une pâte de vermicelle, formée
en tablettes , qui font plattes 6c coupées en lofange.
V ermicelle ; c’eft une pâte réduite en filets
repliés, qui ont la figure de vermiffeaux.
V ermicelier ; c’eft celui qui compofe des pâtes
farineufes, des v e rm ic e li, des m a c a r o n i, 6cc.
Urenna ; c’eft de la femoule.
V E R M I L L O N.
( Art de préparer le )
T it vermillon eft une malTe rouge , pefante,
compacte, friable, parfemée de lignes argentées
ou brillantes , compofée de foufre 6c de vif argent,
unis enfemble, par la nature ou par l’art de la
chymie.
Le vermillon, après avoir été broyé long-temps
fur le porphyre , fe réduit en poudre très-fine,
& devient une des plus belles couleurs rouges
qu’il y ait au monde.
Lorfqu’en broyant le vermillon, on y mêle de
l’eau de gomme-gutte avec un peu de faffran, on
empêche le vermillon de noircir, 8c c’eft là le
rouge que les femmes choififfent fouvent ppur
mettre fur leur vifage.
Cette combinaifon de foufre 6c de mercure dont
rèfulte le vermillon , s’appelle cinabre ; or , le c inabre
eft de deux fortes, l’un naturel, l’autre
artificiel.
Le cinabre n a tu r e l eft affez rare : il eft le produit
de la fublimation du foufre ôc du. mercure que
font les feux fouterrains aux voûtes des mines.
On en trouve en Bohême, en Hongrie, en Efi
clavonie, au Pérou. La mine la plus riche eft à
Almaden en Efpagne.
Le cinabre des Chinois , appelé tcu ch a , eft
beau , pur 6c très-cher. On dit qu’il ne s’altère
pas fenfiblement à l’air.
Le cinabre naturel réduit en poudre, donne 1e
beau rouge de vermillon. On l’emploie dans la
peinture. Les triomphateurs s’en barbouilioiem le
vifage 6c le corps pour avoir un air plus terrible ;
6c dans les grandes fêtes, on en frottoh la ftatue
de Jupiter.
Souvent le cinabre qu’on vend pour naturel,
eft fa 1 fi fié ; par exemple, il arrive quelquefois que
le cinabre en poudre eft pâle- Cette couleur eft
affez ordinairement l’effet du minium que des marJcuhfafniedus
ad ef aimt acuovrmaifoeî trfeo iu ny monoty emn élangé. M. de de s’affurer fi
le cinabre a été falfifié; c’eft par la couleur de fa
flamme. Si elle eft d’un bleu tirant fur le violet 9
6c fans odeur, c’eft une marque que le cinabre eft
pur. Si la flamme tire fur le rouge , on aura lieu
■ ndeiu mfo.u Spiç olen ncienra qbure’i lf aaiut ruan éet ée fffa èlfciefi éd ea vbeocu idlluo nmneiment
fur les charbons-, il y aura lieu de croire
qu’on y aura mêlé du fang-de-dragon.
Le cinabre a r tif ic ie l fe prépare en fondant 8c triturant
en femble du mercure & du foufre, jufqu’à ce
qquu’’iolsn fnooiemnmt bei en unis; ce qui forme un corps noir é th io p s minéral. On procède enfuire à
la fublimation ; mais il faut obferver qu’on éprouve
pdeeus td irféfuicfulilrt éàs advaonisr ,c edttèes loap pérreamtioiènr e, fôucb lqimu'aotnio nn e,
de beau cinabre, & dont le mercure 6c le foufre
foient dans les proportions convenables. Il eft toujours
furebargé de foufre qui lui donne une couleur
noire; mais en réitérant plufieurs fois les fobhma-
tions, il fe fépare à chaque fois line portion du
foufre fur abondant; ce qui exige cinq eu fix fubli-
mations. Lorfqu’on a donc obtenu.un beau cinabre
artificiel, on le broie fur un porphyre ; il perd
beaucoup de fon intenfité de couleur, 6c devient
d’un beau rouge écarlate.
On fait aufiî ufage de ce cinabre artificiel dans
la peinture, fous le nom de v e rm illo n : on s’en fert
pour rougir la cire d’Efpagne , quelquefois auffi
pour fuppléer au nakarat ou carmin , dont on fe
fert fi généralement en Europe 6c notamment en
I France, pour rehauffer l’éclat du teint.