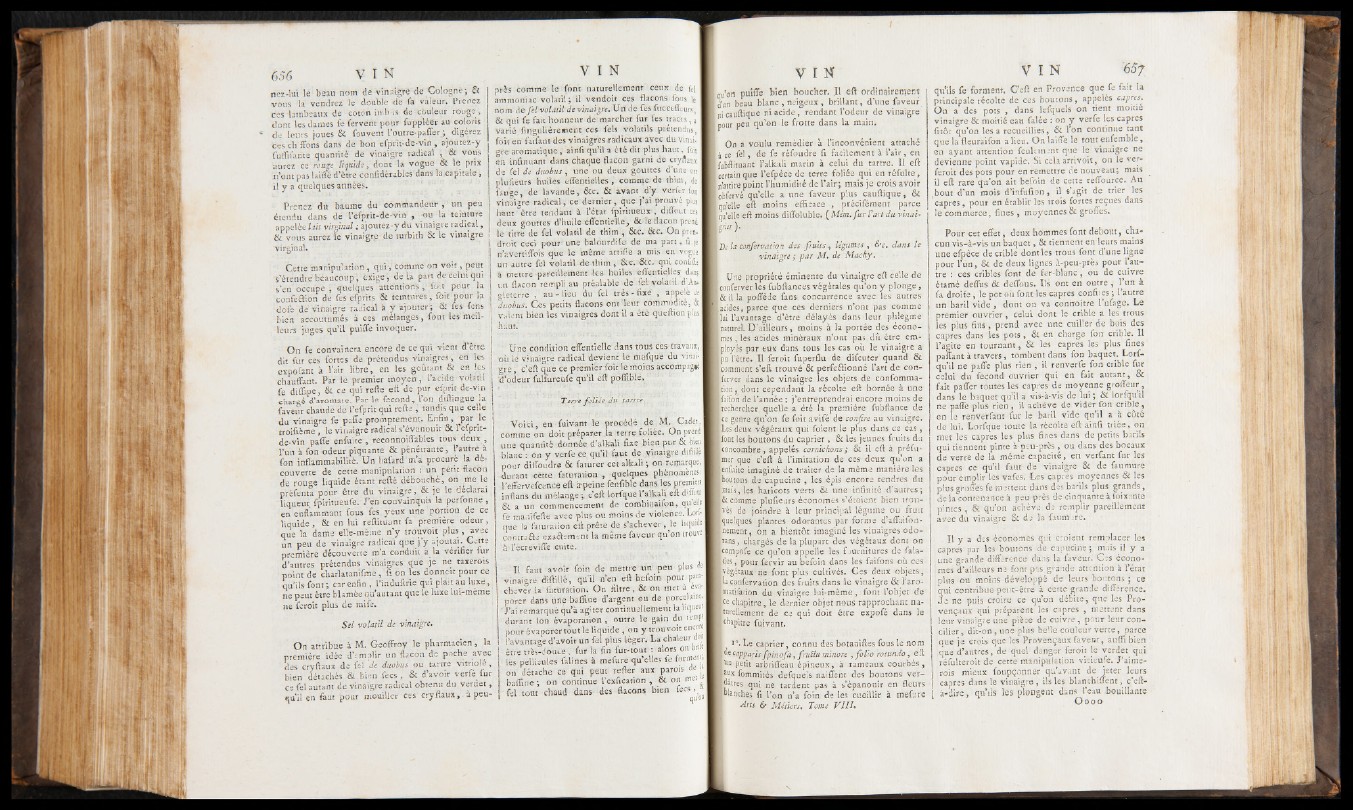
nez-lui le beau nom dé vinaigre de Cologne; Si
vous la vendrez le double de fa valeur. Prenez
ces 'lambeaux de coton in-b îs de couleur rouge ,
dont les dames fe fervent pour fuppléèr au coloris
de leurs joues & fouvent l’outre-paffer ■; digérez
ces ch ffons dans de bon el prit-de-vin , ajoutez-y ,
fuffifahte quantité de vinaigre radical , & vous ;
aurez ce rouge liquide, dont la vogue & le prix
n’ont pas laiiïé d’être confidérables dans la,capitale -,
il y a quelques années.
Prenez du baume du commandeur , un peu
étendu dans de l’efprit-de-vin , ou là teinture
appelée lû t virginal ; ajoutez-y du vinaigre radical,
& vous aurez le vinaigre de turbith & le vinaigre >
virginal.
Cette manipulation, qui, comme on v o it, peut
s’étendre beaucoup, èxige j de la part de celui qui
s’en’ occupe , quelques attentions , fôit pour la
confe&ion de fes efprits & teintures , Toit pour h il
dofe dé vinaigre radical à y ajouter ; & fes feins
bien accoutumés à ces mélanges , font les meil- |
leurs juges qu’il puivfe invoquer.
On fe convaincra encore de ce qui vient d’être
dit fur ces fortes de prétendus vinaigres, en les >
expofant à l'air libre, en les goûtant & en les I
chauffant. Par le premier moyen , 1 acide volatil
fe diffipe, & ce qui refte eft de pur efpn-t de-vin
chargé d’aromate. Par le fécond, l’on diftingue la
faveur chaude de l’efprit qui refte , tandis que celle
du vinaigre fe paffe promptement. Enfin, par Je
troifièroe , le vinaigre radical s’évanouit & 1 efprit-
de-vin paffe enfuite, reconnoiffables tous deux ,
l’un à fon odeur piquante & pénétrante, l’autre à
fon inflammabilité. Un hafard m’a procure la découverte
de cette manipulation : un petit flacon
de rouge liquide étant reftè débouché, on me le
préfenta pour être du vinaigre, & je le déclarai
liqueur fpiritueufe. J’en convainquis la perfonne ,
en enflammant fous fes yeux une portion de ce
liquide, & en lui reftituant fa première odeur,
que la dame elle-même n’y trouvoit plus, avec
un peu de vinaigre radical que j’y ajoutai. Cette
première découverte m’a conduit à la vérifier fur
d’autres prétendus vinaigres que je ne taxerois
point de charlatanifme, fi on les donneit pour ce
qu’ils font; car enfin , l’induftrie qui plaît au luxé,
ne peut être blâmée qu’autant que le luxe lui-meme
ne feroit dIus de mife.
Sel volatil de vinaigre.
On attribue à M. Geoffroy le pharmacien, la
première idée d’emplir un flacon de poche avec
des cryftaux de fel de duobus ou tartre vitriole,
bien détachés & bien fecs , & d’avoir verfè fur
ce fel autant de vinaigre radical obtenu du veraet,
qu’il en faut pour mouiller ces cryftaux, -à peuprés
comme le font naturellement ceux de fel
ammoniac volatil; il vendoit ces flacons, fous le
nom de fel volatil de vinaigre. Uri de fes fucceffeurs,
& qui fe fait honneur de marcher fur fes tracts, a
varié, fingulièrement ces fels volatils prétendus,
fok en faifant des vinaigres radicaux avec du vinaigre
aromatique , ainfi qu’il a été dit plus haut, iou
eh infinuant dans chaque flacon garni de crydaux
de fel de duobus, une ou deux gouttes d’une ou
plufiéurs huiles effentielles , comme de thim, .de |
fauge, de lavande, &c. & avant d’y verftr fon
vinaigre radical j ce dernier, que j’ai prouvé plus
haut "être tendant à l’état fpiritueüx , diffot.t ces
deux gouttes d’huile effentiellèj & le flacon prend
le titré de fel volatil de thim , &c. &c. On pren-
droit ceci pour une balourdif© de ma part, u je
n’averti {Fois que le même àrtifle a mis. en1', vogue i
un autre fel volatil de thim , &c. &c. qui, conlifte
à mettre pareilleinent 4es huiles e ffe n tie lle s ' dans
un flacon rempli au préalable de fet volatil d'An*
gleterre , au - lieu du fel très - fixe' , appelé ic
duobus. Ces petits flacons ont leur commodité, &
valent bien les vinaigres dont il a été queftion plus
haut.
Une condition effentielle dans tous ces travaux,
où lé vinaigre radical devient le mafque du vinaigre
, c’eft que ce premier foit le moins àccompagié
d’odeur fulfureüfe qu’il eft poffiblê,
T erre foliée du tartre.
Vo ic i, en fuivant le procédé de M. Cadet,!
comme on doit préparer .la terre foliée. On prend
une quantité donnée d’alkali fixe bien pur & hig j
blanc : on y v.erfe ce qu’il faut de vinaigre dimll?
pour diffoudre & faturer cet alkali ; on remarque,
durant cette faturation , quelques phénomènes:
l ’effervefcence eft irpeine fenfible dans, les premiers
inftans du mélange c’eft lorfque l’alkaU eft dffiout |
& a un commencement de combinaifon, quelle
fe mahifefte avec plus ou moins de violence. Lon-
que la faturation eft prête de s’achever, le liquide
contra&e exaélement la même faveur qu’on trouve
à-Tècreviffe cuite.
Il faut avoir foin de mettre lin* peu plus *
vinaigre diftillé, qu’il n’en eft befom pour p«»'
chever la faturation. On filtre, & on met à eva-
porer dans une bafîine d’argent ou de porcelaine.
'J ’ai remarqué qu’à agiter continuellement la liqueur
durant fon évaporation , outre le gain du temps
pour évaporer tout le liquide, on y trou voit encore
' l’avantage d’avoir un fel plus léger. La chaleur do>
être très-douce , fur la fin fur-tout : alors on bru
• lés pellicules falines à mefure qu’elles fe formenjj
on détache ce qui peut refter aux parois de *
b affine ; on continue l’exfication , & on met
fel tout chaud dans des flacons bien fecs, : vf ; , • ' * • qil 0»
I qu’on puiffe bien boucher. .Il eft ordinairement
■ d’un beau blanc, neigeux, brillant, d’une faveur
Ijncauftique ni acide, rendant l’odeur de vinaigre
■ pour peu qu’on le frotte dans la main.
I On a voulu remédier à l’inconvénient attaché
1 à ce fel, de fe réfoudre fi facilement à l’air, en
Ifabftituant l’alkali marin à celui du tartre. Il eft I certain que l’efpèce de terre foliée qui en réfulte, In’attire point l’humidité de l’air; mais je crois avoir
lobfervé qu’elle a une faveur plus cauftique, &
■ qu’elle eft moins efficace , précifément parce
■ qu’elle eft moins diffoluble. ( Mém.fur l'art du vinai-
prit*)., :
U De la confervatiqn des fruits, légumes , &c. dans le
vinaigre ; par M. de Machy.
K Une propriété éminente du vinaigre éft celle de
■ conferver les fubftances végétales qu’on y plonge,
I & il la poflede fans concurrence avec les autres
■ acides, parce que ces derniers n’ont pas comme
■ lui l’avantage d’être délayés dans leur phlegme
■ naturel. Dailleurs, moins à la portée des écono-
■ mes, les acides minéraux n’ont pas dû être em-
■ ployés par eux dans tous les cas où le vinaigre a
■ pu l’être. Il feroit fuperflu de difeuter quand &
■ comment s’eft trouvé & perfeâionné l’art de con-
■ ferver dans, le vinaigre les objets de confomma-
I tion ; dont cependant la récolte eft bornée à une
P faifon de l’année ; j’entreprendrai encore moins de
■ rechercher quelle a été la première fubflance de
h ce genre qu’on fe foit avifé de confire au vinaigre.
■ Les deux végétaux qui foient le plus dans ce cas ,
■ ont les boutons du câprier , & les jeunes fruits du
■ concombre, appelés cornichons ; & il eft à préfu1-
■ mer que c’eft à l’imitation de ces* deux qu’on a
■ enfuite imaginé de traiter de la même manière les
■ boutons de capucine , les épis encore tendres du
■ maïs, les haricots verts & une infinité d’autres;
■ & comme plufiéurs économes s’étoient bien trou-
■ vés de joindre à leur principal légume ou fruit
■ quelques plantes odorantes par forme d’affaifon-
p nement, on a bientôt imaginé les vinaigres odo-
■ ians, chargés de la plupart des végétaux dont on
compofe ce qu’on appelle les f jurnitures de fala-
I des, pour (ervir an befoin dans les faifons où ces
■ végétaux ne font plus cultivés. Ces deux objets j
■ la confervation des fruits dans le vinaigre & l’aro-
■ matifatiôn du vinaigre lui-mêmefont l’objet de
■ ce chapitre, le dernier objet nous rapprochant na-
Hturellement de ce qui doit être expofé dans le
■ chapitre fuivant.
I i°. Le câprier, connu des botaniftes fous le nom
■ de cappafis fpinofa, fruElu minore , folio rotundo, eft
■ un petit arbriffeau épineux, à rameaux courbés,
»aux fommités defqueis naiffent des boutons ver-
Idâtres qui ne tardent pas à s’épanouir en fleurs
blanches fi l’on n’a foin de les cueillir à mefure
Arts 6* Métiers, T om e VIII.
qu’ils fe forment. C ’eft en Provence que fe fait la
principale récolte de ces boutons, appelés câpres.
On a des pots , dans lefquels on tient moitié
vinaigre & moitié eau falée : on y verfe les câpres
fitôt qu’on les a recueillies, & l’on continue tant
que la fleuraifon a lieu. On laifle le tout enfemble,
en ayant attention feulement que le vinaigre ne
devienne point vapide. Si cela arrivoit, on le ver-
feroit des pots pour en remettre de nouveau; mais
il eft rare qu’on ait befoin de cette reflource. Au
bout d’un mois d’infufion, il s’agit de trier les
'câpres, pour en établir les trois fortes reçues dans
le commerce, fines , moyennes & groffes.
Pour cet effet, deux hommes font debout, chacun
vis-à-vis un baquet, & tiennent enieurs mains
une efpèce de crible dont les trous font dune ligne
pour l’un, & de deux lignes à-peu-près pour 1 autre
.* ces cribles font de fer-blanc, ou de cuivre
étamé deffus & deffous. Ils ont en outre , l’un à
fa droife, le pot où font les câpres confites ; l’autre
un baril vide , dont on va conrroître l’ufage. Le
premier ouvrier, celui dont le crible a les trous
les plus fins, prend avec une cuiller de bois des
câpres dans .les pots , & en charge fon crible. Il
l’agite en tournant, & les câpres les plus fines
paffan-t à travers, tombent dans fon baquet. Lorf-
■ qu’il ne paffe plus rien , il renverfe fon crible fur
celui du fécond ouvrier qui en fait autant, &
fait paffer toutes les câpres de moyenne groffeur,
dans le baquet qu’il a vis-à-vis de lui; & lorfquil
ne paffe plus rien, il achève de vider fon crible,
en le renverfant fur le baril vide qu’il a a cote
de lui. Lorfque toute la récolte eft ainfi triée, on
met les câpres les plus fines dans de petits barils
qui tiennent pinte à-peu-près , ou dans des bocaux
de verre de la même capacité, en verfant fur les
câpres ce qu’il faut de vinaigre & de faumure
pour emplir les vafes. Les câpres moyennes & les
plus greffes fe mettent dans des barils plus grands,
de la contenance à peu-près de cinquante à foixante
pintes , & qu’on achève de remplir pareillement
avec du vinaigre & de la faumerc.
Il y a des économes qui croient remplacer les
câpres par les boutons de capucine; mais il y a
une grande différence dans la faveur. Ces économes
d’ailleurs ne font pas grande attention à l’état
plus ou moins développé de leurs boutons ; ce
qui contribue peut-être à cette grande différence.
Je ne puis croire ce qu’on débite , que les Provençaux
qui préparent les câpres , mettent dans
leur vinaigre une pièce de cuivre, pour leur concilier,
dit-on, une plus belle couleur verte, parce
que je crois que les Provençaux fa vent, auffi bien
.que d’autres, de quel danger feroit le verdet qui
réfulteroit de cette manipulation vicieufe. J’aime-
rois mieux foupçonner qu’avant de jeter leurs
câpres dans le vinaigre, ils les blanchiffent, c’eft-
à-dire, qu’ils les plongent dans l’eau .bouillante
O o o o