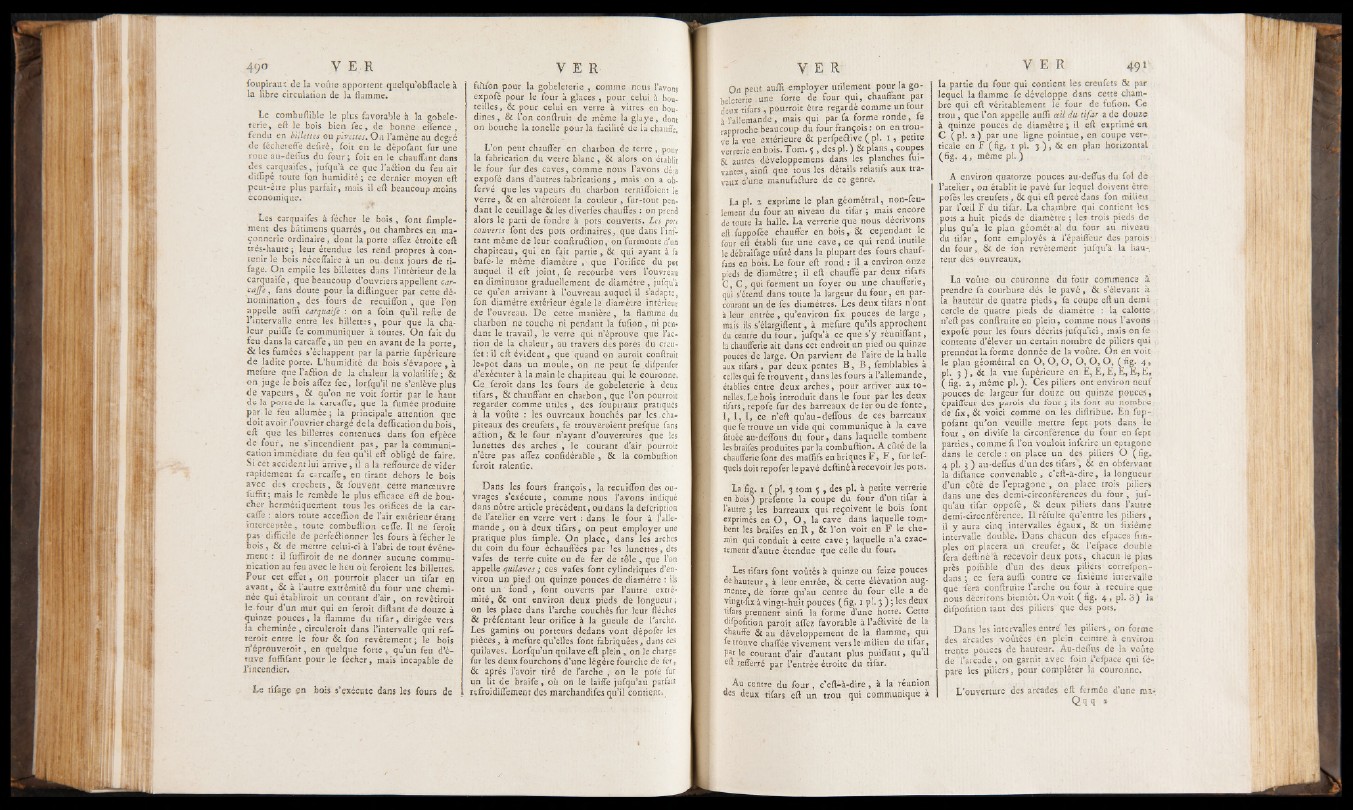
foupiraiu de la voûte apportent quelqu’obftacle à
la libre circulation de la flamme.
Le combuflible le plus favorable à la gobele-
terie, eft le bois bien fec, de bonne eflence ,
fendu en bïllettes ou pivettes. On l'amène au degré
de fécherefîe defiré, foit en le dèpofant fur une
roue au-deûus du four ; foit en le chauffant dans
des carquaifes, jufqu’à ce que l ’aâion du feu ait
dillipé toute fon humidité ; ce dernier moyen eft
peut-être plus parfait, mais il eft beaucoup moins
économique.
Les carquaifes à fécher le bois , font Amplement
des bâtimens quarrés, ou chambres en ma-
' çonnerie ordinaire, dont la porte aflfez étroite eft
très-haute ; leur étendue les rend propres à contenir
le bois néceflaire-à un ou deux jours de ti-
fage. On empile les bïllettes dans l’intérieur de,la
carquaife, que beaucoup d’ouvriers appellent car-
cajfe, fans doute pour, la diftinguer par cette dénomination
, des fours de rècuiflon , que l’on
appelle aufli carquaife : on a foin qu’il refte de
l’intervalle entre les billettes, pour que la chaleur
puiffe fe communiquer a toutes. On fait du
feu dans la carcaffe, un peu en avant de la porte,
& les fumées s’échappent par la partie fupérieure
de ladite porte. L’humidité du bois s’évapore , à
mefure que I’aétion de la chaleur la volatilife ; &
on juge le bois aflez fec, lorfqu’il ne s’enlève plus
de vapeurs, & qu’on ne voit fortir par le haut
delà porte de la carcaffe, que la fumée produite
par le feu allumée; la principale attention que
doit avoir l'ouvrier chargé delà deflication dubois,
eft que les billetres contenues dans fon efpèce
de four, ne s’incendient pas, par la communication
immédiate du feu qu’il eft obligé de faire.
Si cet accident lui arrive, il a la reflource de vider
rapidement fa carcafle, en tirant dehors le bois
avec des crochets, & fouvent cette manoeuvre
fufRt ; mais le remède le plus efficace eft de boucher
hermétiquement tous les orifices de la car-
caflfe : alors toute acceffion de l’air extérieur étant
interceptée, toute combuflion celle. Il ne feroit
pas difficile de perfectionner les fours à fécher îe
bois , & de mettre celui-ci à l’abri de tout événement
: il fuffiroit de ne donner aucune communication
au feu avec le lieu ou feroient les billettes.
Pour cet effet, on pourroit placer un tifar en
avant, & à l’autre extrémité du four une cheminée
qui établiroit un courant d’air, on revêtiroit
le four d’un mur qui en feroit diftant de douze à
quinze pouces, la flamme du tifar , dirigée vers
la cheminée, circuleroit dans l’intervalle qui ref-
teroit entre le four & fon revêtement; le bois
nfléprouveroit, en quelque forte, qu’un feu d’étuve
fuffifant pour le fécher, mais incapable de
l ’incendier.
Le tifage en bois s’exécute dans les fours de
fuïion pour la gobeleterie , comme nous l’avons
expofé pour le four à glaces , pour celui à bon-
teilles, & pour celui en verre à vitres en boudinés
, & l’on conftrurt de même la glaye, dont
on bouche la tonelle pour la facilité de la chauffe.
L’on peut chauffer en charbon de terre, pour
la fabrication du verre blanc, & alors on établit
le four fur des caves, comme nous l’avons déjà
expofé dans d’autres fabrications , mais' on a ob-
fervé que les valeurs du charbon terniffoient le
verre, & en altéroient la couleur, fur-tout pendant
le ceuillage & les diverfes chauffes : on prend
alors le parti de fondre à pots couverts, Les pots
couverts font des pots ordinaires, que dans l’inf-
tant même de leur conftru&ion, on furmonted’un
chapiteau, qui en f^it partie, & qui ayant à fa
bafe« le même diamètre , que l’orifice du p«t
auquel il eft joint, fe recourbe vers l’ouvreau
en diminuant graduellement de diamètre , jufqu’à
ce qu’en arrivant à l’ouvreau auquel il s’adapte,
fon diamètre extérieur égale le diamètre intérieur
de l’ouvreau. De cette manière, la flamme du
charbon ne touche ni pendant la fufion, ni peu-
dant le travail, le verre qui n’éprouve que l’action
de la chaleur, au travers des pores du creu-.
fet : il eft évident, que quand on auroit conftruit
le*pot dans un moule, on ne peut fe difpenfer
d’exécuter à la main le chapiteau qui le couronne.
Ce feroit dans les fours de gobeleterie à deux
tifars, & chauffant en charbon, que l’on pourroit
regarder comme utiles , des foupiraux pratiqués
à la voûte : les ouvreaux bouchés par les.chapiteaux
des Creufets, fe trouveroient prefque fans
aétion, & le four n’ayant d’ouvertures que les
lunettes des arches , le courant d’air pourroit
n’être pas aflez confldérable, & la combuflion
feroit ralentie.
Dans les fours françois, la rècuiflon dès ouvrages
s’exécute, comme nous l’avons indiqué
dans nôtre article précédent, ou dans la delcription
de l’atelier en verre vert : d'ans le four à l’allemande,
ou à deux tifars, on peut employer une
pratique plus fimple. .On place, dans les arches
du coin du four échauffées par les lunettes, des
vafes de terre cuite ou de fer dé tôle , que l’on
appelle quilaves ; ces vafes font cylindriques d’environ
un pied ou quinze pouces de diamètre : ils
ont un fond , font ouverts par l’autre extrémité,
& ont environ deux pieds de longueur;
on les plaee dans l’arche couchés fur leur flèches
& préfentant leur orifice à la gueule de Tarche.
Les gamins ou porteurs dedans vont dépofer les
pièces, à mefure qu’elles font fabriquées, dans ces
quilaves. Lorfqu’un quilave eft plein , on le charge
fur les deux fourchons d’une légère fourche de fer,
& après l’avoir tiré de farche , on le pofe fur
un lit de braife, où on le laiffe jufqu’au parfait
refroidiffemenr des marchandifes qu’il contient^
On peut auffi employer utilement pour la gobeleterie
. une forte de four qui, chauffant par
deux tifars , pourroit être regardé comme un four
à l’allemande, mais qui par fa forme ronde, le
rapproche beaucoup du four françois : on en trouve
la vue extérieure & perfpe&ive (p l. i » petite
verrerie en bois. Tom. 5 , des pl.) & plans , coupes
& autres développemens dans les planches fui-
vantes, ainfi que tous les détails relatifs aux travaux
d’une manufacture de ce genre.
La pl. 2 exprime le plan géométral, non-feulement
du four au niveau du tifar ; mais encore
de toute la halle. La verrerie que nous décrivons
eft fuppofée chauffer en bois, & cependant le
four eft établi fur une cave, ce qui rend inutile
le débraifage ufité dans la plupart des fours chauf-
fans en bois. Le four eft rond : il a environ onze
pieds de diamètre ; il eft chauffé par deux tifars
C , C , qui forment un foyer ou une chaufferie,
qui s’étend dans toute la largeur du four, en parcourant
un de fes diamètres. Les deux tifars n’ont
à leur entrée , qu’environ fix pouces de large ,
mais ils s’élargiffent, à mefure qu’ils approchent
du centre du four, jufqu’à ce que s’y réunifiant,
la chaufferie ait dans cet endroit un pied ou quinze
pouces de large. On parvient de l’aire de la halle
aux tifars , par deux pentes B , B , femblables à ,
celles qui fe trouvent, dans les fours à l’allemande,
établies entre deux arches, pour arriver aux to-
nelles, Le bois introduit dans le four par les deux
tifars, repofe fur des barreaux de fer ou de fonte,
I, I , I, ce n’eft qu’au-deffous de ces barreaux
que fe trouve un vide qui communique à la cave
fituée au-deffbus du four, dans laquelle tombent
les braifes produites par la combuflion. A côte de la
chaufferie font des maffifs en briques F , F , fur lef-
quels doit repofer le pavé deftiné à recevoir les pots.
La fig. 1 ( pl. 3 tom 5 , des pl. à petite verrerie
en bois) prèfente la coupe du four d’un tifar à
l’au tre le s barreaux qui reçoivent le bois font
exprimés en O , O , la cave dans laquelle tombent
les braifes en R , & l’on voit en F le chemin
qui conduit à cette cave ; laquelle n’a exactement
d’autre étendue que celle du four.
Les tifars font voûtés à quinze ou feize pouces
de hauteur, à leur entrée, & cette élévation augmente,
de forte qu’au centre du four elle a de
vingt-fix à vingt-huit pouces (fig. 1 pl. 3 ) ? les deux
tifars prennent ainfi la forme d’une hotte. Cette
difpofition paraît .allez favorable à l’aâivité de la
chauffe & au développement de la flamme, qui
fe trouve chaffé.e vivement vers le milieu du tifar,
par le courant d’air d’autant plus puiffant, qu’il
eft refferjé par l’entrée étroite du tifar.
Au centre du four , c’ eft-à-dire, à la réunion
des deux tifars eft un trou qui communique à
la partie du four qui contient les creufets & par
lequel la flamme fe développe dans cette chambre
qui eft véritablement le four de fufion. Ce
trou , que l’on appelle auffi ce.il du tifar a de douze
à quinze pouces de diamètre ; il eft exprimé en
C (pl. 2) par une ligne pointue, en coupe verticale
en F (fig. 1 pl. 3 ) , & en plan horizontal
(fig. 4 , même pl. )
A environ quatorze pouces au-deffus du fol de
l’atelier, on établit le pavé fur lequel doivent être
pofés les creufets, & qui eft percé dans fon milieu
par l’oeil F du tifar. La chambre qui contient les
pots a huit pieds de diamètre ; les trois pieds de
plus qu’a le plan géométral du four au niveau
du tifar , font employés à l’épaiffeur des parois
du four, & de fon revêtement jufqu’à la hauteur
des ouvreaux.
La voûte ou couronne du four commence à
prendre fa courbure dès le pavé, & s’élevant à
la hauteur de quatre pieds, fa coupe eft un demi
cercle de quatre pieds de diamètre : la calotte .
n’eft pas conftruite en plein, comme nous l’avons
expofé pour les fours décrits jufqu’ic i, mais on fe
contente d’élever un certain nombre de piliers qui
prennent la forme dpnnée de la voûte. On en voit
le plan géométral en O, O, O, O, 0 , 0 , ( fig. 4»
pl. 3 ) , & la vue fupérieure en E, E, E, E, E , E,
( fig. 2 , même p l.). Ces piliers ont environ neuf
pouces de largeur fur douze ou quinze pouces,
épaiffeur des parois du four ; ils font au nombre
de fix, & voici comme on les diftribue. En fup-
pofant qu’on veuille mettre fept pots dans le
four , on divife la circonférence du four en fept
parties , comme fi l’on vouloit inferire un eptagone
dans le cercle : on place un des piliers O ( fig.
4 pl. 3 ) au-deffus d’un des tifars’, & en obfervant
la diftance convenable , c’eft-à-dire, la longueur
d’un côté de l’eptagone , on place trois piliers
dans une des demi-circonférences du four, jufqu’au
tifar oppofé, & deux piliers dans l’autre
demi-circcnférence. Il réfulte qu’entre les piliers,
il y aura cinq intervalles égaux, & un fixième
intervalle double, Dans chacun des efpaces fiin-
ples on placera un creufet, 8c l’efpace double
fera deftiné'à recevoir deux pots, chacun le plus
près poffible d’un des deux piliers correfpon-
dans ; ce fera auffi contre ce fixième intervalle
que fera conftruite l’arche ou four à recuire que
nous décrirons bientôt. On-voit ( fig. 4 , pi. 3 ) la
difpofition tant des piliers que des pots.
D ans les intervalles entre7 les piliers, on forme
des arcades voûtées en plein ceintre à environ
trente pouces de hauteur. Au-deffus de la voûte
de l’arcade , on garnit, avec foin l’efpace qui fé-
pare les piliers, pour'compléter la couronne.
L’ouverture des arcades eft fermée d’une ma-,
Q q q î