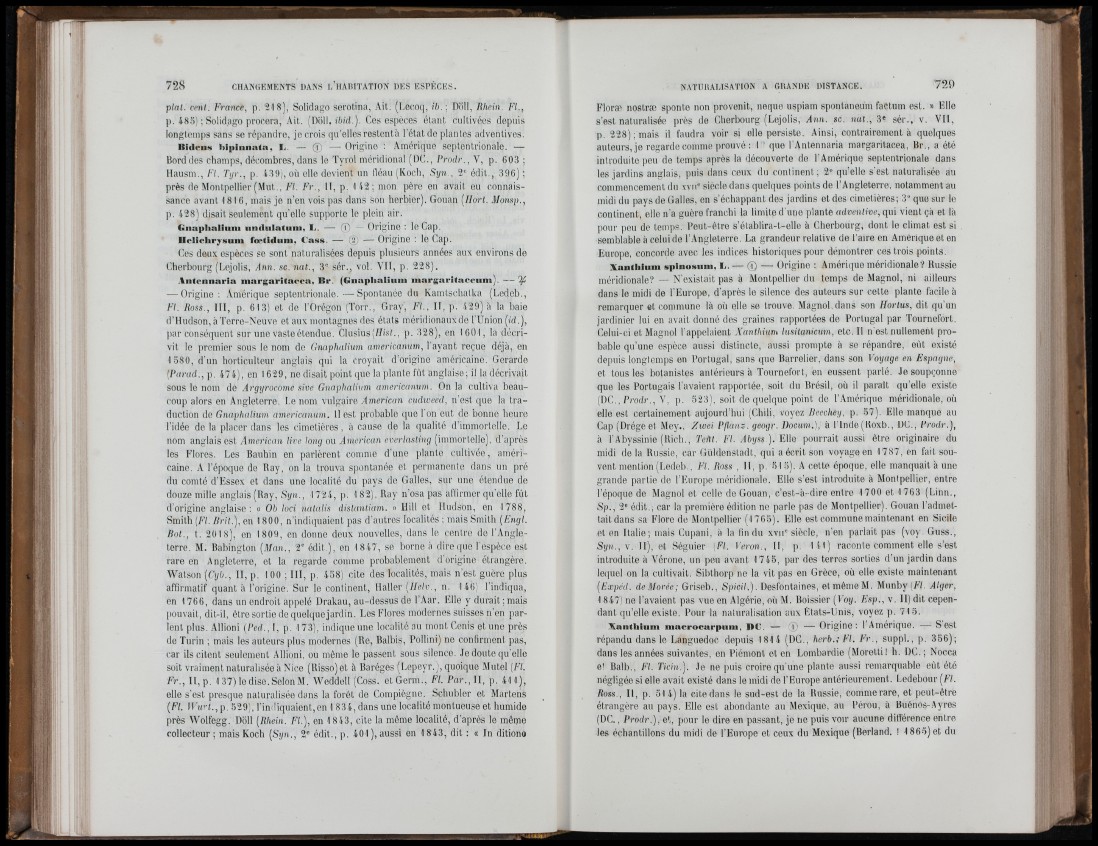
!! .ii ' j.
CIÍAINGKMKNTS DANS UAlîïTATION DKS ESPKCKS.
pial. mil. France, p. 218), Solidago serótina, Ait. (Locoq, ib.: Doll, Rhein. FL,
p. 485) ; Solidago procera, Ait. [IJôW^ ibid.). Ces esi)èces étant cultivées depuis
longtemps sans se répandre, je crois qu'elles restent à l'état de plantes adventives.
Rideii»« hipinnata, L ® — Origine : Amérique septentrionale.
Bord des champs, décombres, dans le Tyrol méridional (DC,, Prodr., V, p. 603 ;
Hausm., Fl. Tyr., p. 439), où elle devient un lléau [Koch, Syn., édit., 396) ;
près de Montpellier (Mut., Fi. FÎ\, li, p. 142; mon père en avait eu connaissance
avant 181 G, mais je n'en vois pas dans Son herbier). Goiian [Ilort. Momp.y
p. 428) disait seulement qu'elle supporte le plein air.
G i i a p l i a l i n i i i tiiidulatuni, T. — © - Origine : le Cap.
l l e l i c l i r ^ ' s um roetidiini, Cass. — © — Origine : le Cap.
Ces deux espèces se sont naturalisées depuis plusieurs années aux environs de
Cherbourg (Lqjolis, Ann. sc. nat., 3^^ sér., vol. VTI, p. 228).
A n t e n n a r i a inar;;ari<area, lïr. (Giiaplialîuni iiiargaritaeeiim). — If
— Origine: Amérique septentrionale.—S|)ontanée du Kamtschatka (Ledeb.,
F\. Ross., m , p. 613) et de TOrégon (Torr., Gray, FI., li, p. 429) à la baie
d'Hudson, à Ter re-Neuve et aux montagnes des états méridionaux de l'Union {id.),
par conséquent sur nue vaste étendue. Clusius(//i.s/., p. 328), en 160'l, la décrivit
le premier sous le nom de Cnaphalium americamim^ l'ayant reçue déjà, en
Io80, d'un horticulteur anglais qui la croyait d'origine américaine. Gerarde
(Pi/rai/., p. 474), en 1629, ne disait point que la plante fût anglaise ; il la décrivait
sous le nom de Argyrocome sive Gnaphalinm americamim. On la cultiva beaucoup
alors en Angleterre. I.e nom vulgaire ytnienci/?i cAidiveed, n'est que la traduction
de Gnaphaliuni americamim. Il est probable que Ton eut de bonne heure
ridée de la placer dans les cimetières, à cause de la qualité d'immortelle. Le
noni anglais est American lire long ou American everlasting (immortelle), d'après
les Flores. Les Bauhin en parlèrent conmie d'une plante cultivée, américaine.
A l'époque de Ray, on la trouva sj)ontanée et permanei\te dans nu pré
du comté d'Essex et dans une localité du pays de Galles, sur une étendue de
douze mille anglais (Ray, Syn., 1724, p. 1 82). Ray n'osa pas aflirmer qu'elle fût
dorigine anglaise: « Ob loci natalis distanliam. » Hill et Hudson, en 1788,
Smith {Fl. Brit.), en 1 800, n'indiquaient pas d'autres localités ; mais Smith {EngL
Bot.^ t. 2018), en 1809, en donne deux nouvelles, dans le centre do l'Angleterre.
M. Babington [Man., T edit.), en 1847, se borne à dire que l'espèce est
rare en Angleterre, et la regarde comme probablement il'origine étrangère.
Watson {Cyb., II, p. 100 ; I I I , p. 458) cite des localités, mais n'est guère plus
affirmatif quant à l'origine. Sur le continent, Haller {llelv., n. 146; l'indiqua,
en 1766, dans un endroit appelé Drakau, au-dessus de TAar. Elle y durait;mais
|)Ouvait, dit-il, ótre sortie de quelquejardin. Les Flores modernes suisses n'en parlent
plus. Allioni {l'ed., I, p. 173), indique une locahtéau montCenis et une près
de Turin ; mais les auteurs plus modernes (Re, Balbis, Pollini) ne confirment pas,
car ils citent seulement Allioni, ou môme le passent sous silence. Je doute quelle
soit vraiment naturalisée à Nice (Risso) et à Baréges (Lepeyr.), quoique Mutel ( R
Fr., II, p. '137)ledise.SelonM. Weddell (Coss. et Germ., FL Par., II, p. 411),
elle s'est presque naturalisée dans la forêt de Compiègne. Schubler et Martens
{FL H'iiri.,p. 529;, l'indiquaient,en 1 834, dans une localité montueuse et humide
près Wolfegg. Doli [Rhein. Fl.), eu 1 843, cite la même locaUté, d'après le même
collecteur; mais Koch {Syn., 2^ édit., p. 401), aussi en 1843, dit : a In ditione
natuualïsation a guandk distance. 729
Floras nostra) sponte non provenit, ñeque uspiam spontaneum factum est. Elle
s'est naturalisée près de Cherbourg (Lejolis, Ann. sc. nat., sér., v. VII,
p. 228); mais il faudra voir si elle persiste. Ainsi, contrairement à quelques
auteurs, je regarde comme prouvé : 1 ' que l'Antennaria margaritacea, Br., a été
introduite peu de temps après la découverte de l'Amérique septentrionale dans
les jardins anglais, puis dans ceux du continent; 2" qu'elle s'est naturalisée au
commencement du xvii^ siècle dans quelques points de l'Angleterre, notamment au
midi du pays de Galles, en s'échappant des jardins et des cimetières; 3" que sur le
continent, elle n'a guère franchi la limite d'une plante adveniive, qui vient çà et là
liour peu de temps. Peut-être s'établira-t-elle à Cherbourg, dont le climat est si
semblable à celui de l'Angleterre. La grandeur relative de Taire en Amérique et en
Europe, concorde avec les indices historiques pour démontrer ces trois points.
X a u i h i i im spinosuni, T. — ® — Origine : Amérique méridionale? Russie
inéridionale? — N'existait pas à Montpellier du temps de Magnol, ni ailleurs
dans le midi de l'Europe, d'après le silence des auteurs sur cette plante facile à
remarquer et commune là oii elle se trouve. Magnol, dans son Horlus, dit qu'un
jardinier lui en avait donné des graines rapportées de Portugal par Tournefort.
Celui-ci et Magnol l'appelaient .\anthium íusítanicnm, etc. Il n'est nullement probcible
qu'une espèce aussi distincte, aussi prompte à se répandre, etit existé
depuis longlem})S en Portugal, sans que Barrelier, dans son Voyage en Espagne,
et tousles botanistes antérieurs à Tournefort, en eussent parlé. Je soupçonne
que les Portugais lavaient rapportée, soit du Brésil, où il paraît qu'elle existe
(DC., Trodr., V, j). 523), soit de quelque point de l'Amérique méridionale, où
elle est certainement aujourd'hui (Chili, voyez Reechey, p. 57). Elle manque au
Cap (Drégeet Mey.. Zioei Pflanz-. geogr. Docum,), à ITnde(Roxb., DC., Pm/r.),
à l'Abyssinie (Rich., Teñt. FL Abyss ).E\\o pourrait aussi être originaire du
midi de la Russie, car GüIdenstadt, qui a écrit son voyage en 1787, en fait souvent
mention (Ledeb., FL Ross , 11, p. 515). A cette époque, elle manquait à une
grande partie de l'Europe méridionale. Elle s'est introduite à Montpellier, entre
l'époque de Magnol et celle de Gouan, c'est-à- dire entre 1700 et 1763 (Liun.,
S/)., 2® édit., car la première édition ne parle pas de Montpellier). Gouan l'admettait
dans sa Flore de Montpellier (1765). Elle est commune maintenant en Sicile
et on Italie; mais Cupani, à la fin du xvii^ siècle, n'en parlait pas (voy. Guss.,
Syn., V. II) et Séguier FL \'eron., II, p. 141) raconte comment elle s'est
introduite à Vérone, un peu avant 1745, par des terres sorties d'un jardin dans
le([uel on la cultivait. Sibthorp ne la vit pas en Grèce, où elle existe maintenant
{Fxpéd. deMorée; Griseb,, SpiciL). Desfontaines, e tmêmeM. Munby (F/. Alger,
1 847) ne l'avaient pas vue en Algérie, où M. Boissier [Voy. iisp., v. H) dit cependant
qu'elle existe. Pour la naturalisation aux États-Unis, voyez p. 715.
XaïUhiiini macrocarpiim, lic. — ® — Origine: l'Amérique. — S'est
répandu dans le Languedoc depuis 1814 (DC., herb.; Fl. Pr., suppl., p. 356);
dans les années suivantes, en Piémont et en Lombardie (Moretti! h. DC. ; Nocca
e! Balb., FL Ticin.). Je ne puis croire qu'une plante aussi remarquable eût été
négligée si elle avait existé dans le midi de l'Europe antérieurement. Ledebour {FL
Ross., Il, p. 514) la cite dans le sud-est de la Russie, commerare, et peut-être
étrangère au pays. Elle est abondante au Mexique, au Pérou, à Buénos-Ayres
(DC., Prodr.), et, pour le dire en passant, je ne puis von* aucune différence entre
les échantillons du midi de l'Europe et ceux du Mexique (Borland. ! 1865) et du
^ --I
F
I f
Í II!'
î
. .. -. - .,-. ...