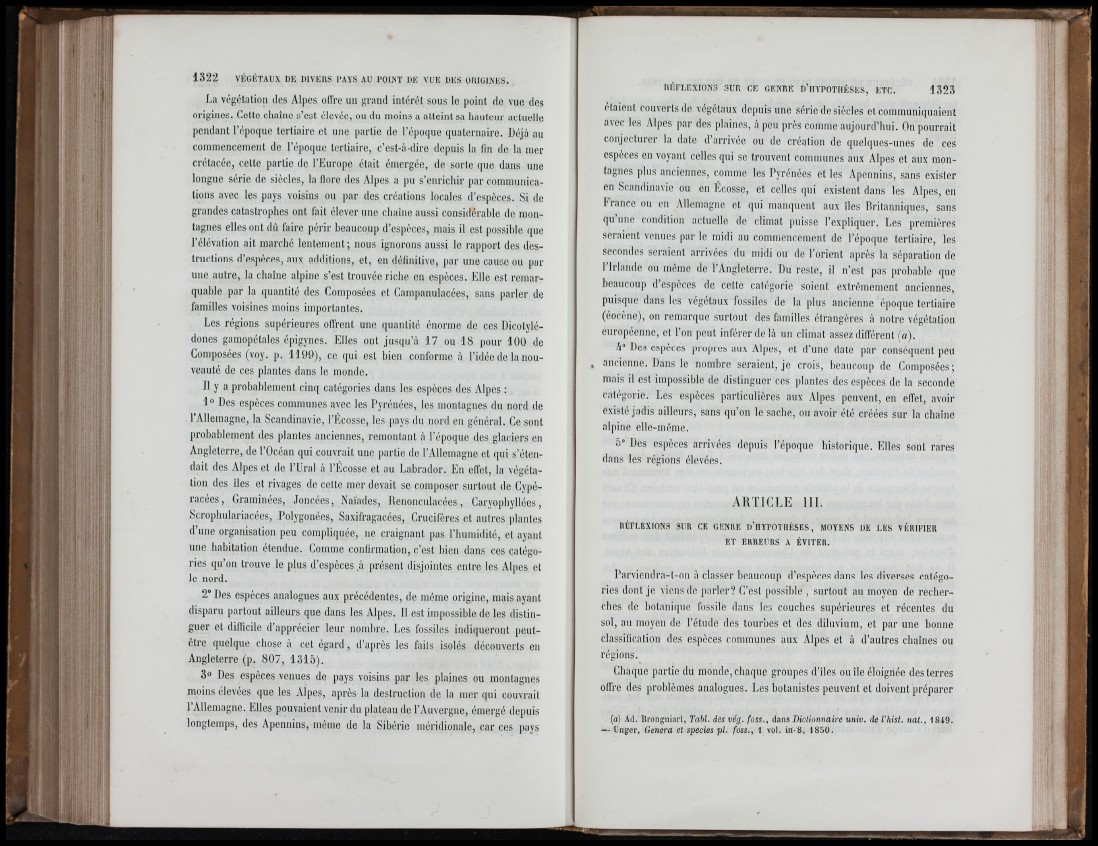
. îl
iii ÎT;
mi
m
¡«ir:
-VI
i-f «1 i 5 frH i . 1 Kkri
mi
1322 VÉGÉTAUX DE DIVERS l'AYS AU l'OlMT DE VUE DES OUIGINES.
La végétation des Alpes olire un grand intérêt sous le point (ie vue des
origines. Celte cliaîne s'est élevée, ou du moins a atteint sa hauteur actuelle
pendant l'époque tertiaire et une partie de répo(|ue quaternaire. Déjà au
coniinencenient de l'époque tertiaire, c'est-à-dire depuis la tin de la mer
crétacée, celte partie de l'Europe était émergée, de sorte que dans une
longue série de siècles, la (lore des Alpes a pu s'enrichir par communications
avec les pays voisins ou par des créations locales d'espèces. Si de
grandes catastrophes ont lait élever une chaîne aussi considérable de montagnes
elles ont dû faire périr beaucoup d'espèces, mais il est possible que
l'élévation ait marché lentement; nous ignorons aussi le rapport des destructions
d'espèces, aux additions, et, en déilnilive, par une cause ou par
une aulre, la chaîne alpine s'esl trouvée riche eu espèces. Elle est remarquable
par la (juantité des Composées et Carnpanulacées, sans parler de
familles voisines moins importantes.
Les régions supérieures oll'rent une quantité énorme de ces Dicotylédones
gamopétales épigynes. Elles ont Jusqu'à 17 ou 18 pour il 00 de
Composées (voy. p. 1199), ce qui est bien conforme à l'idée de la nouveauté
de ces plantes dans le monde.
Il y a probablement cinq catégories dans les espèces ties Alpes :
Des espèces conijuunes avec les Pyrénées, les montagnes du nord de
l'Allemagne, la Scandinavie, l'Ecosse, les pays du nord en général. Ce sont
probablement des plantes anciennes, remontant à l'époque des gla(;iers en
Angleterre, de l'Océan qui couvrait une partie de l'Allemagne et qui s'étendait
(les Alpes et de l'Ural à l'Ecosse et au Labrador. En elfet, la végétation
des îles et rivages de celte mer devait se composer surtout de Cypéracées.
Graminées, Joncées, Naïades, Renonculacées, Caryophyllées,
Scrophulariacées, Polygonées, Saxifragacées, Crucifères et autres plantes
d'une organisation peu compliquée, ne craignant pas l'humidité, et ayant
une habitation étendue. Connue conhrmation, c'est bien dans ces catégories
qu'on trouve le plus d'espèces à présent disjointes entre les Alpes et
le nord.
2° Des espèces analogues aux précédentes, de même origine, mais ayant
disparu partout ailleurs que dans les Alpes. Il est impossible de les distinguer
et diflicile d'apprécier leur nombre. Les fossiles indiqueront peutêtre
quelque chose à cet égard, d'après les fails isolés découverts en
Angleterre (p. 807, 1315).
3« Des espèces venues de pays voisins par les plaines ou montagnes
moins élevées que les Alpes, après la destruction de la mer qui couvrait
l'Allemagne. Elles pouvaient venir du plateau de l'Auvergne, émergé dei)uis
longtemps, des Apennins, même de la Sibérie méridionale, car ces pays
llÉFLEXIONS sun CE GENRE D^HYPOTIIÈSES, ETC.
étaient couverts de végétaux depuis une série de siècles et communiquaient
avec les Alpes par des plaines, à peu près comme aujourd'hui. On pourrait
conjecturer la date d'arrivée ou de création de (luelques-unes de ces
espèces en voyant celles qui se trouvent communes aux Alpes et aux montagnes
plus anciennes, comme les Pyrénées et les Apennins, sans exister
en Scandinavie ou en Ecosse, et celles qui existent dans les Alpes, en
Erance ou en Allemagne et qui manquent aux îles Britanniques, sans
qu'une condition actuelle de climat puisse l'expliquer. Les premières
seraient venues par le midi au commencement de l'époque tertiaire, les
secondes seraient arrivées du midi ou de l'orient après la séparation de
l'Irlande ou niême de l'Angleterre. Du reste, il n'est pas i)rol)able que
beaucoup d'espèces de cette catégorie soient extrêmement anciennes,
puisque dans les végétaux fossiles de la plus ancienne époque tertiaire
(éocène), on rcmar([ue surtout des familles étrangères à notre végétation
européenne, et l'on peut inférer de là un climat assez dilférent (a).
/ r Des espèces propres aux Alpes, et d'une date par conséquent peu
ancienne. Dans le nombre seraient, je crois, beaucoup de Composées,
mais il est impossible de distinguer ces plantes des espèces de la seconde
catégorie. Les espèces particulières aux Alpes peuvent, en effet, avoir
existé jadis ailleurs, sans qu'on le sache, ou avoir été créées sur la chaîne
alpine elle-même.
5» Des espèces arrivées depuis l'époque historique. Elles sont rares
dans les régions élevées.
ARTICLE MI.
RÉFLEXIONS SUR CE GIÎNUE D'ilYrOTHÈSlîS, AiOYENS DE LES VÉRIFIER
ET ERUEnilS A ÉVITER.
Parviendra-t-on à classer beaucoup d'espèces dans les diverses catégories
dont je viens de ])arler? C'est possible , surtout au moyen de recherches
de botanicpie fossile dans les couches supérieures et récentes du
sol, au moyen de l'étude des tourbes et des diluvium, et par une bonne
classiiication des espèces connnunes aux Alpes et à d'autres chaînes ou
régions.
Chaque partie du monde, chaque groupes d'îles ou île éloignée des terres
otfre des problèmes analogues. Les botanistes peuvent et doivent préparer
(a) Ad. Brongniart, Tabi, des vég. foss., dans Dictionnaire univ. de l'hist. nal., 1849.
— Unger, Genera et species pl. foss., 1 vol. in-8, 1850.
: I î