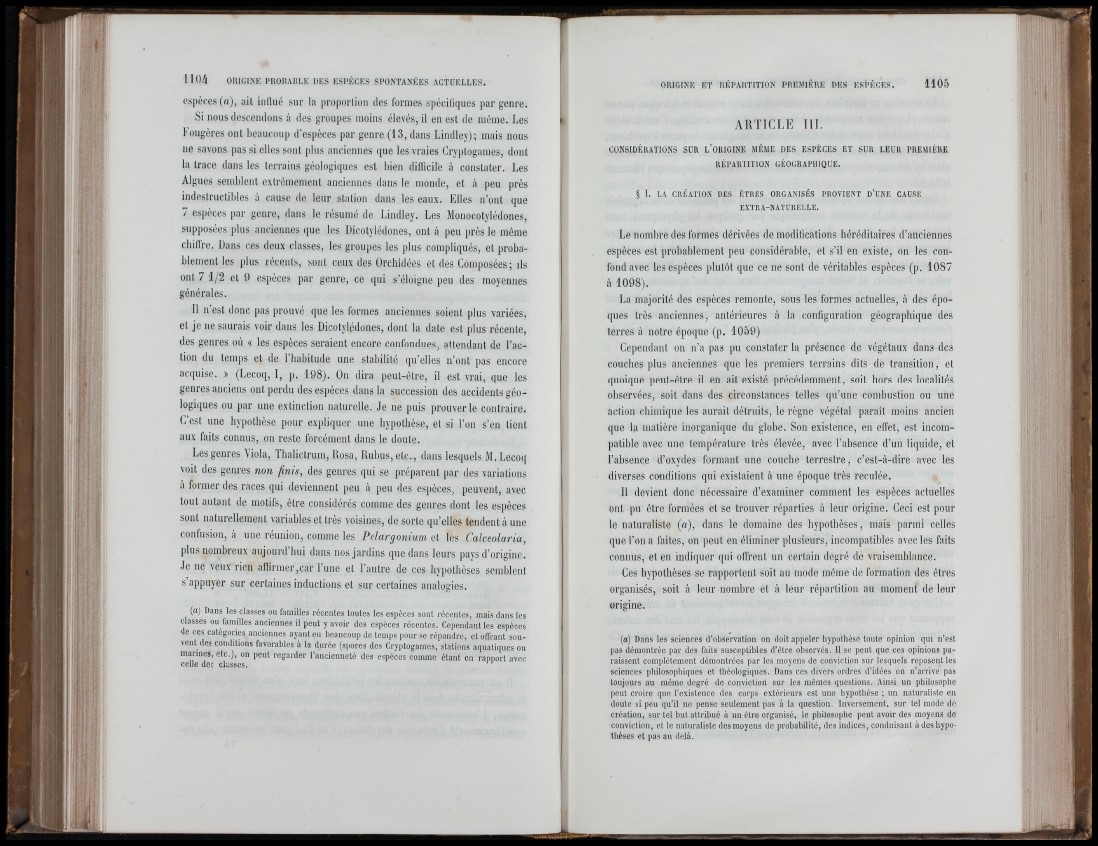
. ,4:
i l o / i OniGÏNK PROÌÌAIÌLK DES ESPÈCES SPONTANÉES ACTUELLES,
espèces (a), ait iiilliié sur la proportion des formes spéciiiques par genre.
Si nous descemlons à des groupes uioins élevés^ il en est de même. Les
Fougères ont beaucoup d'espèces par genre (13, dans Lindley); mais nous
ne savons pas si elles sont plus anciennes que les vraies Cryptogames, dont
la trace dans les terrains géologiques est bien difficile à constater. Les
Algues semblent extrêmement anciennes dans le monde, et à peu près
indestructibles à cause de leur station dans les eaux. Elles n'ont que
7 espèces par genre, dans le résumé de Lindley. Les Monocotylédones,
supposées plus anciennes que les Dicotylédones, ont à peu près le même
chillre. Dans ces deux classes, les groupes les plus compliqués, et probablement
les plus récents, sont ceux des Orchidées et des Composées; ils
ont 7 1/2 et 9 espèces par genre, ce qui s'éloigne peu des moyennes
générales.
Il n'est donc pas prouvé que les formes anciennes soient plus variées,
et je ne saurais voir dans les Dicotylédones, dont la date est plus récente,
des genres où (c les espèces seraient encore confondues, attendant de l'action
du temps et de l'habitude une stabilité qu'elles n'ont pas encore
acquise, » (Lecoq, I, p, 198). On dira peut-être, il est vrai, que les
genres anciens ont perdu des espèces dans la succession des accidents géologiques
ou par une extinction naturelle. Je ne puis prouver le contraire.
C'est une hypothèse pour expliquer une hypothèse, et si l'on s'en tient
aux faits connus, on reste forcément dans le doute.
Les genres Viola, Thalictrum, Rosa, Rubus, etc,, dans lesquels M. Lecoif
voit des genres non finis, des genres qui se préparent par des variations
à former des races qui deviennent peu à peu des espèces, peuvent, avec
tout autant de motifs, être considérés comme des genres dont les espèces
sont naturellement variables et très voisines, de sorte qu'elles tendent à une
confusion, à une réunion, comme les Pelargonium et les Calceolaria,
plus nombreux aujourd'hui dans nos jardins que dans leurs pays d'origine.
Je ne veux rien affirmer,car l'une et l'autre de ces hypothèses semblent
s'appuyer sur certaines inductions et sur certaines analogies.
(a) Dans les classes ou familles récentes toutes les espèces sont récentes, mais dans les
classes ou familles anciennes il peut y avoir des espèces récentes. Cependant les espèces
üe ces categories anciennes ayant eu beaucoup de temps pour se répandre, et oiTrant souvent
des conditions favorables à la durée (spores des Cryptogames, stations aquatiques ou
marmes, ite.), on peut regarder l'ancienneté des espèces comme étant en rapport avec
celle de? classes. ^ ^
OmClNF: ET RÉPARTITION PREMIÈRE DES ESPÈCES. 11 0 5
A R T I C L E m.
CONSIDÉIUTIONS SUR L'ORIGINE MÊME DES ESPÈCES ET SUU LEUR PREMIÈRE
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE.
§ l. LA CRÉATION DES ÊTRES ORGANISÉS PROVIENT D'UNE CAUSE
EXTRA-INATURELLE.
Le nombre des formes dérivées de modifications héréditaires d'anciennes
espèces est probablement peu considérable^ et s'il en existe, on les confond
avec les espèces plutôt que ce ne sont de véritables espèces (p. 1087
à 1098).
La majorité des espèces remonte, sous les formes actuelles, à des époques
très anciennes, antérieures à la configuration géographique des
terres à notre époque (p. 1059)
Cependant on n'a pas pu constater la présence de végétaux dans des
couches plus anciennes que les premiers terrains dits de transition, et
quoique peut-être il en ait existé précédemment, soit hors des localités
ol)servées, soit dans des circonstances telles qu'une combustion ou une
action chimique les aurait détruits, le règne végétal paraît moins ancien
que la matière inorganique du globe. Son existence, en efCet, est incompatible
avec line température très élevée, avec l'absence d'un liquide, et
l'absence d'oxydes formant une couche terrestre, c'est-à-dire avec les
diverses conditions qui existaient à une époque très reculée.
Il devient donc nécessaire d'examiner comment les espèces actuelles
ont pu être formées et se trouver réparties à leur origine. Ceci est pour
le naturaliste (a), dans le domaine des hypothèses, mais parmi celles
que l'on a faites, on peut en éliminer plusieurs, incompatibles avec les faits
connus, et en indiquer qui offrent un certain degré de vraisemblance.
Ces hypothèses se rapportent soit au mode même de formation des êtres
organisés, soit à leur nombre et à leur répartition au moment de leur
origine.
(a) Dans les sciences d'observation on doit appeler hypothèse toute opinion qui n'est
pas démontrée par des faits susceptibles d'être observés. Il se peut que ces opinions paraissent
complètement démontrées par les moyens de conviction sur lesquels reposent les
sciences philosophiques et théologiques. Dans ces divers ordres d'idées on n'arrive pas
toujours au môme degré de conviction sur les mêmes questions. Ainsi un philosophe
peut croire que l'existence des corps extérieurs est une hypothèse ; un naturah'ste en
doute si peu qu'il ne pense seulement pas à la question. Inversement, sur tel mode de
création, sur tel but attribué à un être organisé, le philosophe peut avoir des moyens de
conviction, et le naturaliste des moyens de probabilité, des indices, conduisant à des hypothèses
et pas au delà.
' i
m..
''é