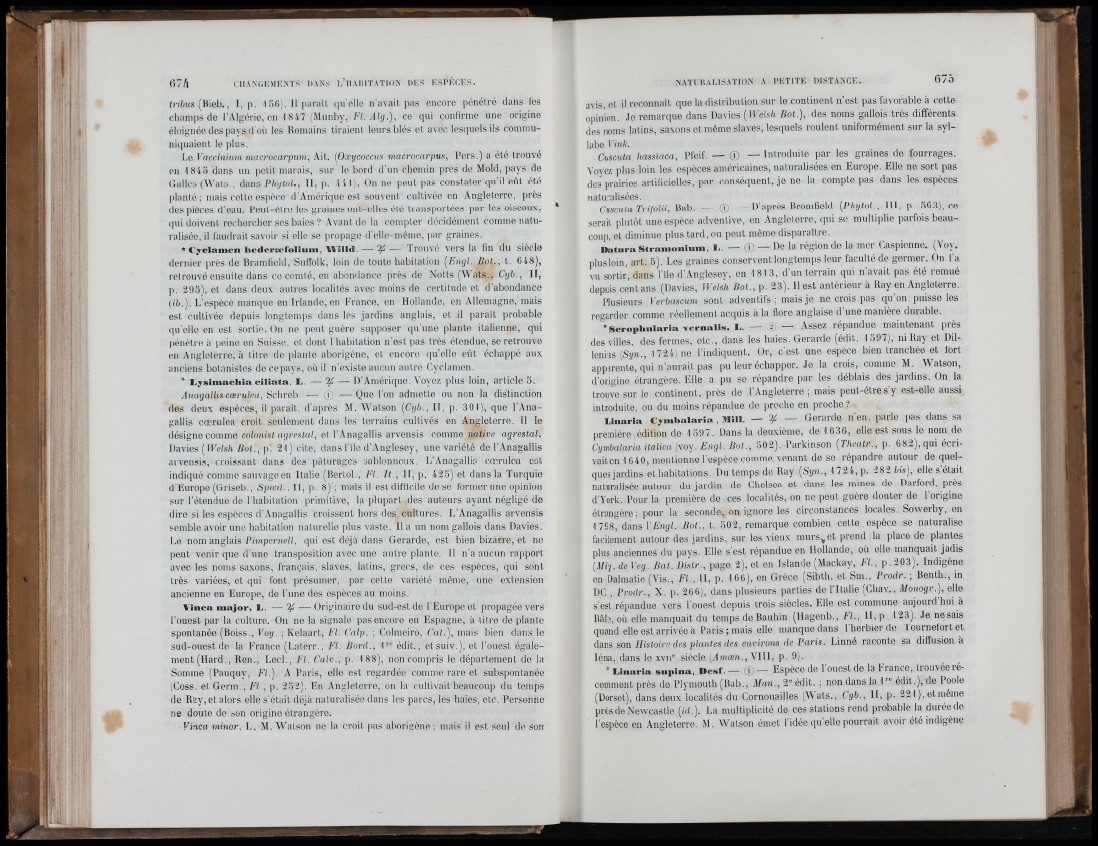
-•«fiib BIIIIIHI1III
()7/i i;iÎA.\GKMK.NTS lïANs l/llAlilTATION DK? KSPKCKS. .NATLUAIJSATION A 1M<:TITE DISTANCE. 67Ò
H' ''il
tribus {ïWeb., I, p. iSG). 11 paraît quelle n'avait pas encore pénétré dans les
champs de l'Algérie, en J847 (Munby, F L A l g . ) , ce qui coniirme une origine
éloignée des pays d oil les llomains tiraient leurs blés et avec lesquels ils communiquaient
le plus.
Le Vacdniinn mac?^ocarpxim^ Ait. [Oxycoccus ^nacromrpm^ Pers.) a été trouvé
en i84o dans un petit marais, sur le bord d'un chemin près de Moid, pays de
Tialles (Wats., dans Phitol^, II, p. 441). On ne peut pas constater qu'il eût été
planté; mais cette espèce d'Amérique est souvent cultivée en Angleterre, près
des pièces d'eau. Peut-élro les graines ont-elles été transportées par les oiseaux,
(jui doivent rechercher ses baies ? Avant de la compter décidément comme naturalisée,
il faudrait savoir si elle se propage d'elle-même, ])ar graines.
* C y c l ame n liedcrw-lbliiuii, Wîllil. — — Trouvé vers la fin du siècle
dernier près de Bramiield, Suffolk, loin de toute habitation {Engl. Bot., t. 648),
retrouvé ensuite dans ce comté, en abondance près de Notts (Wats., Cyb., If,
p. 295), et dans deux autres localités avec moins de certitude et d'abondance
{ib,). L'espèce manque en Irlande, en France, en Hollande, en Allemagne, mais
est cultivée depuis longtemps dans les jardins anglais, et il paraît probable
([u'elle en est sortie. On ne peut guère supposer qu'une plante italienne, qui
pénètre à peine en Suisse, et dont l'habitation n'est pas très étendue, se retrouve
en Angleterre, à titre do plante aborigène, et encore qu elle eût échappé aux
anciens botanistes de ce pays, où il n'existe aucun autre Cyclamen.
l . y s i m a c h i a e i B î a t a , !.. — D'Amérique. Yoyez plus loin, article 5.
Auagalliscoerulea, Schreb. — ® — Que l'on admette ou non la distinction
des deux espèces, il paraît, d'après M. Watson {Cyb., II, p. 301), que l'Anagallis
coerulea croit seulement dans les terrains cultivés en Angleterre. Il le
désigne comme colonist agrestal^ et l'Anagallis arvensis comme native ag^restaL
Davies (Pl^d.s/t/ioi., p. 2'l)cite, dans Tîle d'Anglesey, une variété de i'Ana'gallis
arvensis, croissant dans des pâturages sablonneux. L'AnagaUis coerulea est
indiqué comme sauvageon Italie (BertoL, Fl. It., II, p. 425) et dans la Turquie
d'Europe (Griseb., S p i c i L . II, p. 8) ; mais il est difficile de se former une opinion
sur l'étendue de l'habitation primitive, la plupart des auteurs ayant négligé de
dire si les espèces d'Anagallis croissent hors des cultures. L'AnagaHis arvensis
semble avoir une habitation naturelle plus vaste. Il a un nom gallois dans Davies.
Le nom anglais Pivipernell, qui est déjà dans Gerarde, est bien bizarre, et ne
peut venir que d'ime transposition avec une autre plante. Il n'a aucun rapport
avec les noms saxons, français, slaves, latins, grecs, de ces espèces, qui sont
très variées, et qui font présumer, par cette variété même, une extension
ancienne en Europe, de l'une des espèces au moins.
Viiica ma j o r , L. — ^ — Originaire du sud-est de TEurope et propagée vers
l'ouest par la culture. On ne la signale pas encore en Espagne, à titre de plante
spontanée (Boiss., V o y . ; Kelaart, FL Calp, ; Colmeiro, Cat,), mais bien dans le
sud-ouest de la Erance (Laterr., Fl. Bord., édit., etsuiv.), et l'ouest également
(Hard., Ren., Led., F l . Calv., p. 188), non compris le département de la
Somme (Pauquy, FL). A Paris, elle est regardée comme rare et subspontanée
(Coss. et Germ., Fl , p. 252). En Angleterre, on la cultivait beaucoup du temps
de Ray, et alors elle s'était déjà naturalisée dans les parcs, les haies, etd. Personne
ne doute de ©on origine étrangère.
Vinca minor, L. M. Watson ne la croit pas aborigène; mais il est seul de son
avis, et il reconnaît que la distribution sur le continent n'est pas favorable à cette
opinion. Je remarque dans Davies [Welsh Bot,), des noms gallois très différents
des noms latins, saxons et même slaves, lesquels roulent uniformément sur la syllabe
y ink.
Cuscuta hassìaca, Pfeif. — ® — Introduite par les graines do fourrages.
Voyez plus loin les espèces américaines, naturalisées en Europe. Elle ne sort pas
des prairies artificielles, par conséquent, je ne la compte pas dans les espèces
naturahsées.
Cuscuta Trifola, Bab. — ® — D'après Bromfield [PhytoL, III, p. 5G3), ce
serait plutôt une espèce adventive, en Angleterre, ([ui se multiplie parfois beaucoup,
et diminue plus tard, ou peut même disparaître.
D a t u r a S t r amonium, I.. — ® — De la région de la mer Caspienne. (Voy.
plus loin, art. 5). Les graines conservent longtemps leur faculté de germer. On Ta
vu sortir, dans l'île d'Anglesey, en 181 3, d'un terrain qui n'avait pas été remué
depuis cent ans (Davies, Welsh Bot., p. 23). 11 est antérieur à Ray en Angleterre.
Plusieurs Verbascum sont adventifs ; mais je ne crois pas qu'on puisse les
regarder comme réellement acquis àia flore anglaise d'une manière durable.
* S c r o p h u l a r î a vcrnalîs, L. — ^ — Assez répandue maintenant près
des villes, des fermes, etc., dans les haies. Gerarde (édit. 1 597), ni Ray et Dillenius
( S y n , , 1724) ne l'indiquent. Or, c'est une espèce bien tranchée et fort
apparente, qui n'aurait pas pu leur échapper. Je la crois, comme M. Watson,
d'origine étrangère. Elle a pu se répandre par les déblais des jardins. On la
trouve sur le continent, près de l'Angleterre ; mais peut-êtres'y est-elle aussi
introduite, ou du moins répandue de proche en proche?
L î n a r î a Cymbalarîa , Mill. — ^^ — Gerarde n'en, parie pas dans .sa
première édition de 1 597. Dans la deuxième, de 1 636, elle est sous le nom de
Cymbalaria italica [voy. Engl. Bot., 502). Parkinson [Tlieatr., p. 682), qui écrivait
en 1640, mentionne l'espèce comme venant de se répandre autour de quelques
jardins et habitations. Du temps de Ray [ S y n . , 1724, p. 282 ^/s), elle s'était
naturalisée autour du jardin de Chelsea et dans les mines de Darford, près
d'York. Pour la première de ces localités, on ne peut guère douter de l'origine
étrangère; pour la seconde, on ignore les circonstances locales. Sowerby, en
1798, dans Y Engl. Bot., t. 502, remarque combien cette espèce se naturalise
facilement autour des jardins, sur les vieux murs.^et prend la place de plantes
plus anciennes du pays. Elle s est répandue en Hollande, où elle manquait jadis
[Miq. de Veg. Bat. Distr., page 2), et en Islande (Mackay, F L , p. 203). Indigène
en Dalmatie (Vis., F L , II, p. 166), en Grèce (Sibth. et Sm., Prodr. ; Benth., in
DC., Prodr., X. p. 266), dans plusieurs parties de l'Italie (Chav.. Monogr.), elle
s'est répandue vers l'ouest depuis trois siècles. Elle est commune aujourd'hui à
Bâle, où elle manquait du temps de Bauhin (Hagenb., Fl., II, p. 123). Je nesais
quand elle est arrivée à Paris ; mais elle manque dans l'herbier de ïournefortet
dans son Histoire des plantes des environs de Paris. Linné raconte sa diffusion à
léna, dans le xvu^ siècle (imcRïi., VIII, p. 9).
^ L î n a r î a supîna, Desf. — ® — Espèce de louest de la France, trouvée récemment
près de Plymouth (Bab., fc., édit. ; non dans la édit.), de Poole
(Dorset), dans deux localités du Cornouailles (Wats., Cyb., II, p. 221),etmême
près de Newcastle (¿d.)- La multiplicité de ces stations rend probable la durée de
l'espèce en Angleterre. M. Watson émet l'idée qu'elle pourrait avoir été indigène
r. !
jIil' •î
:f 1'' . • •li