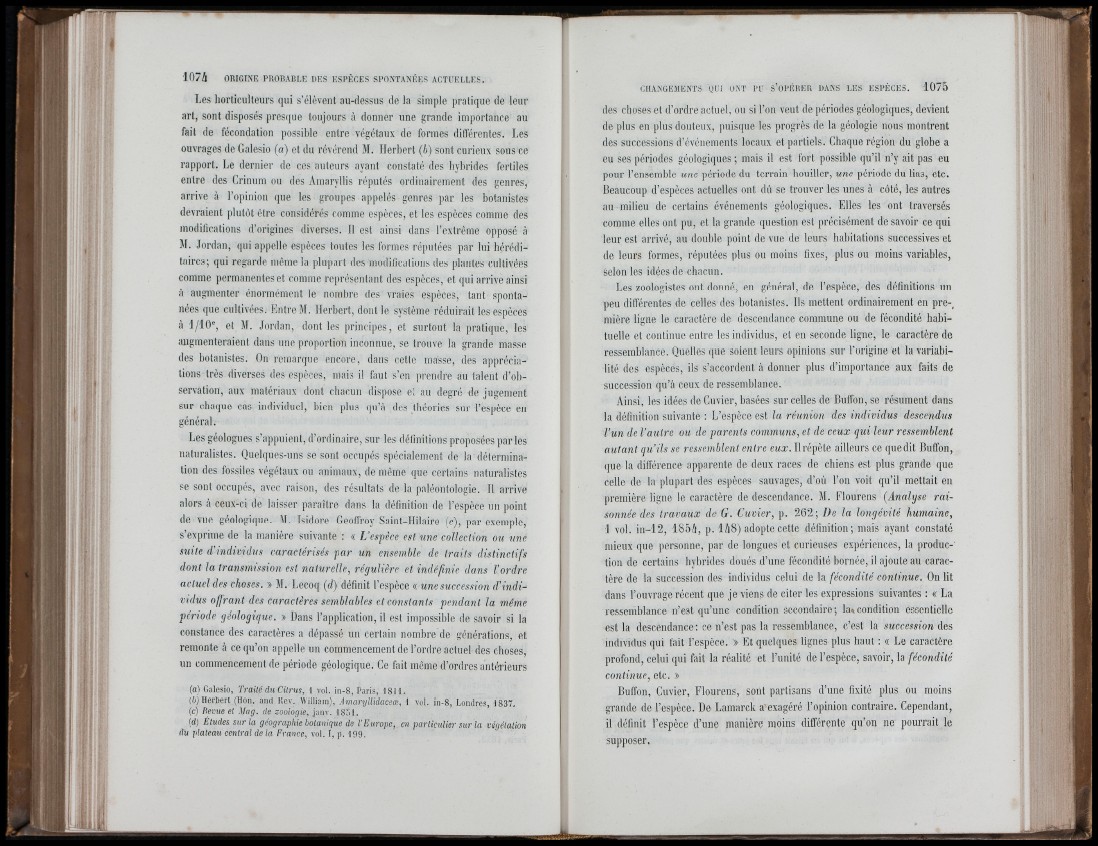
m
1::
1 ?
Il;
4
I
!' , •
tlii: ' ' • I ;
il •
li,
^ t Î' 'If i •
f ' li, s., "jv.i;:-
I â f ^ i
107<4 ORIGTNE PROBABLE DES ESPÈCES SPONTANÉES ACTUELLES.
Les horticulteurs qui s'élèvent au-dessus de la simple pratique de leur
art, sont disposés presijue toujours à donner une grande importance au
fait de fécondation possible entre végétaux de formes différentes. Les
ouvrages de Galesio (a) et du révérend M. Herbert (/>) sont curieux sous ce
rapport. Le dernier de ces auteurs ayant constaté des hybrides fertiles
entre des Crinuni ou des Amaryllis réputés ordinairement des genres^
arrive à l'opinion que les groupes appelés genres par les botanistes
devraient plutôt êlre considérés comme espèces, et les espèces comme des
modifications d'origines diverses. Il est ainsi dans l'extrême opposé à
M. Jordan, (pii appelle espèces toutes les formes réputées par lui héréditaires;
qui regarde même la plupart des modifications des plantes cultivées
comme permanentes et comme représentant des espèces, et qui arrive ainsi
à augmenter énormément le nombre des vraies espèces, tant spontanées
que cultivées. Entre M. Herbert, dont le système réduirait les espèces
à 1/10% et M. Jordan, dont les principes, et surtout la pratique, les
augmenteraient dans luie proportion inconnue, se trouve la grande masse
des botanistes. On remarque encore, dans cetle masse, des appréciations
très diverses des espèces, mais ii faut s'en prendre au talent d'ol)-
servation, aux matériaux dont chacun dispose el au degré de jugement
sur chaque cas individuel, bien plus qu'à des tiiéories sur l'espèce en
général.
Les géologues s'appuient, d'ordinaire, sur les déiinitions proposées parles
naturalistes. Quelques-uns se sont occupés spécialement de la détermination
des fossiles végétaux ou animaux, de même que certains naturalistes
se sont occupés, avec raison, des résultats de la paléontologie. Il arrive
alors à ceux-ci de laisser paraître dans la définition de l'espèce un point
de vue géologique. M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (c), par exemple,
s'exprime de la manière suivante : « Uespêce est tme collection ou une
suite d"individus caractérisés par un ensemble de traits distinctifs
dont la transmission est naturelle, régulière et indéfinie dans Tordre
actuel des choses. » M. Lecoq (d) définit l'espèce « wie succession d'individus
offrant des caractères semblables et constants pendant la même
période géologique. » Dans l'application, il est impossible de savoir si la
constance des caractères a dépassé un certain nombre de générations, et
remonte à ce qu'on appelle un commencement de l'ordre actuel des choses,
un commencement de période géologique. Ce fait même d'ordres antérieurs
(а) Galesio, Trailé du Citrus, 1 voL in-S, Paris, 1811.
(б) Herbert (Hon. and Rev. William), Amaryllidacece, l vol. in-8, Londres, 1837.
(c) [îevue et Mag. de zoologie, janv. 1851.
((/) Études sur la géographie bolaniqiie do l'Europe^ en particulier sur la végétation
du plateau central de la France, vol. I, p. 199.
CHANGEMENTS ULî O.NT IHT S'oi'ÉHEU UÂINS LES ESPÈCES. 1075
des choses et d'ordre actuel, ou si l'on veut de périodes géologiques, devient
de plus en plus douteux, puisque les progrès de la géologie nous montrent
des successions d'événements locaux et partiels. Chaque région du globe a
eu ses périodes géologiques ; mais il est fort possible qu'il n'y ait pas eu
pour l'ensemble une période du terrain houiller, une période du lias, etc.
Beaucoup d'espèces actuelles ont du se trouver les unes à côté, les autres
au milieu de certains événements géologiques. Elles les ont traversés
comme elles ont pu, et la grande question est précisément desavoir ce qui
leur est arrivé, au double point de vue de leurs habitations successives et
de leurs formes, réputées plus ou moins fixes, plus ou moins variables,
selon les idées de chacun.
Les zoologistes ont donné, en général, de l'espèce, des définitions un
peu différentes de celles des botanistes. Ils mettent ordinairement en pre-^
mière ligne le caractère de descendance commune ou de fécondité habituelle
et continue entre les individus, et en seconde ligne, le caractère de
ressemblance. Quelles que soient leurs opinions sur l'origine et la variabilité
des espèces, ils s'accordent à donner plus d'importance aux faits de
succession qu'à ceux de ressemblance.
Ainsi, les idées de Cuvier, basées sur celles de Buffon, se résument dans
la déiinition suivante : L'espèce est la réunion des individus descendus
Vun de Vautre ou de parents commuiis^ et de ceux qui leur ressemblent
autant qu'ils se ressemblent entre Il répète ailleurs ce quedit Buffon,
que la différence apparente de deux races de chiens est plus grande que
celle de la plupart des espèces sauvages, d'où l'on voit qu'il mettait en
première ligne le caractère de descendance. M. Flourens {Analyse raisonnée
des travaux de G. Cuvier^ p. 262; De la longévité humaine,
1 vol. in-12, 185/i, p. l/i8) adopte cette définition; mais ayant constate
mieux que personne, par de longues et curieuses expériences, la production
de certains hybrides doués d'une fécondité bornée, il ajoute au caractère
de la succession des individus celui de la fécondité continue. On lit
dans l'ouvrage récent que je viens de citer les expressions suivantes : « La
ressemblance n'est qu'une condition secondaire; la^condition essentielle
est la descendance: ce n'est pas la ressemblance, c'est la succession des
individus qui fait l'espèce. » Et quelques lignes plus haut : <( Le caractère
profond, celui qui fait la réalité et l'unité de l'espèce, savoir, la fécondité
continue^ etc. »
Buffon, Cuvier, Flourens, sont partisans d'une fixité plus ou moins
grande de l'espèce. De Lamarck a'exagéré l'opinion contraire. Cependant,
il définit l'espèce d'une manière moins différente qu'on ne pourrait le
supposer.