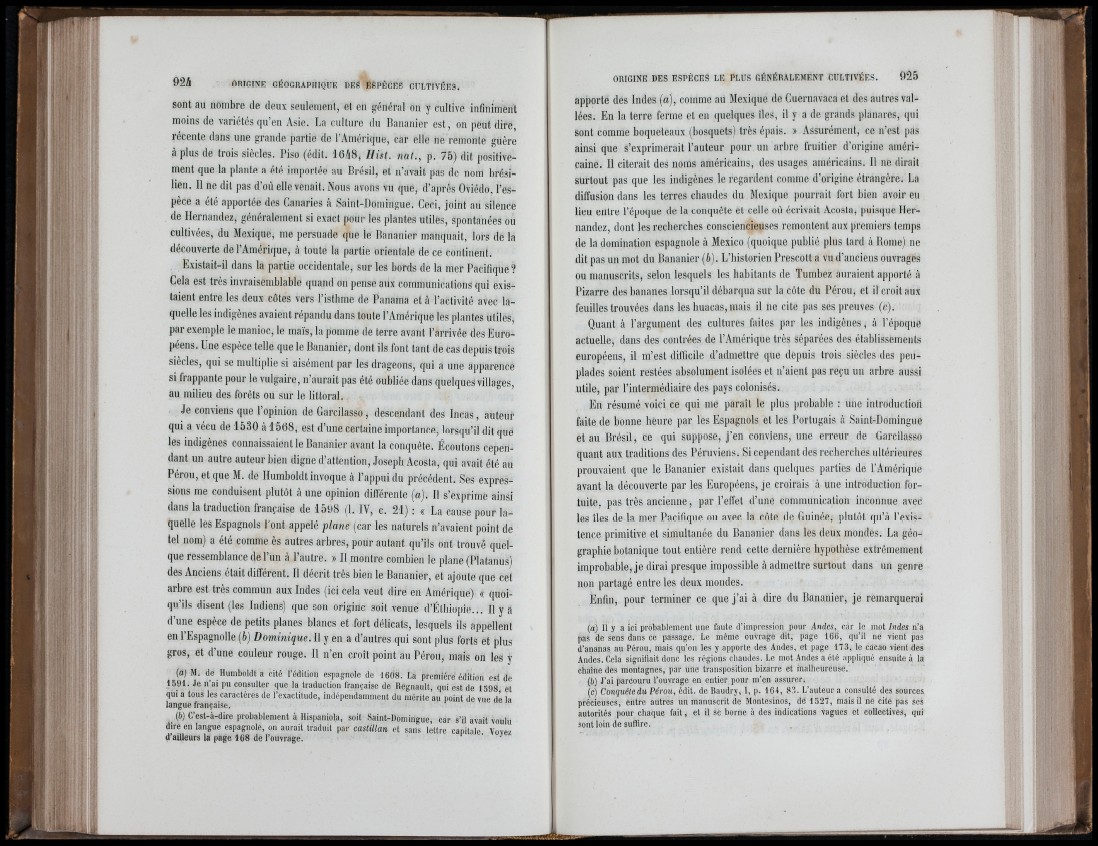
Ul;
t ;•
1
0 2 â ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ESPÈCES CULTIVÉES.
sont au nombre de deux seuleinenl^ et en général on y cultive infiniment
moins de variétés qu'en Asie. La culture du Bananier est, on peut dire,
récente dans une grande partie de rAniérique, car elle ne remonte guère
à plus de trois siècles. Piso (édit. I6/18, Eisl, nat., p. 75) dit positivement
que la plante a été importée au Brésil, et n'avait pas de nom brésilien.
Il ne dit pas d'où elle venait. Nous avons vu que, d'après Oviédo, l'espèce
a été apportée des Canaries à Saint-Domingue. Ceci, joint au silence
de Hernandez, généralement si exact pour les plantes utiles, spontanées ou
cultivées, du Mexique, me persuade que le Bananier manquait, lors de la
découverte de l'Amérique, ù toute la partie orientale de ce continent.
Existait-il dans la partie occidentale, sur les bords de la mer Pacifique?
Cela est très invraisemblable quand on pense aux communications qui existaient
entre les deux côtes vers l'isthme de Panama et à l'activité avec laquelle
les indigènes avaient répandu dans toute l'Amérique les plantes utiles,
par exemple le manioc, le maïs, la pomme de terre avant l'arrivée des Européens.
Une espèce telle que le Bananier, dont ils font tant de cas depuis trois
siècles, qui se multiplie si aisément par les drageons, qui a une apparence
si frappante pour le vulgaire, n'aurait pas été oubliée dans quelques villages,
au milieu des forêts ou sur le littoral.
Je conviens que l'opinion de Garcilasso, descendant des Incas, auteur
qui a vécu de 1530 à 15(58, est d'une certaine importance, lorsqu'il dit que
les indigènes connaissaient le Bananier avant la conquête. Écoutons cependant
un autre auteur bien digne d'attention, Joseph Acosta, qui avait été au
Pérou, et que M. de Humboldt invoque à l'appui du précédent. Ses expressions
me conduisent plutôt à une opinion différente (a). Il s'exprime ainsi
dans la traduction française de 1598 (1. IV, c. 21) : (( La cause pour laquelle
les Espagnols l'ont appelé plane (car les naturels n'avaient point de
tel nom) a été comme ès autres arbres, pour autant qu'ils ont trouvé quelque
ressemblance de l'un à l'autre. » II montre combien le plane (Platanus)
des Anciens était différent. Il décrit très bien le Bananier, et ajoute que cet
arbre est très commun aux Indes (ici cela veut dire en Amérique) « quoiqu'ils
disent (les Indiens) que son origine soit venue d'Ethiopie... Il y a
d'une espèce de petits planes blancs et fort délicats, lesquels ils appellent
en l'Espagnolle (6) Dominique. Il y en a d'autres qui sont plus forts et plus
gros, et d'une couleur rouge. Il n'en croît point au Pérou, mais on les y
(a) M. de Humboldt a cité rédition espagnole de 1608. La première édition est de
1591. Je n'ai pu consulter que la traduction française de Regnault, qui est de 1598 et
qui a tous les caractères de l'exactitude, indépendamment du mérite au point de vue de la
langue française.
{h) C'est-à-dire probablement à Hispaniola, soit Saint-Domingue, car s'il avait voulu
dire en langue espagnole, on aurait traduit par castillan et sans lettre capitale Vovez
d'ailleurs la page 168 de l'ouvrage. '
ORIGINE DES ESPÈCES LE PLUS GÉNÉRALEMENT CULTIVÉES. 925
apporte des Indes (a), comme au Mexique de Cuernavaca et des autres vallées.
En la terre ferme et en quelques îles, il y a de grands planares, qui
sont comme boqueteaux (bosquets) très épais. » Assurément, ce n'est pas
ainsi que s'exprimerait l'auteur pour un arbre fruitier d'origine américaine.
Il citerait des noms américains, des usages américains. Il ne dirait
surtout pas que les indigènes le regardent comme d'origine étrangère. La
diffusion dans les terres chaudes du Mexique pourrait fort bien avoir eu
lieu entre l'époque de la conquête et celle où écrivait Acosta, puisque Hernandez,
dont les recherches consciencieuses remontent aux premiers temps
de la domination espagnole à Mexico (quoique publié plus tard à Rome) ne
dit pas un mot du Bananier (6). L'historien Prescott a vu d'anciens ouvrages
ou manuscrits, selon lesquels les habitants de Tumbez auraient apporté à
Pizarre des bananes lorsqu'il débarqua sur la côte du Pérou, et il croit aux
feuilles trouvées dans les huacas, mais il ne cite pas ses preuves (c).
Quant à l'argument des cultures faites par les indigènes, à l'époque
actuelle, dans des contrées de l'Amérique très séparées des établissements
européens, il m'est difficile d'admettre que depuis trois siècles des peuplades
soient restées absolument isolées et n'aient pas reçu un arbre aussi
utile, par l'intermédiaire des pays colonisés.
En résumé voici ce qui me paraît le plus probable : une introduction
faite de bonne heure par les Espagnols et les Portugais à Saint-Domingue
et au Brésil, ce qui suppose, j'en conviens, une erreur de Garcilasso
quant aux traditions des Péruviens, Si cependant des recherclies ultérieures
prouvaient que le Bananier existait dans quelques parties de l'Amérique
avant la découverte par les Européens, je croirais à une introduction fortuite.
pas très ancienne, par l'effet d'une communication inconnue avec
les îles de la mer Pacifique ou avec la côte de Guinée, plutôt qu'à l'existence
primitive et simultanée du Bananier dans les deux mondes. La géographie
botanique tout entière rend cette dernière hypothèse extrêmement
improbable, je dirai presque impossible à admettre surtout dans un genre
non partagé entre les deux mondes.
Enfin, pour terminer ce que j'ai à dire du Bananier, je remarquerai
(a) Il y a ici probablement une faute d'impression pour Andes, car le mot Indes n*a
pas de sens dans ce passage. Le même ouvrage dit, page 166, qu'il ne vient pas
d'ananas au Pérou, mais qu'on les y apporte des Andes, et page 173, le cacao vient des
Andes. Cela signifiait donc les régions chaudes. Le mot Andes a été appliqué ensuite à la
chaîne des montagnes, par une transposition bizarre et malheureuse.
(b) J'ai parcouru rouvrage en entier pour m'en assurer.
(c) Conquétedu Pérou, édit. de Baudry, I, p. 164, 83. L'auteur a consulté des sources
précieuses, entre autres un manuscrit de Montesinos, dé 1527, mais il ne cite pas ses
autorités pour chaque fait, et il se borne à des indications vagues et collectives, qui
sont loin de suffire.