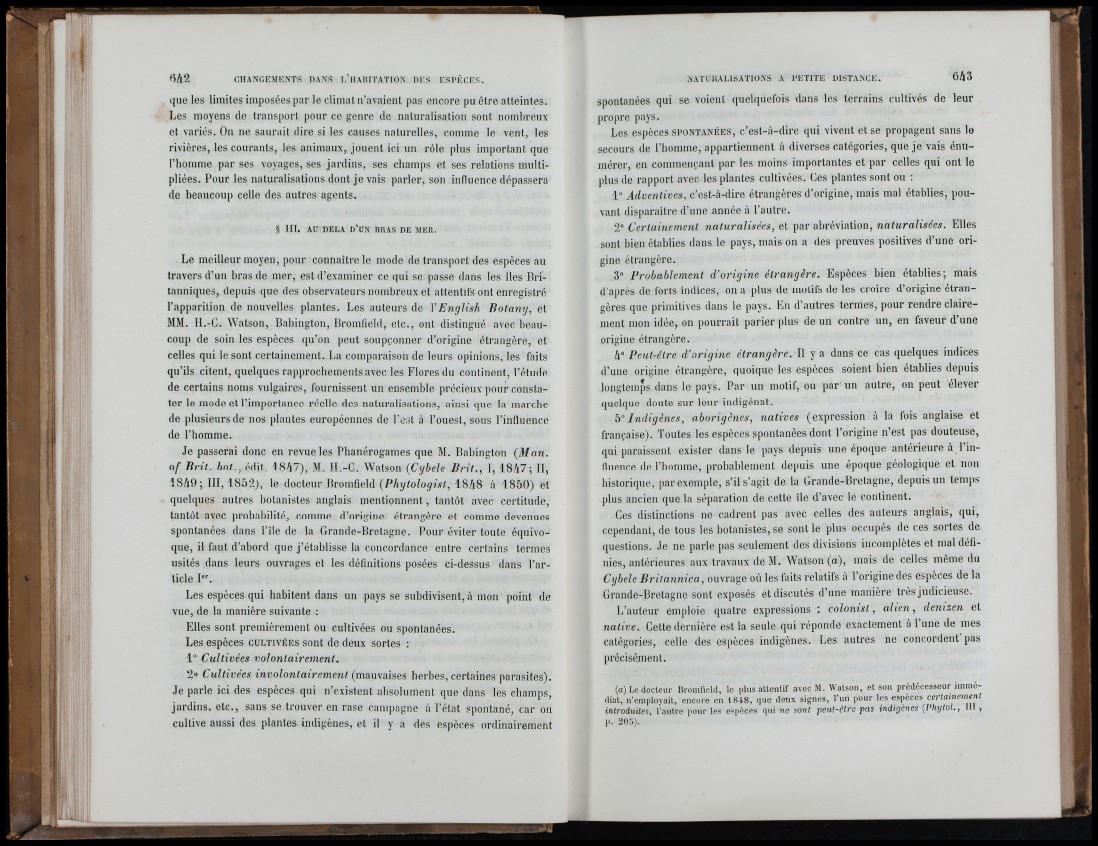
6/i2 CIÏANORMI^NTS DAX.S L IIAIUTATION DKS I-SPKCES.
I I
iil
:w
fe':^
' i l
que les limites imposées par le climat n'avaient pas encore pu être atteintes.
Les moyens de transport pour ce genre de naturalisation sont nombreux
et variés. On ne saurait dire si les causes naturelles, comme le vent, les
rivières, les courants, les animaux, jouent ici un rôle plus important que
l'homme par ses voyages, ses jardins, ses champs et ses relations multipliées.
Pour les naturalisations dont je vais parler, son influence dépassera
de beaucoup celle des autres agents.
§ ML AU DELA D'UN RUAS DE MER.
Le meilleur moyen, pour connaître le mode de transport des espèces au
travers d'un bras de mer, est d'examiner ce qui se passe dans les îles Britanniques,
depuis que des observateurs nombreux et attentifs ont enregistré
l'apparition de nouvelles plantes. Les auteurs de VEnglish Bolany^ et
MM. H.-C. Watson, Babington, Bromfield, etc., ont distingué avec beaucoup
de soin les espèces qu'on peut soupçonner d'origine étrangère, et
celles qui le sont certainement. La comparaison de leurs opinions, les faits
qu'ils citent, quelques rapprochements avec les Flores du continent, l'étude
de certains noms vulgaires, fournissent un ensemble précieux pour constater
le mode et l'importance réelle des naturalisations, ainsi que la marche
de plusieurs de nos plantes européennes de Test à l'ouest, sous l'influence
de l'homme.
Je passerai donc en revue les Phanérogames que M. Babington {Man.
of Brit, bot., édit. 18/|7), M. H.-G. Watson (Cybele Brit,, 1,18/|7; II,
18/|9; 111,1852), le docteur Bromfield 18/i8 à 1850) et
quelques autres botanistes anglais mentionnent, tantôt avec certitude,
tantôt avec probabilité, comme d'origine étrangère et comme devenues
spontanées dans Tîle de la Grande-Bretagne. Pour éviter toute équivoque,
il faut d'abord que j'établisse la concordance entre certains termes
usités dans leurs ouvrages et les définitions posées ci-dessus dans l'article
P^
Les espèces qui habitent dans un pays se subdivisent, à mon point de
vue, de la manière suivante :
Elles sont premièrement Ou cultivées ou spontanées.
Les espèces CULTIVÉES sont de deux sortes :
Cultivées volontairement.
2o Cultivées involontairement (mm\ixhes herbes, certaines parasites).
Je parle ici des espèces qui n'existent absolument que dans les champs,
jardins, etc., sans se trouver en rase campagne à l'état spontané, car on
cultive aussi des plantes indigènes, et il y a des espèces ordinairement
IS'ATLÎUALISATIONS A PKTrfE DISTANCE. 6/Ì3
spontanées qui se voient quelquefois dans les terrains cultivés de leur
propre pays.
Les espèces SPONTANÉES, c'est-à-dire qui vivent et se propagent sans le
secours de l'homme, appartiennent à diverses catégories, que je vais énumérer,
en commençant par les moins importantes et par celles qui ont le
plus de rapport avec les plantes cultivées. Ces plantes sont ou :
Adventices, c'est-à-dire étrangères d'origine, mais mal établies, pouvant
disparaître d'une année à l'autre.
2° Certainement naturalisées, et par abréviation, naturalisées. Elles
sont bien établies dans le pays, mais on a des preuves positives d'une origine
étrangère.
3" Probablement d'origine étrangère. Espèces bien établies; mais
d'après de forts indices, on a plus de motifs de les croire d'origine étrangères
que primitives dans le pays. En d'autres termes, pour rendre clairement
mon idée, on pourrait parier plus de un contre un, en faveur d'une
origine étrangère.
h' Peut-être d'origine étrangère. Il y a dans ce cas quelques indices
d'une origine étrangère, quoique les espèces soient bien établies depuis
longtemps dans le pays. Par un motif, ou par un autre, on peut élever
quelque doute sur leur indigénat.
Indigènes, aborigènes, natives (expression à la fois anglaise et
française). Toutes les espèces spontanées dont l'origine n'est pas douteuse,
qui paraissent exister dans le pays depuis une époque antérieure à l'in-
Iluence de l'homme, probablement depuis une époque géologique et non
historique, par exemple, s'il s'agit de la Grande-Bretagne, depuis un temps
plus ancien que la séparation de cette île d'avec le continent.
Ces distinctions ne cadrent pas avec celles des auteurs anglais, qui,
cependant, de tous les botanistes, se sont le plus occupés de ces sortes de
questions. Je ne parle pas seulement des divisions incomplètes et mal définies,
antérieures aux travaux de M. Watson (a), mais de celles même du
Cybele Britannica, ouvrage où les faits relatifs à l'origine des espèces de la
Grande-Bretagne sont exposés et discutés d'une manière très judicieuse.
L'auteur emploie quatre expressions : colonist, alien, denizen et
native. Cette dernière est la seule qui réponde exactement à l'une de mes
catégories, celle des espèces indigènes. Les autres ne concordent'pas
précisément.
(a) Le docteur Bromfield, le plus attentif avec M. Watson, et son prédécesseur immédiat,
n'employait, encore en 1848, que deux signes, Fun pour les espèces certainement
introduites, l'autre pour les espèces qui ne sont peut-tHre pas indigènes {PhytoL, HJ >
p. 205).