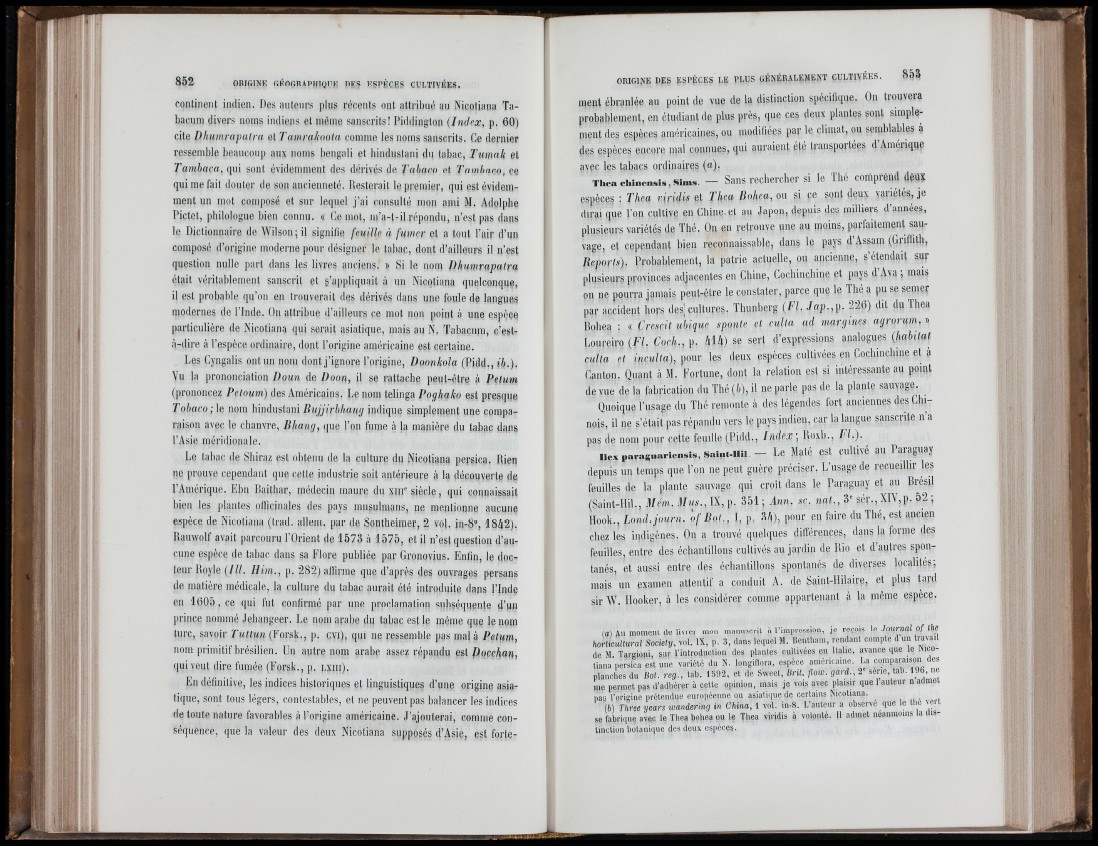
8 5 2 ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ESPÈCES CULTIVÉES.
continent indien. Des aiitenrs plus récents ont attribué au Nicoliana Tabacuni
divers noms indiens et même sanscrits! PidiUiigton {Index, p. 60)
cite Dhumrapaira elTamra/awla comme les noms sanscrits. Ce dernier
ressemble beaucoup aux noms bengali et hindustani du tabac, Tumak et
Tamhaca, qui sont évidemment des dérivés de Tabaco et Tamhaco, ce
qui me fait douter de son ancienneté. Resterait le premier, qui est évidemment
un mot composé et sur lequel j'ai consulté mon ami M. Adolphe
Pictet, philologue bien connu. « Gemot, m'a-t-il répondu, n'est pas dans
le Dictionnaire de Wilson ; il signifie feuille à fumer et a tout l'air d'un
composé d'origine moderne pour désigner le tabac, dont d'ailleurs il n'est
question nulle part dans les livres anciens. » Si le nom Dhumrapalra
était véritablement sanscrit et s'appliquait à un Nicotiana quelconque,
il est probable qu'on en trouverait des dérivés dans une foule de langues
modernes de l'Inde. On attribue d'ailleurs ce mot non point à une espèce
particulière de Nicotiana qui serait asiatique, mais au N. Tabacum, c'està
dire à l'espèce ordinaire, dont l'origine américaine est certaine.
Les Cyngalis ont un nom dont j'ignore l'origine, Doonkola (Pidd., ib.).
Vu la prononciation Doun de Doon, il se rattache peut-être à Pelum
(prononcez Petoum) des Américains. Le nom telinga Poghako est presque
Tobaco;\e nom hindusimi Bîijjirbhang indique simplement une comparaison
avec le chanvre, Bhang, que l'on fume à la manière du tabac dans
l'Asie méridionale.
Le tabac de Shiraz est obtenu de la culture du Nicotiana persica. Rien
ne prouve cependant que cette industrie soit antérieure à la découverte dg
l'Amérique. Ebn Raithar, médecin maure du xiir siècle, qui connaissait
bien les plantes oiiicinales des pays musulmans, ne mentionne aucune
espèce de Nicotiana (trad, alleni, par de Sontheimer, 2 vol. in-8°, 18A2).
Ramvolf avait parcouru l'Orient de 1573 à 1575, et il n'est question d'aucune
espèce de tabac dans sa Flore publiée par Gronovius. Enfin, le docteur
Royle (III. Him., p. 282) affirme que d'après des ouvrages persans
de matière médicale, la culture du tabac aurait été introduite dans l'Inde
en 1605, ce qui fut confirmé par une proclamation subséquente d'un
prince nommé Jehangeer. Le nom arabe du tabac est le même que le nom
turc, savoir Tuttun (Forsk., p. çvi), qui ne ressemble pas mal à Petum,
nom primitif brésilien. Un autre nom arabe assez répandu est Pocchm,
qui veut dire fumée (Forsk., p. LXIII).
En définitive, les indices historiques et linguistiques d'une origine asiatique,
sont tous légers, contestables, et ne peuvent pas balancer les indices
de toute nature favorables à l'origine américaine. J'ajouterai, comme conséquence,
que la valeur des deux Nicotiana supposés d'Asie, est forte-
ORIGINE DES ESPÈCES LE PLUS GÉNÉRALEMENT CULTIVÉES. 853
ment ébranlée au point de vue de la distinction spécifique. On trouvera
probablement, en étudiant de plus près, que ces deux plantes sont simplement
des espèces américaines, ou modifiées par le climat, ou semblables à
des espèces encore mal connues, qui auraient été transportées d'Amérique
avec les tabacs ordinaires (a).
T h e a c h i n e n s i s , s î m s . — Sans rechercher si le Thé comprend deux
espèces : Thea viridis et Thea Boliea, ou si ce sont deux variétés, je
dirai que l'on cultive en Chine, et au Japon, depuis des milliers d'années,
plusieurs variétés de Thé. On en retrouve une au moins, parfaitement sauvage,
et cependant bien reconnaissable, dans le pays d'Assam (Griffith,
Reports). Probablement, la patrie actuelle, ou ancienne, s'étendait sur
plusieurs provinces adjacentes en Chine, Cochinchine et pays d'Ava ; mais
on ne pourra jamais peut-être le constater, parce que le Thé a pu se semer
par accident hors des; cultures. Thunberg {FI. Jap.,]i. 226) dit du Thea
Rohea : « Crescit ubique sponle et: culla ad margines agrorum. »
Loureiro {Fl. Coch., p. hih) se sert d'expressions analogues (habitat
culta et inculta), pour les deux espèces cultivées en Cochinchme et à
Canton. Quant à M. Fortune, dont la relation est si intéressante au point
de vue de la fabrication du Thé {b), il ne parle pas de la plante sauvage.
Quoique l'usage du Thé remonte à des légendes fort anciennes des Chinois,
il ne s'était pas répandu vers le pays indien, car la langue sanscrite n'a
pas de nom pour cette feuille (Pidd., Index ; Roxb., F L ) .
I i e x p a r a s « a r i c n s i ^ , s a î n t . i i i i . - Le Maté est cultivé au Paraguay
depuis un temps que l'on ne peut guère préciser. L'usage de recueillir les
feuilles de la plante sauvage qui croît dans le Paraguay et au Rrésil
(Saint-Hil., Mém.Mus.,11,^. 35 1 ; Ann. sc. nat.,^^ sér., XIV,p. 52 ;
Hook., Lond.journ. of Bol., 1, p. 3Z|), pour en faire du Thé, est ancien
chez les indigènes. On a trouvé quelques différences, dans la forme des
feuilles, entre des échantillons cultivés au jardin de Rio et d'autres spontanés,
et aussi entre des échantillons spontanés de diverses localités;
mais'un examen attentif a conduit A. de Saint-Hilaire, et plus tard
sir W. Hooker, à les considérer comme appartenant à la même espèce.
( a U u moment de livrer mon manuscril à l'impression, je reçois le Journal of Ihe
horticuUural Society, vol. IX, p. 3, dans lequel M. Benthain, rendant compte d un travail
de M Targioni sur l'introduction des plantes cultivées en Italie, avance que le Nicotiana'persica
est une variété du N. longillora, espèce américaine. La comparaison des
planches du Bot. reg., tab. 1592, et de Sweet, lirit. flow. gard.^T serie, tab. 196 ne
me permet pas d'adhérer à cette opinion, mais je vois avec plaisir que 1 auteur n acimet
paa l'origine prétendue européenne ou asiatique de certains Nicotiana. _
\h) Three years wandering in China, 1 vol. in-8. L'auteur a observe que le the Neii
se fabrique avec le Thea bohea ou le Thea viridis à volonté. Il admet néanmoins la distinction
botanique des deux espèces.