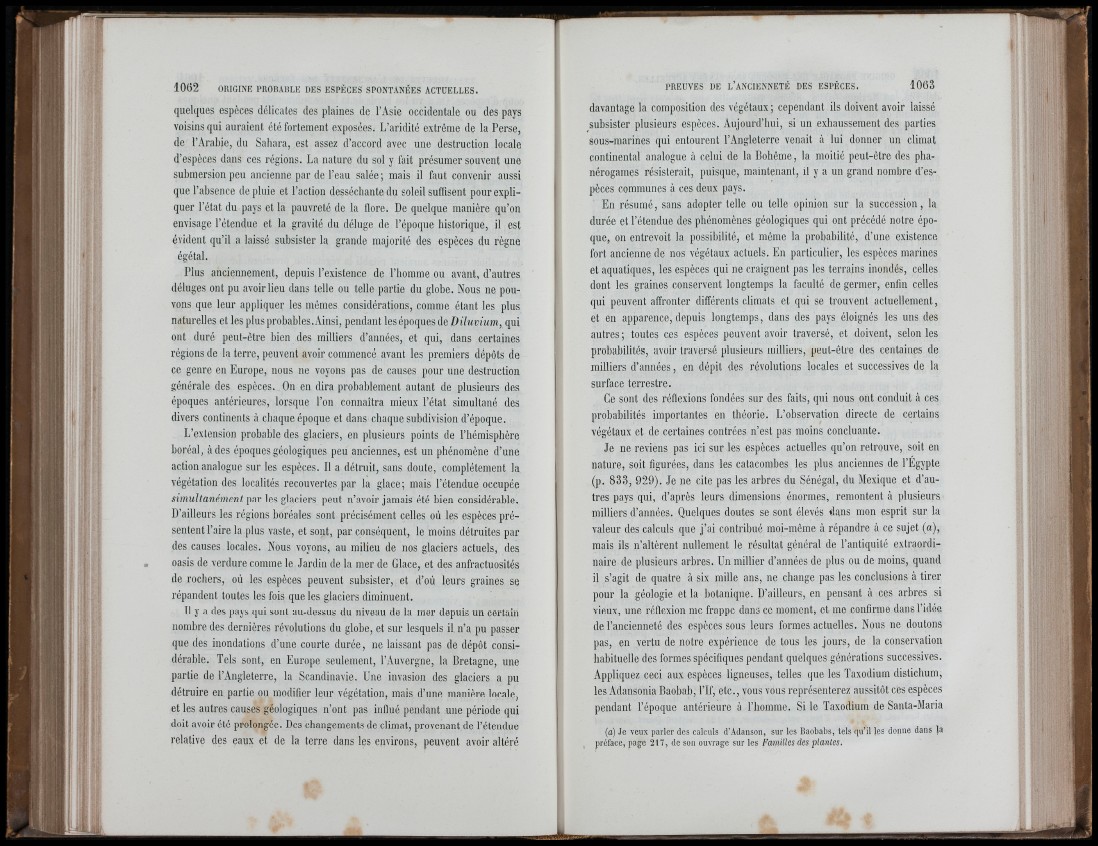
'ì
i
r
\\\ Jlhf
k l i '
il • •
. . . I
I li;
1 0 G 2 ORIGINE PROBABLE DES ESPÈCES SPONTANÉES ACTUELLES.
quelques espèces délicates des plaines de l'Asie occidentale ou des pays
voisins qui auraient été fortement exposées. L'aridité extreme de la Perse,
de l'Arabie, du Sahara, est assez d'accord avec une destruction locale
d'espèces dans ces régions. La nature du sol y fait présumer souvent une
submersion peu ancienne par de l'eau salée; mais il faut convenir aussi
que l'absence de pluie et l'action desséchante du soleil suffisent pour expliquer
l'état du pays et la pauvreté de la llore. De quelque manière qu'on
envisage l'étendue et la gravité du déluge de l'époque historique, il est
évident qu'il a laissé subsister la grande majorité des espèces du règne
égétal.
Plus anciennement, depuis l'existence de l'homme ou avant, d'autres
déluges ont pu avoir lieu dans telle ou telle partie du globe. Nous ne pouvons
que leur appliquer les mêmes considérations, comme étant les plus
naturelles et les plus probables. Ainsi, pendant les époques de qui
ont duré peut-être bien des milliers d'années, et qui, dans certaines
régions de la terre, peuvent avoir commencé avant les premiers dépôts de
ce genre en Europe, nous ne voyons pas de causes pour une destruction
générale des espèces. On en dira probablement autant de plusieurs des
époques antérieures, lorsque l'on connaîtra mieux l'état simultané des
divers continents à chaque époque et dans chaque subdivision d'époque.
L'extension probable des glaciers, en plusieurs points de l'hémisphère
boréal, à des époques géologiques peu anciennes, est un phénomène d'une
action analogue sur les espèces. Il a détruit, sans doute, complètement la
végétation des localités recouvertes par la glace; mais l'étendue occupée
simultanément par les glaciers peut n'avoir jamais été bien considérable.
D'ailleurs les régions boréales sont précisément celles où les espèces présentent
l'aire la plus vaste, et sont, par conséquent, le moins détruites par
des causes locales. Nous voyons, au milieu de nos glaciers actuels, des
oasis de verdure comme le Jardin de la mer de Glace, et des anfractuosités
de rochers, où les espèces peuvent subsister, et d'où leurs graines se
répandent toutes les fois que les glaciers diminuent.
Il y a des pays qui sont au-dessus du niveau de la mer depuis un certain
nombre des dernières révolutions du globe, et sur lesquels il n'a pu passer
que des inondations d'une courte durée, ne laissant pas de dépôt considérable.
Tels sont, en Europe seulement, l'Auvergne, la Bretagne, une
partie de l'Angleterre, la Scandinavie. Une invasion des glaciers a pu
détruire en partie ou modifier leur végétation, mais d'une manière locale,
et les autres causes géologiques n'ont pas influé pendant une période qui
doit avoir été prolongée. Des changements de climat, provenant de l'étendue
relative des eaux et de la terre dans les environs, peuvent avoir altéré
PREUVES DE L ANCIENNETÉ DES ESPÈCES, 1 0 6 3
davantage la composition des végétaux; cependant ils doivent avoir laissé
subsister plusieurs espèces. Aujourd'hui, si un exhaussement des parties
sous-marines qui entourent l'Angleterre venait à lui donner un climat
continental analogue à celui de la Bohême, la moitié peut-être des phanérogames
résisterait, puisque, maintenant, il y a un grand nombre d'espèces
communes à ces deux pays.
En résumé, sans adopter telle ou telle opinion sur la succession, la
durée et l'étendue des phénomènes géologiques qui ont précédé notre époque,
on entrevoit la possibilité, et même la probabilité, d'une existence
fort ancienne de nos végétaux actuels. En particulier, les espèces marines
et aquatiques, les espèces qui ne craignent pas les terrains inondés, celles
dont les graines conservent longtemps la faculté de germer, enfin celles
qui peuvent affronter différents climats et qui se trouvent actuellement,
et en apparence, depuis longtemps, dans des pays éloignés les uns des
autres; toutes ces espèces peuvent avoir traversé, et doivent, selon les
probabilités, avoir traversé plusieurs milliers, peut-être des centaines de
milliers d'années, en dépit des révolutions locales et successives de la
surface terrestre.
Ce sont des réflexions fondées sur des faits, qui nous ont conduit à ces
probabilités importantes en théorie. L'observation directe de certains
végétaux et de certaines contrées n'est pas moins concluante.
Je ne reviens pas ici sur les espèces actuelles qu'on retrouve, soit en
nature, soit figurées, dans les catacombes les plus anciennes de l'Egypte
(p. 833, 929). Je ne cite pas les arbres du Sénégal, du Mexique et d'autres
pays qui, d'après leurs dimensions énormes, remontent à plusieurs
milliers d'années. Quelques doutes se sont élevés dans mon esprit sur la
valeur des calculs que j'ai contribué moi-même à répandre à ce sujet (a),
mais ils n'altèrent nullement le résultat général de l'antiquité extraordinaire
de plusieurs arbres. Un millier d'années de plus ou de moins, quand
il s'agit de quatre à six mille ans, ne change pas les conclusions à tirer
pour la géologie et la botanique. D'ailleurs, en pensant à ces arbres si
vieux, une réflexion me frappe dans ce moment, et me confirme dans l'idée
de l'ancienneté des espèces sous leurs formes actuelles. Nous ne doutons
pas, en vertu de notre expérience de tous les jours, de la conservation
habituelle des formes spécifiques pendant quelques générations successives.
Appliquez ceci aux espèces ligneuses, telles que les Taxodium distichum,
les Adansonia Baobab, l'If, etc., vous vous représenterez aussitôt ces espèces
pendant l'époque antérieure à l'homme. Si le Taxodium de Santa-Maria
(a) Je veux parler des calculs d'Adanson, sur les Baobabs, tels qu'il les donne dans la
préface, page 217, de son ouvrage sur les Familles des plantes.