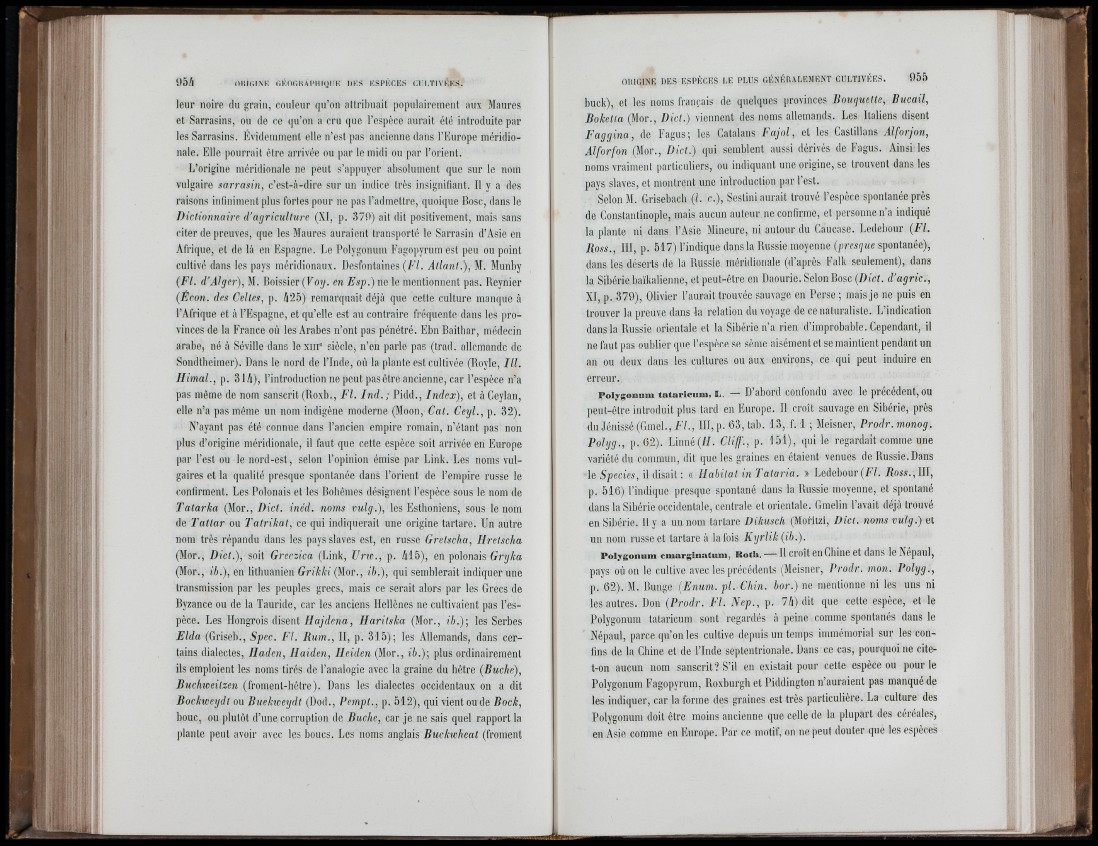
Vô/i OlUGliNE GÈOGUAPlllUUE DKS ESPÈCES (JUI/riVÉKS.
leur noire du grain, couleur qu'on attribuait, populairement aux Maures
et Sarrasinsj ou de ce qu'on a cru que l'espèce aurait été introduite par
les Sarrasins. Evidemment elle n'est pas ancienne dans l'Europe méridionale.
Elle pourrait etre arrivée ou par le midi ou par l'orient.
L'origine méridionale ne peut s'appuyer absolument que sur le nom
vulgaire .varra.fm, c'est-à-dire sur un indice très insignifiant. Il y a des
raisons infiniment plus fortes pour ne pas l'admettre, quoique Bosc, dans le
Dictionnaire (Vagriculture (XI, p. 370) ait dit positivement, mais sans
citer de preuves, que les Maures auraient transporté le Sarrasin d'Asie en
Afrique, et de là en Espagne. Le Polygonum Fagopyrum est peu ou point
cultivé dans les pays méridionaux. Desfontaines (F/ . Allant.)^ M. Munby
( F / . d'Alger)^ M. Boissier (Toy. en Esp,) ne le mentionnent pas. Reynier
{Ècon. des Celtes^ p. /|25) remarquait déjà que cette culture manque à
l'Afrique et à l'Espagne, et qu'elle est au contraire fréquente dans les provinces
de la France où les Arabes n'ont pas pénétré. Ebn Baithar, médecin
arabe, né à Séville dans le xiir siècle, n'en parle pas (trad, allemande de
Sondtheimer). Dans le nord de l'Inde, où la plante est cultivée (Royle, IlL
Himal.^ p. 31Zi), l'introduction ne peut pas être ancienne, car l'espèce n'a
pas même de nom sanscrit (Roxb., Fl. Ind. ; Pidd., Index), et à Ceylan,
elle n'a pásmeme un nom indigène moderne (Moon, Cat, CeyL^ p. 32).
N'ayant pas été connue dans l'ancien empire romain, n'étant pas non
plus d'origine méridionale, il faut que cette espèce soit arrivée en Europe
par l'est ou le nord-est, selon l'opinion émise par Link. Les noms vulgaires
et la qualité presque spontanée dans l'orient de l'empire russe le
confirment. Les Polonais et les Bohèmes désignent l'espèce sous le nom de
l'atarka (Mor., Diet. inéd. noms vulg.)^ les Esthoniens, sous lenoni
de Tatlar ou Tatrikat, ce qui incliquerait une origine tartare. Un autre
nom très répandu dans les pays slaves est, en russe Gretseha, Hretseka
(Mor., Dict.)^ soit Greczica (Link, Urto., p. /ll5), en polonais G^ry/ca
(Mor.j ¿6.), en lithuanien Grikki (Mor., ih.), qui semblerait indiquer une
transmission par les peuples grecs, mais ce serait alors par les Grecs de
Byzance ou de la Tauride, car les anciens Hellènes ne cultivaient pas l'espèce.
Les Hongrois disent//ay(/ma, Haritska (Mor., th.); les Serbes
Elda (Griseb., Spec. FI. Rum., II, p. 315); les x\llemands^ dans certains
dialectes, Haden, Haiden, Heiden (Mor., ib.)', plus ordinairement
ils emploient les noms tirés de l'analogie avec la graine du hêtre (Buche),
Buchioeilzen (froment-hetre). Dans les dialectes occidentaux on a dit
Bockweydt ou Buekiveydt (Dod., Peinpt., p. 512), qui vient ou de Bock,
bouc, ou plutôt d'une corruption de Buche, car je ne sais quel rapport la
)lanle peut avoir avec les boucs. Les noms anglais Buckwheat (froment
-Ji
OHIGINK DES KSPKCES LE PLUS CrENKUALEMKNT CULTIVÉES. 955
buck), et les noms français de quelques provinces Bomjuetie, Bucail,
Boketia (Mor., Did.) viennent des noms allemands. Les Italiens disent
Faggina, de Fagus; les Catalans Fajol, et les Castillans Alforjon,
Alforfon (Mor., Dici,) qui semblent aussi dérivés de Fagus. Ainsi les
noms vraiment particuliers, ou indiquant une origine, se trouvent dans les
pays slaves, et montrent une introduction par Test.
Selon M. Grisebach (l. c.), Seslini aurait trouvé l'espèce spontanée près
de Constantinople, mais aucun auteur ne confirme, et personne n'a indiqué
la plante ni dans l'Asie Mineure, ni autour du Caucase. Ledebour (F/.
Ross., m, p. 517) l'indique dans la Russie moyenne {presque spontanée),
dans les déserts de la Russie méridionale (d'après Falk seulement), dans
la Sibérie baïkalienne, et peut-être en Daourie. Selon Bosc {Diet, d'agric.,
XI, p. 379), Olivier l'aurait trouvée sauvage en Perse ; mais je ne puis en
trouver la preuve dans la relation du voyage de ce naturaliste. L'indication
dans la Russie orientale et la Sibérie n'a rien d'improbable. Cependant, il
ne faut pas oublier que l'espèce se sème aisément et se maintient pendant un
an ou deux dans les cultures ou aux environs, ce qui peut induire en
erreur.
P o ï y g o i m m t a t a r î c i B m , L. — D'abord confondu avec le précédent, ou
peut-être introduit plus tard en Europe. Il croît sauvage en Sibérie, près
du Jénissé(GmeL, .F/., HI, p. 63, tab. 13, f. 1 ; Meisner, Prodr.monog.
Polyg., p. 62). Linné ( / / . Cliff., p. 151), qui le regardait comme une
variété du commun, dit que les graines en étaient venues de Russie.Dans
le Species, il disait : (( Uabilat in Tataria. » Ledebour(F/. Ross.,111,
p. 516) l'indique presque spontané dans la Russie moyenne, et spontané
dans la Sibérie occidentale, centrale et orientale. Gmelin l'avait déjà trouvé
en Sibérie. Il y a un nom tarlare Dikusch (Moritzi, Diet, noms vulg.) et
un nom russe et tartare à la ibis Kyrlik {ib.).
Polygonum cmargSnatum, Roth. •— Il croît en Chine et dans le Népaul,
pays où on le cultive avec les précédents (Meisner, Prodr. mon. Polyg.,
p. 62). M. Bunge {Enum. pL Chin, bor.) ne mentionne ni les uns ni
les autres. Don {Prodr. FL Nep., p. 7/i) dit que cette espèce, et le
Polygonum tataricum sont regardés ù peine comme spontanés dans le
Népaul, parce qu'on les cultive depuis un temps immémorial sur les confins
de la Chine et de l'Inde septentrionale. Dans ce cas, pourquoi ne citet
on aucun nom sanscrit? S'il en existait pour cette espèce ou pour le
Polygonum Fagopyrum, Roxburgh et Piddington n'auraient pas manqué de
les indiquer, car la forme des graines est très particulière. La culture des
Polygonum doit être moins ancienne que celle de la plupart des céréales,
en Asie comme en Europe. Par ce motif, on ne peut douter que les espèces