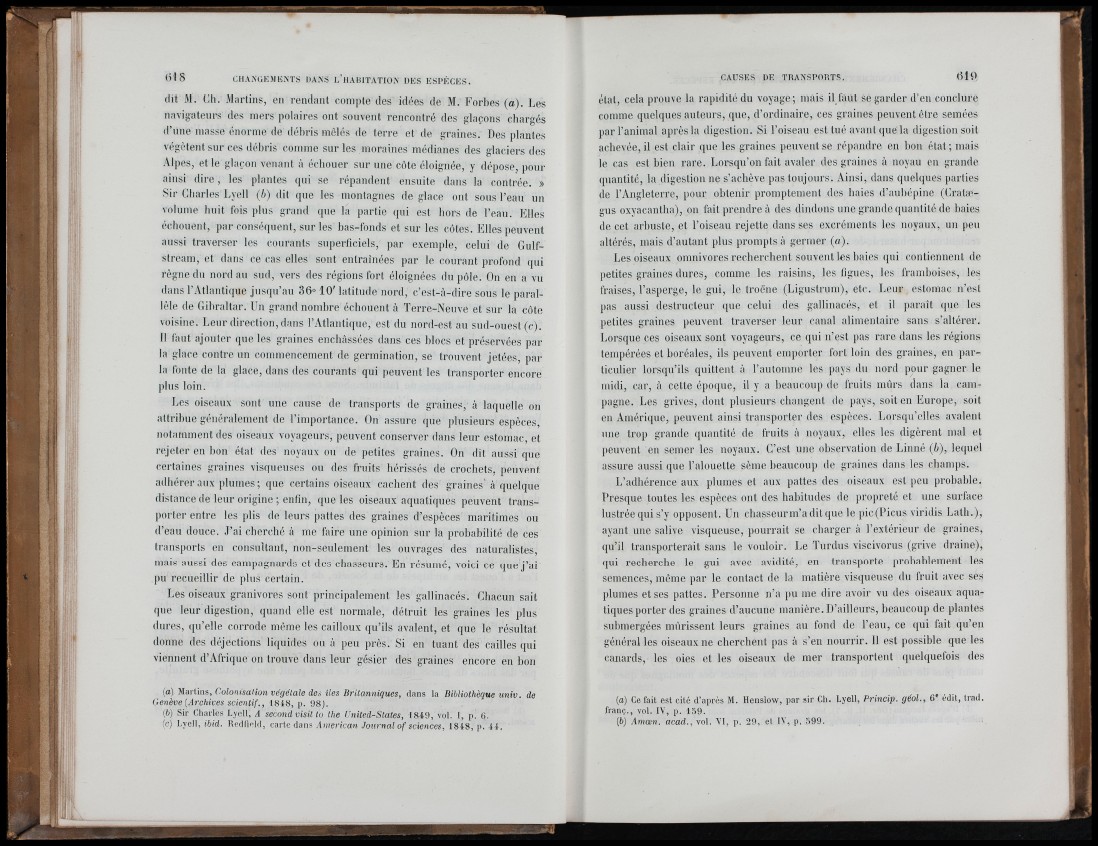
AV
^ f '
1
'i
i'• 4
(VI8 CllAMiEMlvNTS DANS l'iIADITATIOA DES ESPÈCES.
dit M. Ch. Martins, en rendant compte des idées de M. Forbes (a). Les
navigateurs des mers polaires ont souvent rencontré des glaçons chargés
d'une masse énorme de débris mêlés de terre et de graines. Des plantes
végètent sur ces débris comme sur les moraines médianes des glaciers des
Alpes, et le glaçon venant à échouer sur une côte éloignée, y dépose, pour
ainsi dire, les plantes qui se répandent ensuite dans la contrée. »
Sir diaries Lyell (ò) dit que les montagnes de glace ont sous l'eau un
volume huit ibis plus grand que la partie qui est hors de l'eau. Elles
échouent, par conséquent, sur les bas-fonds et sur les côtes. Elles peuvent
aussi traverser les courants superficiels, par exemple, celui de Gulfstream,
et dans ce cas elles sont entraînées par le courant profond qui
règne du nord au sud, vers des régions fort éloignées du pôle. On en a vu
dans l'Atlantique jusqu'au 36» 10' latitude nord, c'est-à-dire sous le parallèle
de Gibraltar. Un grand nombre échouent à Terre-Neuve et sur la côte
voisine. Leur direction, dans l'Atlantique, est du nord-est au sud-ouest (c).
Il faut ajouter que les graines enchâssées dans ces blocs et préservées par
la glace contre un commencement de germination, se trouvent jetées, par
la fonte de la glace, dans des courants qui peuvent les transporter encore
j)lus loin.
Les oiseaux sont une cause de transports de graines, à laquelle on
attribue généralement de l'importance. On assure que plusieurs espèces,
notamment des oiseaux voyageurs, peuvent conserver dans leur estomac, et
rejeter en bon état des noyaux ou de petites graines. On dit aussi que
certaines graines visqueuses ou des fruits hérissés de crochets, peuvent
adhérer aux plumes; que certains oiseaux cachent des graines' à quelque
distance de leur origine ; enfin, que les oiseaux aquatiques peuvent transporter
entre les plis de leurs pattes des graines d'espèces maritimes ou
d'eau douce. J'ai cherché à me faire une opinion sur la probabilité de ces
ti-ansports en consultant, non-seulement les ouvrages des naturalistes,
mais aussi des campagnards et des chasseurs. En résumé, voici ce que j'ai
pu recueillir de plus certain.
Les oiseaux granivores sont principalement les gallinacés. Chacun sait
que leur digestion, quand elle est normale, détruit les graines les plus
dures, qu'elle corrode même les cailloux qu'ils avalent, et que le résultat
donne des déjections liquides OU u peu près. Si en tuant des cailles qui
viennent d'Afrique on trouve dans leur gésier des graines encore en bon
(a) Mai-lins, Colonisation végétale des îles Britanniques, dans la Bibliothèque imiv. de
Genève {Archives scientif,, 18i8, p. 98j.
(b) Sir Charles Lyell, A second visit lo the United-S taies, 1849, vol. 1, p. 6.
(c) Lyell, ibid. Rediìeld, carte dans American Journal of sciences, 1848, p. -ii.
CAUSES DE TRANSPORTS. 619
(HaLj cela prouve la rapidité du voyage; mais il faut se garder d'en conclure
comme quelques auteurs, que, d'ordinaire, ces graines peuvent être semées
par l'animal après la digestion. Si l'oiseau est tué avant que la digestion soit
achevée, il est clair que les graines peuvent se répandre en bon élat; mais
le cas est bien rare. Lorsqu'on fait avaler des graines à noyau en grande
quantité, la digestion ne s'achève pas toujours. Ainsi, dans quelques parties
de l'Angleterre, pour obtenir promptement des haies d'aubépine (Crataegus
oxyacantha), on fait prendre à des dindons une grande quantité de baies
de cet arbuste, et l'oiseau rejette dans ses excréments les noyaux, un peu
altérés, mais d'autant plus prompts à germer (a).
Les oiseaux omnivores recherchent souvent les baies qui contiennent de
petites graines dures, comme les raisins, les figues, les framboises, les
fraises, l'asperge, le gui, le (roëne (Ligustrum), etc. Leur estomac n'est
pas aussi destructeur que celui des gallinacés, et il paraît que les
petites graines peuvent traverser leur canal alimentaire sans s'altérer.
Lorsque ces oiseaux sont voyageurs, ce qui n'est pas rare dans les régions
tempérées et boréales, ils peuvent emporter fort loin des graines, en particulier
lorsqu'ils quittent à raulonme les pays du nord pour gagner le
midi, car, à cette époque, il y a beaucoup de fruits mûrs dans la campagne.
Les grives, dont plusieurs changent de pays, soit en Europe, soit
en Amérique, peuvent ainsi transporter des espèces. Lorsqu'elles avalent
une trop grande quantité de fruits à noyaux, elles les digèrent mal et
peuvent en semer les noyaux. C'est une observation de Linné (6), lequel
assure aussi que l'alouette sème beaucoup de graines dans les champs.
L'adhérence aux plumes et aux pattes des oiseaux est peu probable-
Presque toutes les espèces ont des habitudes de propreté et une surface
lustrée qui s'y opposent. Un chasseurm'aditque le pic(Picus viridis Lath.),
ayant une salive visqueuse, pourrait se charger à l'extérieur de graines,
qu'il transporterait sans le vouloir. Le Turdus viscivorus (grive draine),
qui recherche le gui avec avidité, en transporte probablement les
semences, même par le contact de la matière visqueuse du fruit avec ses
plumes et ses pattes. Personne n'a pu me dire avoir vu des oiseaux aquatiques
porter des graines d'aucune manière. D'ailleurs, beaucoup de plantes
submergées mûrissent leurs graines au fond de l'eau, ce qui fait qu'en
général les oiseaux ne cherchent pas à s'en nourrir. Il est possible que les
canards, les oies et les oiseaux de mer transportent quelquefois des
(a) Ce fait est cité d'après M. Henslow, par sir Ch. Lyell, Princip. géoL, édit, trad,
franç., vol. lY, p. 159.
{b) Amoen, acad,, vol. Yl, p. 29, el ÏV, p. 599.
> i
4