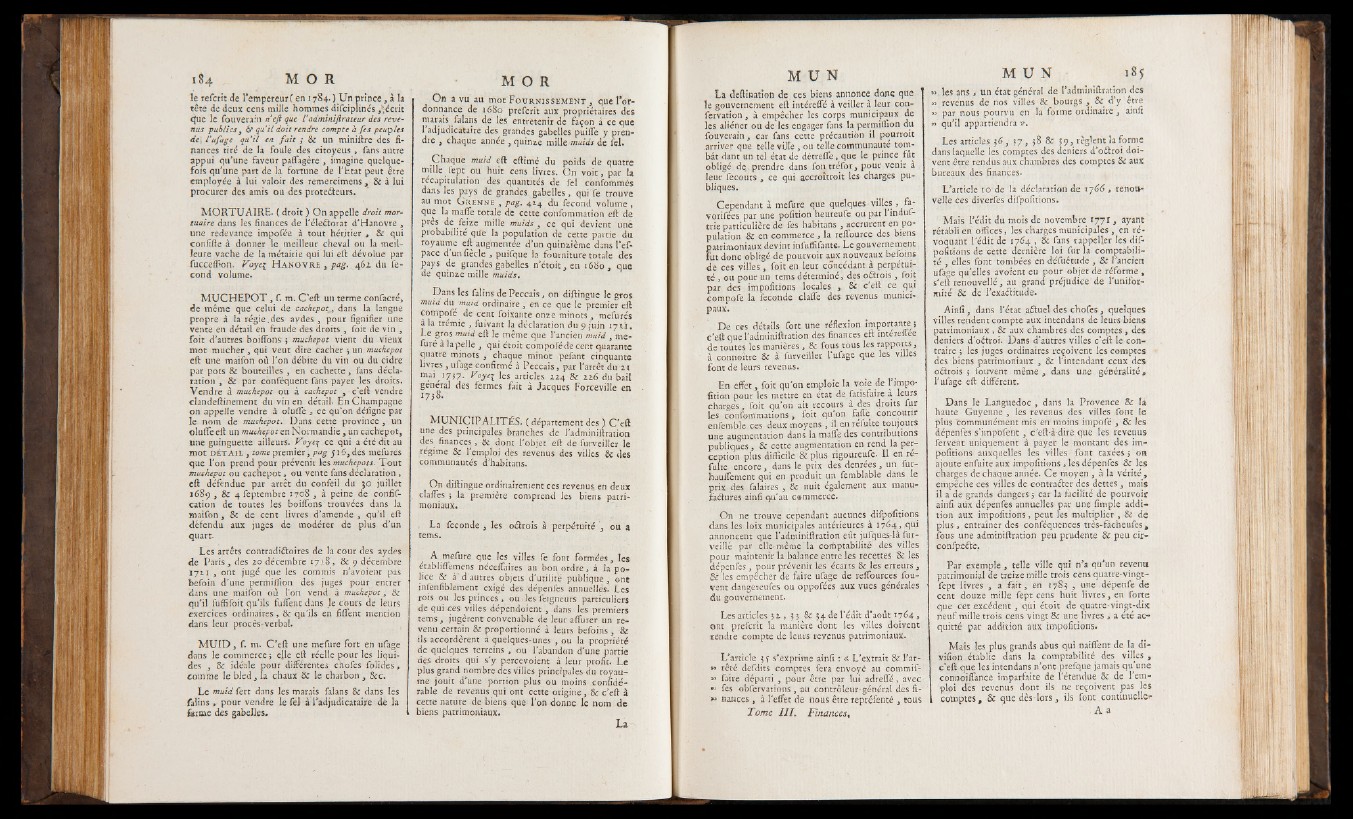
i*4 M O R M O R
le refcrit de l’empereur ( en 1784» ) Un prince, à la
tête de deux cens mille hommes difcipîinés Récrit
cfue le fouverain n e f i que V a dm in if ir a t e u r d e s r e v e n
u s p u b l i c s 3 & q u 'i l d o i t r end re c om p te a f i s p e u p le s
d e j ! u fa g e q u 'i l en f a i t ; & un miniftre des finances
tiré de la foule des citoyeus , fans autre
appui qu’ une faveur paflagère , imagine quelquefois
qu’une part de la fortune de l’Etat peut être
employée à lui valoir des remercimens, & à lui
procurer des amis ou des protecteurs.
M O R TU A IR E . ( droit ) On appelle d r o it m o r tu
a ir e dans les finances de l’éle&orat d’Hanovre ,
une redevance impofée à tout héritier , & qui
confifte à donner le meilleur cheval ou la meilleure
vache de la métairie qui lui eft dévolue par
fuccelfion. V o y e^ Ha n o v r e , p a g . 462 du fécond
volume.
On a vu au mot Fournissement , que l’ordonnance
de 16S0 piefcrit aux propriétaires des
marais fajans de les entretenir de façon à'ce que
1 adjudicataire des grandes gabelles puifle y prendre
y chaque année 3 quinze mille<muids de fel.
Chaque m u id eft eftimé du poids de quatre
mille fept ou huit cens livres. On v o it, par la
récapitulation des quantités de fel confommés
dans les pays de grandes gabelles, qui Te trouve
au mot G renne , p a g . 424 du fécond volume ,
que la mafTe totale de cette confommation eft de
près de fe^ize mille m u id s s ce qui devient une
probabilité qtfe la population de cette partie du
royaume eft augmentée d’un quinzième dans l’ef-
pace d unfiècle , puifque la fourniture totale des
pays de grandes gabelles n’é to it ,e n 1680, que
de quinze mille m u id s ,
M U C H E P O T , f. m. C ’eft un terme confacré,
de même que celui de c a c h e p o t dans la langue
propre à la régie.des aydes , pour lignifier une
vente en détail en fraude des droits , foit de vin ,
foit d’autres boiflons 3 m u c h e p o t vient du vieux
mot mucher , qui veut dire cacher 3 un m u chep o t
eft une maifon ou l’on débite du vin ou du cidre
par pots & bouteilles , en cachette, fans déclaration
, & par cônféquent fans payer les droits.
Vendre à m u ch e p o t ou à ca ch ep o t , c’eft vendre
clandeftinement du vin en détail. En Champagne
on appelle vendre à olufle * ce qu’on défîgne par
le nom de m u c h e p o t. Dans cette province , un
olufle eft un m u ch ep o t en Normandie, un cachepot,
une guinguette ailleurs. V o y e \ ce qui a été dit au
mot d é t a i l , tom e premier, p a g 516, des mefures
que l’on prend pour prévenir les m u c h e p o ts . Tout
m u c h e p o t ou cachepot, ou vente fans déclaration ,
eft défendue par arrêt du confeil du 30 juillet
1689 , & 4 feptembre 1708 , à peine de confif-
cation de toutes les boiflons trouvées dans la
maifon, & de cent livres d’amende , qu’il eft
défendu aux juges de modérer de plus d’un
quart.
Les arrêts contradictoires de la cour des aydes
de Paris, des 20 décembre 1718 , & 9 décembre
17 11 , ont jugé que les commis n’avoient pas
befoin d’une permiflion des juges pour entrer
dans une maifon où l’on vend à m u c h e p o t , &
qu’il fuffifoit qu’ils fuflent dans le cours de leurs
exercices ordinaires, & qu’ils en fiflent mention
dans leur procès-verbal.
M U ID , f. m. C ’eft une mefure fort en ufage
dans le commerce 3 ejle eft réelle pour les liquides
, & idéale pour différentes; chofes foiides,
comme le bled, la chaux & le charbon , & c .
Le m u id fert dans les marais falans & dans les
falins » pour vendre le fel à l’adjudicataire de la
ferme des gabelles*
Dans les falins de Peccais, on diftingue le gros
m u id à n m u zd ordinaire compofe de cent foixan,t ee no nczee qmuein loet sp ,r emmeiefru reéfst
Là ela gtrroesm ie , fuivant la déclaration du 9 juin 171,4. m u id eft le même, que l’ancien m u id , me-
qfuuraét ràe lam pienlolets , , qucih aéqtouiet cmoimnopto fpéedfeacnetn tc iqnuqauraannttee livres, ufage confirmé à Peccais, par l’arrêt du 21 gme7anie/rIa7l 3d7e- s Vfoeyrme ie sle sf aaitr tiàc leJsa,c 2q2u4e s& F o2r2c6ev dilnl eb aeinl 1738.
unMe dUesN pICrinIPciApaLleIsT ÉbrSa.n c( hdeésp adrete ml’eandtm diensif )t raCti’oenft rdeegsi mfien a&nc el’se,m &pl odi odnets l’roebvjeentu se fdt edse vfiullrevse il&le rd eles communautés d’habitans.
claOflens d;i fltain gpuree moridèirnea icroemmepnret ncdes lreesv ebnuiesn, se np daeturix
moniaux.
, La fécondé , les oCfcrois a perpétuité , ou a tems.
A mefure que les villes fe font formées, les
léitcaeb li&fl emà 'edn'asu ntréecse folabijreetss adu’ ubtiolinté o rpdurbel,i qàu ela, poont
infenfiblement exigé des dépenfes annuelles. Les
rdoei sq uoiu c else sv pilrleins cdeésp, eonudJoeise nfte,i gdnaenusr s lepsa rptriecmuliieerrss
tems, jugèrent convenable de leur affurer un revenu
certain & proportionné à leurs befoins , &
idles aqcuceolqrduèerse ntet rràe qinuse l,q uoeus -ul’naebsa n, dooun lda’ upnreo pprairétiteé
dpeluss dgrroaintds nqoumi bsr’ey dpeesr vcielvleosi epnritn cài plaeluers dpuro rfoity. aLue
me jouit d’une portion plus ou moins confidé-
rable de revenus qui ont cette origine, & c’eft à cbeietntes npaatturrime odnei abuixen. s que l’on donne le nom de
La
M U N
La deftinatîon de ces biens annonce donc que
le gouvernement eft intérefle à veiller à leur con-
fervation, à empêcher les corps municipaux de
les aliéner ou de les. engager fans la permiflion du
fouverain, car fans cette précaution il pourroit
.arriver que telle ville > ou telle communauté tombât
dant un tel état de détrefle, que le prince fût
obligé dq,prendre dans fontréfor, pour venir a
leur fecours , ce qui accroîtroit les charges publiques.
Cependant à mefure que quelques villes , fa-
vorifées par une pofition heureufe qu par 1 induf-
trie particulière de fes habitans , accrurent en po- |
pulation & en commerce , la reflource des biens
patrimoniaux devint infuffifante. Le gouvernement
fut donc obligé de pourvoir aux nouveaux befoins
de ces villes, foit en leur concédant à perpétuité
, ou pour un tems déterminé, des oéhois, foit
par des impofitions locales , & c’eft ce qui
compofe la fécondé clafle des revenus municipaux.
De ces détails fort une réflexion importante 5
c ’eft que l’adminiftration des finances eft interefiee
de toutes les manières, & fous tous les rapports,
à connoître & à furveiller l’ufage que les villes
font de leurs revenus.
En effet, foit qu’on emploie la voie de l’impo-
fition pour les mettre en état de fatisfaire a leurs
charges, foit qu’on ait recours à des droits fur
les oonfommations, foit qu on fafle concourir
enfemble ces deux moyens , il en réfulte toujours
une augmentation dans la maffe des contributions
publiques, & cette augmentation en rend la perception
plus difficile & plus rigoureufe. Il en refuite
encore, dans le prix des denrées, un fur-
hauflement qui en produit un femblable dans le
prix des falaires , & nuit également aux manufactures
ainfi qu’ au commerce.
On ne trouve cependant aucunes difpofitions
dans les loix municipales antérieures à 1764? -qui
annoncent que l’adminillration eût jufques-là fur-
veiflé par elle-même Ta comptabilité des villes
pour maintenir la balance entre les recettes & les
dépenfes , pour prévenir les écarts & les erreurs,
& les empêcher de faire ufage de reflources fou-
vent dangereufes ou oppofées aux vues générales
du gouvernement.
Les articles 3 2 , 3 3 &: 34 de l ’édit d’août 1764,
ont prefcrit la manière dont les villes doivent
rendre compte de leurs revenus patrimoniaux.
L ’ article 3 y s’exprime ainfi : « L’ extrait & Far-'
» rêté defdits comptes fera envoyé au commif-
»» faire départi , pour être par lui adrefle, avec
fes obfervations , au contrôleur-général des fi-
w nances , à l’effet de nous être repréfentê , tous
Tome III. Finances%
M U N 185
53. les ans > un état général de l’adminiftration des
« revenus de nos villes & bourgs , & d’y être
95 par nous pourvu en la forme ordinaire , ainfi
» qu’il appartiendra ».
Les articles 36, 3 7 , 38 & 39, règlent la forme
dans laquelle les comptes des deniers d’oCtroi doivent
être rendus aux chambres des comptes & aux
bureaux des finances-
L ’article 10 de la déclaration de iy66, renouvelle
ces diverfes difpofitions.
Mais l’édit du mois de novembre 1 7 7 1 , ayant
rétabli en offices, les charges municipales , en révoquant
l ’édit de 1764 , & fans rappelier les dif*
pofitions de cette dernière loi fur la- comptabilité
, elles font tombées en défuétude , & l ’ancien
ufage qu’elles avaient eu pour objet de réforme,
s’eft renouvelle, au grand préjudice de l’uniformité
& de l’exaCtitude.
Ainfi, dans l’état aCtuel des chofes, quelques
villes rendent compte aux intendans de leurs biens
patrimoniaux , & aux chambres des comptes > des
deniers d’oétroi. Dans d’autres villes c’eft le contraire
3 les juges ordinaires reçoivent les comptes
des biens patrimoniaux , & l’intendant ceux des
oélrois j foirvent même, dans une généralité,
l’ ufage eft différent.
Dans le Languedoc, dans la Provence &r là
haute Guyenne , les revenus des villes font le
plus Communément mis en moins impofé , & les
dépenfes s’impufent, c ’eft-à-dire que les reveuus
fervent uniquement à payer le montant des impofitions
auxquelles les villes font taxées î o»
ajoute enfuite aux impofitions, les dépenfes & les
charges de chaque année. C e moyen , à la vérité,
empêche ces villes de contracter des dettes , mais
il a de grands dangers j car la facilité de pourvoir
ainfi aux dépenfes annuelles par une fimple addition
aux impofitions, peut les multiplier, & de
plus , entraîner des conféquences très-fâcheufes,
fous une adminiftration peu prudente & peu cir-
çonfpeéte.
Par exemple , telle ville qui n’a qu’un revenu
patrimonial de treize mille trois cens quatre-vingt-
fept livres , a Tait, en 1783 , une vdépenfe de
cent douze mille fept cens huit livres, en forte
que cet excédent, qui étoit de quatre-vingt-dix
neuf-mille trois cens vingt & une livres , a été acquitté
par addition aux impofitions.
Mais les plus grands abus qui naiflent de la di-
vifion établie dans la comptabilité des villes ,
c’ eft que les intendans n’ont prefque jamais qu’une
çonnoifîance imparfaite de l’étendue & de l’emploi
dès revenus dont ils ne reçoivent pas lès
comptes , & que dès-lors, ils font ^continuelle^
. A a