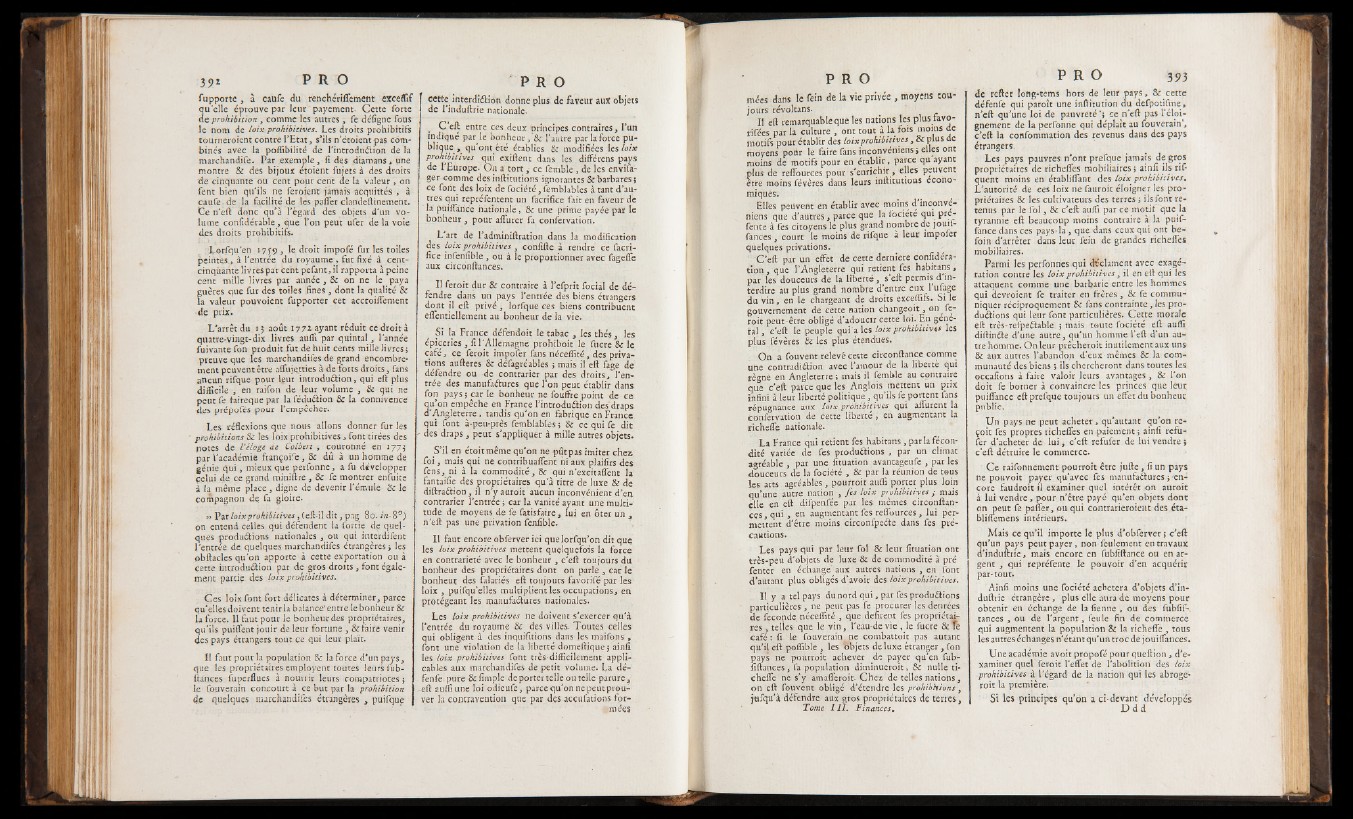
fupporte , à caufe du renchériflement exceflif
qu'elle éprouve par leur ' payement- Cette forte
ae prohibition , comme les autres , fe défigne fous
le nom de loix prohibitives. Les droits prohibitifs
tourneroient contre l’Etat , s’ils n’étoient pas combinés
avec la poflîbilité de l’introdnClion de la
marchandife. Par exemple, fi des diamans, une
montre & des bijoux étoient fujets à des droits
de cinquante ou cent popr cent de la valeur , on
fent bien qu’ils ne feraient jamais acquittés , à
caufe de la facilité de les paffer clandeftinement.
Ce n’eft dohc qu’ à l’égard des objets d’un volume
confîdérable, que l’on peut ufer de la voie
des droits prohibitifs.
Lorfqu’en 17^9 » Ie droit impofé fur les toiles
peintes, à l’entrée du royaume > fut fixé à cent-
cinquante livres par cent pefant, il rapporta à peine
cent mille livres par année, & on ne le paya
guères que fur des toiles .fines , dont la qualité &
la valeur pouvoient fupporter cet accroiflement
de prix.
L ’arrêt du 13 août 1772. ayant réduit ce droit à
quatre-vingt-dix livres aulfi par quintal , l ’année
fuivante fon produit fut de huit cents mille livres}
preuve que les marchandifes de grand encombrement
peuvent être affujqtties à de forts droits, fans
aucun rifque pour l$ur introduction, qui eft plus
difficile , en raifon de leur volume , & qui ne
peut fe faireque par la féduCtion & la connivence
des prépofés pour l’empêcher.
Les réflexions que nous allons donner fur les
prohibitions & les loix prohibitives, font tirées des
potes de Véloge de Colbert , couronné en 1773
par l’académie françoife, & dû à un homme de
génie qui , mieux que perfonne, a fu développer
çelui de ce grand miniltre , & fe montrer enfuite
à la même place, digne de devenir l’ émule & le
compagnon de fa gloire.
» Par loix prohibitives, (eft-il dit, pag 80. in-8°)
pn entend celles qui défendent la fortie de quelques
productions nationales , ou qui interdirent
l ’entree de quelques marchandifes étrangères} les
obftacles qu'on apporte à cette exportation ou à
çette introduction par de gros droits, font également
partie des loix prohibitives.
Ces loix font fort délicates à déterminer, parce
qu’elles doivent tenir la balance’ entre le bonheur &
la force. Il faut pour le bonheur des propriétaires,
qu’ ils puiflent jouir de leur fortune , & faire venir
des pays étrangers tout ce qui leur plaît. Il
Il faut pour la population & la force d’un pays,
que les propriétaires employent toutes leurs fub-
ftances fuperflues à nourrir leurs compatriotes}
le fo.uverain concourt à ce but par la prohibition I
de quelques marchandifes étrangères , puifque |
cette interdiction donne plus de faveur aux objets
de l’induftrie nationale.
. Ç entre ces deux principes contraires, l’un
indiqué parle bonheur, & l’autre par la force publique
, qu’ont été établies & modifiées les loix
prohibitives qui exiftent dans les différens pays
de l’Eu rope. On a to r t, ce fembie, de les envisager
comme des inftitutions ignorantes & barbares;
ce fo n d e s loix de fociété, femblables à tant d’autres
qui repréfentent un facrifice fait en faveur de
la puiflarice nationale, & une prime payée par le
bonheur, pour aflurer fa confervation.
L’art de l’adminiftration dans la modification
des loix prohibitives, confifte à rendre ce facrifice
infenfible, ou à le proportionner avec fagefte
aux circonftances.
Il feroit dur & contraire à l’efprit fociâl de défendre
dans un pays l’entrée des biens étrangers
dont il eft privé, lorfque ces biens contribuent
elfentiellement au bonheur de la vie.
Si la France défendoit le tabac , les thés, les
épiceries, fi l'Allemagne prohiboit le fucre & le
café, ce feroit impofer fans néceflité, des privations
aufteres & défagréables } mais il eft fage de
défendre ou de contrarier par des droits, l’entrée
des manufactures que l’on peut établir dans
fon pays} car le bonheur ne fouffre point de ce
qu’on empêche en France l’introduCfcion des draps
d’Angleterre, tandis qu’on en fabrique en France
qui font à-peu-près femblables} & ce qui fe dit
• des draps , peut s’appliquer à mille autres objets.
S’il en étoitmême qu’on ne pût pas imiter chez
fo i, mais qui ne contribuafîent ni aux plaifirs des
fens, ni à la commodité, & qui n’excitaflent la
fantaifie des propriétaires qu’à titre de luxe & de
diftraCtion , il n’y auroit aucun inconvénient d’en
contrarier l’entrée} car la vanité ayant une multitude
de moyens de fe fatisfaire, lui en ôter un ,
n’eft pas une privation fenfible.
Il faut encore obferver ici quelorfqu’on dit quç
les loix prohibitives mettent quelquefois la force
en contrariété avec le bonheur, c’eft toujours du
bonheur des propriétaires dont on parle , car le
bonheur des falariés eft toujours favorifé par les
lo ix , puifqu’elles multiplient les occupations, en
protégeant les manufactures nationales.
Les loix prohibitives ne doivent s’exercer qu’à
l’entrée du royaume & des villes. Toutes celles
qui obligent à des inquifitions dans les maifpns ,
font une violation de la liberté domeftique} ainfi
les loix prohibitives font très-difficilement applicables
aux marchandifes de petit volume. La dé-
fenfe pure & fimple de porter telle ou telle parure,,
eft auflî une loi odieufe, parce qu’on ne peut prouver
la contravention que par des aeçufations for-
•mées
mées dans le fein de la vie privée , moyens toujours
révoltans. • '
Il eft remarquable qüe les nations les plus favo-
rifées par la culture , ont tout à la fois moins de
motifs pour établir des loix prohibitives, oc plus de
moyens polir le faire fans inconvéniens} elles ont
moins de motifs poür en établir, parce qu ayant
plus de refîources pour s’enrichir, elles peuvent
etre moins févères dans leurs inftitutions economiques.
Elles peuvent en établir avec moins d inconve-
niens que d’autres, parce que la fociété qui pre-
fente à fes citoyens le plus grand nombre de jouil-
fances , court le moins de rifque à leur impofer
quelques privations.
' C ’eft par un effet de cette derniere considération
, que l ’Angleterre qui retient fes habitans,
par les douceurs de la liberté, s’eft permis d interdire
au plus grand nombre d’entre eux 1 ufage
du v in, en le chargeant de droits exceffifs. Si le
gouvernement de cette nation changeait, on fe-
roit peut-être obligé d’adoucir cette loi. En general
, c’eft le peuple qui a les loix prohibitives les
plus févères & les plus étendues.
On a fouvent relevé cette circonftance comme
une contradiction avec l'amour de la liberté qui
règne en Angleterre > mais il fembie au contraire
que c’eft parce que les Anglois mettent un prix
infini à leur liberté politique, qu’ils fe portent fans
répugnance aux loix prohibitives qui auurent la
confervation de cette liberté, en augmentant la
richeffe nationale.
La France qui retient fes habitans, parla fécondité
variée de fes productions , par un climat
agréable , par une fituation avantageufe , par les
douceurs de la fociété , & par la réunion de tous
les arts agréables, pourrait auflî porter plus loin
qu’ une autre nation , fes loix prohibitives ; mais
elle en eft difpenfée par les mêmes circonftances
, qui , en augmentant fes reftburces , lui permettent
d’être moins circonfpeCte dans fes précautions.
Les pays qui par leur fol & leur fituation ont
très-peu d’objets de luxe & de commodité à pré
fenter en échange'aux autres nations , en font
d’autant plus obligés d’avoir des loix prohibitives.
Il y a tel pays du nord qui, par fes productions
particulières, ne peut pas fe procurer les denrées
de fécondé néceffité , que défirent fes propriétaires
, telles que le v in , l’eau-de vie , le fucre & Te
café: fi le fouverain ne combattoit pas autant
qu’il eft poflible , les objets de luxe étranger, fon
pays ne pourroit achever de payer qu’en fub-
fiftances, fa population diminuerait, & nulle ti-
cheffe ne s’ y amafferoit. Chez de telles nations,,
on eft fouvent obligé d’étendre les prohibitions,
jufqu’à défendre aux gros propriétaires de terres,
Tome I I I . Finances»
de refter îofig-tems hors de leur pays, & cette
défenfe qui paroît une inftitution du defpotifme,
n’eft qu’une loi de pauvreté ‘} ce n’eft pas l’éloignement
de la perfonne qui déplaît au fouverain’,
c ’eft la confommation des revenus dans des pays
étrangers.
Les pays pauvres n’ont prefque jamais de gros
propriétaires de richefles mobiliaires} ainfi ils r if
quent moins en établiflant des loix prohibitives»
L ’autorité de ces loix ne fauroit éloigner les propriétaires
& les cultivateurs des terres} ils font retenus
par le fo l, & c’eft aufli par ce motif que la
tyrannie eft beaucoup moins contraire à la puif-
fance dans ces pays-la, que dans ceux qui ont be-
foin d’arrêter dans leur fein de grandes richefles
mobiliaires.
Parmi les perfonnes qui déclament avec exagération
contre les loix prohibitives , il en eft qui les
attaquent comme une barbarie entre les hommes
qui devroient fe traiter en frères, & fe communiquer
réciproquement & fans contrainte,les productions
qui leur font particulières. Cette morale
eft très-refpeCtable } mais toute fociété eft auflî
diftinCte d’une autre, qu’ un homme l’eft d’ un autre
homme. On leur prêcherait inutilement aux uns
& aux autres l’abandon d’eux mêmes & la communauté
des biens } ils chercheront dans toutes les
occafions à faire valoir leurs avantages , & l’on
doit fe borner à convaincre les princes que leur
puiflance eft prefque toujours un effet du bonheur
public.
Un pays n e peut acheter, qu’autant qu’on reçoit
fes propres richefles en paiement; ainfi refu-
fer d’acheter de lu i, c’eft refufer de lui vendre ;
c’eft détruire le commerce.
C e raifonnemefit pourroit être jufte, fi un pays
ne pouvoit payer qu’avec fes manufactures} -encore
faudroit il examiner quel, intérêt on auroit
à lui vendre, pour n’être payé qu’en objets dont
qn peut fe paffer, ou.qui contrarieroient des éta-
bliffemens intérieurs.
Mais ce qu’il importe le plus d’obferver} c’eft
qu’un pays peut payer, non feulement entravaux
d’induttrie, mais encore en fubfiftance ou en argent
, qui repréfente le pouvoir d’en acquérir
par-tout.
Ainfi moins une fociété achètera d’objets d’in-
duftrie étrangère , plus elle aura de moyens pour
obtenir en échange de la fienne , ou des fubfite
tances , ou de l’argent, feule fin de commerce
qui augmentent la population & la richefle , tous
les autres échanges n’étant qu’un troc de jouiflances.
Une académie avoit propofé pour queftion, d’examiner
quel feroit l’effet de l’abolition de.s loix
prohibitives à l’égard de la nation qui les abrogea
i t la première.
Si les principes qu’on a ci-devant développés
D d d