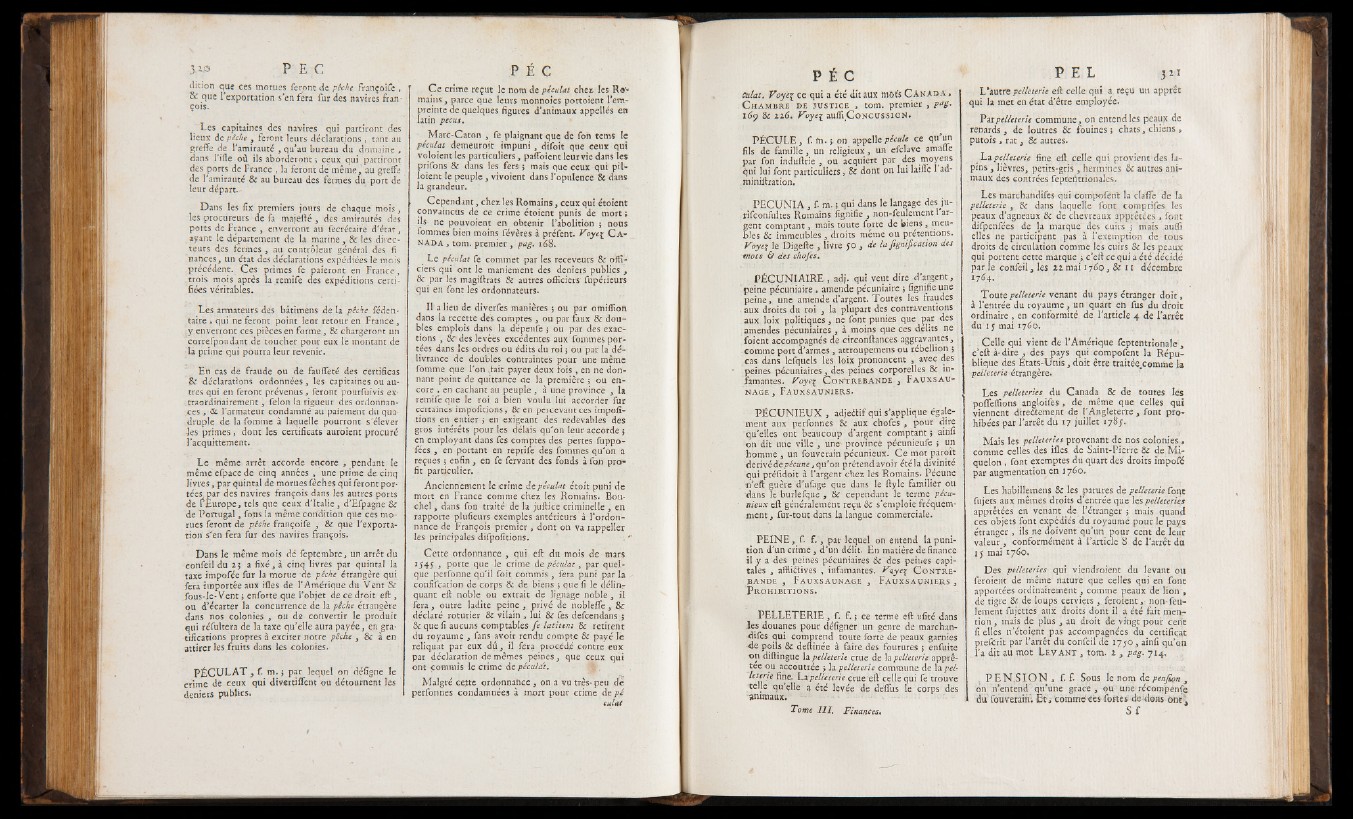
dition que ces morues feront de pêche françoife ,
& que 1’exportation s’en fera fur des navires fran-
çois.
Les capitaines des navires qui partiront des
lieux de pêche , feront leurs déclarations , tant au
greffe de l’amirauté , qu’au bureau du domaine ,
dans Tifle où ils aborderont ; ceux qui partiront
des ports de France , la feront de même, au greffe
de 1J amirauté & au bureau des fermes du port de
leur départ.
Dans les fix premiers jours de chaque mois,
les procureurs de fa majerté , des amirautés des
ports de France , enverront au fecrétaire d’état ,
ayant le département de la marine, & les directeurs
des fermes , au contrôleur général des fi
nances, un état des déclarations expédiées le mois
précédent. Ces primes fe paieront en France ,
. trois mois après la remife des expéditions certifiées
véritables.
Les armateurs des bâtimens de la pêche féden-
taire, qui ne feront point leur retour en France,
y enverront ces pièces en forme, & chargeront un
correfpondant de toucher pour eux le montant de
la prime qui pourra leur revenir.
En cas de fraude ou de faufleté des certificas
3c déclarations ordonnées, les capitaines ou autres
qui en feront prévenus, feront pourfuivis extraordinairement
y félon la rigueur des ordonnance
s & l’armateur condamné au paiement du quadruple
de la fomme à laquelle pourront s'élever 4es primes, dont les certificats auroient procuré
l’acquittement.
Le même arrêt accorde encore , pendant, le
même efpace de cinq années , une prime de cinq
livres, par quintal de morues fèches qui feront portées.
par des navires françois dans les autres ports
de rEurope, tels que ceux d’ Italie, d’Efpagne &
de Portugal, fojis la même condition que ces morues
feront de pêche françoife , & que l’exportation
s’en fera fur des navires françois.
Dans le même mois dé feptembre, un arrêt dii
confeil du 23 a fixé, à cinq livres par quintal la
taxe impofée fur la morue de pêche étrangère qui
fera importée aux ifles de l’Amérique du Vent &
fous-le-Vent j enforte que l’objet de ce droit e ft,
ou d’ écarter la concurrence de la pêche étrangère
dans nos colonies , ou de convertir le produit
qui réfultera de la taxe qu’elle aura payée, en gratifications
propres à exciter notre pêche , & à en ;
attirer les fruits dans les colonies.
P É C U L A T , f. m. ; par lequel on défigne le
crime dè ceux qui divertiffent ou détournent les
deniers publics,
C e crime reçut le nom de péculat chez les Romains,
parce que leurs monnoies portoient l’empreinte
de quelques figures d’animaux appelles en
latin pecus.
Maré-Caton , fe plaignant que de fon tems le
péculat demeuroit impuni, difoit que ceux qui
voloient les particuliers, pafloient leur vie dans les
prifons & dans les fers > mais que ceux qui pii»
loient le peuple, vivoient dans l’opulence & dans
la grandeur.
jj Cependant, chez les Romains, ceux qui étoient
convaincus de ce crime étoient punis de mort ;
ils ne pouvoient en obtenir l’abolition j nous
fommes bien moins févères à préfent. V^oye^ C a n
ad a , tom. premier , pag. 168.
Le péculat fe commet par les receveurs & officiers
qui ont le maniement des deniers publics ,
&: par les magiftrats & autres officiers fupérieurs
cjui en font les ordonnateurs.
II a lieu de diverfes dans la recette des commpatensiè ,r eosu 3 poaur fpaaurx o&m idffoiouri
bles emplois dans la dépenfe 5 ou par des exactions
, &r des levées excédentes aux fommes porltiéversa
ndcaen sd lee s doorudbrleess ocuo éndtriatsi ndtues r opio j uoru upnaer mlaê dmée
fnoamntm peo qinute dle’ oqnu viftataitn cpea ydeer dlae upxr efomisiè ,r ee n5 noeu d eonncore
, en cachant au peuple, à une province , la creemrtaifien eqsu eim lpe ofriotiio an sb, ie&ne nv opuelruc eluvia nat ccceosr idmerp offuî-r tions en entier 3 en exigeant des redevables des
egnro esm ipnltoéyrêatnst pdoanusr lfeess cdoémlapist eqsu d’oesn pleeurrte asc fcuoprpdoe-; fées , en portant en reprife des fommes qu’on a
frietç upeasr t5i ceunlfiienr ., en fe fervant des fonds à ion proAnciennement
le crime de péculat étoit puni de
mort en France comme chez les Romains. Bou-
ch e l, dans fon traité de la juftice criminelle , en
rapporte plufîeurs exemples antérieurs à l’ordonnance
de François premier, dont on va rappeller
les principales difpofîtions. ' ; "
Cette ordonnance , qui eft du mois de mars
1545 , porte que le crime de péculat, par quelque
perfonne qu’il foit commis, fera puni par la -
confifcation de corps & de biens ; que fi le qélinr
quant efl: noble ou extrait de lignage noble , il
fera, outré ladite peine , privé de nobleffe , &
déclaré roturier & vilain , lui & fes defcendans j
& que fi aucuns comptables fe latitent & retirent
du royaume , fans avoir rendu compt.e & payé le
reliquat par eux d û , il fera procédé .contre eux
par déclaration de mêmes peines, que ceux qiii
ont commis le crime de péculat.
Malgré cette ordonnance ^ on a vu très-peu dè
perfonnes condamnées à mort pour crime de pé
culot
culat. Voyè^ ce qui a été dit aux môt’s CANADA*
C hambre de just ic e , tom. premier , pag-
169 & 116. Voyei aufli C o n cu s s io n .
PÉCULE , f. fn. j on appelle pécule ce qu un
pfialsr dfoen fainmdiullfetr,i eu ,n oruel iagciequuxie, rtu np aer fcdlaevs e maomyaefnles
qui lui font particuliers, & dont on lui lame 1 ad-
miniftration.
rifcPoEnCfuUlteNs IRAo m, fa.i nms. f; igqnuiif idea ,n sn olen -lfaenuglaegme ednets ju- 1 arbgleenst
&co mimpmtaenutb, lemsa, isd rtooiutste mfoêrmtee doeu bpireéntesn, tmioenus.
Voye% le Digefte , livre 50 , de la fignification des
mots & des chofes.
peiPnÉe CpéUcNunIiAaiIrRe,E a m, aednjd. e qpuéic uvneuiati rdei r5e f idgn’aifrige eunnte,
apuexin der,o iutsn ed ua mroein d, el ad ’aprlguepnatr.t Tdoesu tceosn tlreasv efrnatuiodness
aamuxe nldoeixs ppoécliutinqiuaeirse,s ,n eà fmonoti npsu nqiuees cqeuse d éplairts dnees fcooimenmt ea cpcoormt dp’aagrnmése sd,e a cttirrocuopneftmanecness o aug grérbavelalniotens ,5
pcaesin desa nps élceufqnuiaeilrse sl,e sd elso ipxe ipnreosn ocnocrpeonrte l,l easv e&c dines
famantes. Voye^ C ontre bande , Fa u x s a u nage
, Fa u x sa u n ie r s .
PÉCUNIEUX , adje&if qui s’applique égalemque’neltl
easu xo npt ebrfeoanunceosu p& d’aaurxg ecnht ocfeosm ,p tpanotu}r adiinrfei hoon mdmit eu,n eu nv ifloleu v, eruanien- ppércouvniniecuex .p éCcuen mieuoft ep a; rouînt
dqéurii vpéré dfeid poéictu nà el,’ qarug’eonnt pcrhéetezn lde sa vRooirm éatién lsa. dPiévcinuintée dna’enfst gleu èbruer ldef’uqfuaeg e, q&u ec edpanesn dlaen tf tylele tfearmmiel ier ou pécunieux
eft généralement reçu & s’emploie fréquemment
, fur-tout dans la langue commerciale.
tioPnE dI’uNnE c,r imf. ef, .d, ’puanr dléelqitu. elE no nm eantitèerned d el afi npaunncie
ital lye sa ,d easff lipéeliivneess ,p éincfuanmiaainretess .& des peines capif^
Qyeç C on tr e bande
, Fau xsa un ag e , Fa u x sa vn ie r s ,
P r oh ib it ion s .
lesP dEoLuaLnEesT EpoRuIrE d,é ffi.g nf.e r; cuen tegremnree edfet umfîatréc dhaanns-
ddief epso iqlus i& c odmefptirneéned àt ofauitree fdoerst ef odue rpuereasu x3 genarfnuiietes oténe doiuft iancgcuoeu ltaré pee l3l eltae rie crue de la pelleterie apprêpelleterie
commune de \z pelleterie
fine. La;pelleterie crue eft celle qui fe trouve
-taenlilme aquux’.çlle a été levée de deffus le corps des
Tome I I I . Finances«
L*autre pelhterie eft celle qui a reçii un apprêt
qui la met en état d‘’être employée.
Par pelleterie commune, on entend les peaux de
renards, de loutres & fouines 3 chats, chiens ,
putois , ra t, & autres.
La pelleterie fine eft celle qui provient des lapins
, lièvres, petits-gris , hermines & autres animaux
des contrées fepteûtrion^les.
Les marchandifes qui compofent la clafie de la
pelleterie, & dans laquelle font comprimes les
peaux d’agneaux & de chevreaux apprêtées > font
difpenfées de la marqué des cuirs 3 mais auflî
elles ne participent pas à l’exemption de tous
droits de circulation comme les cuirs & les peaux
qui portent cette marque 3, c ’eft ce qui a été décidé
par le confeil, les 1 1 mai 1760 , & 11 décembre
*764*
à lT’eonutrtéee p delule rteoryiea uvmenea,n ut nd uq upaaryt se éht rfaunsg edru ddoroitit,
odrud i1n ya imrea i, e1n7 6c0o.nformité de l’article + de l’arrêt
Celle qui vient de l’Amérique feptentrionale ,
c’eft à-dire , des pays qui compofent la République
des États-Unis,doit être traitée.comme la
pelleterie étrangère.
Les pelleteries du Canada & de toutes les
poffeflions angloifes , de même que celles qui
viennent dire&ement de l’Angleterre , font prohibées
par l’arrêt du 17 juillet 1785.
Mais les pelleteries provenant de nos colonies *
comme celles des ifles de Saint-Pierre & de Miquelon
, font exemptes du quart des droits impofé
par augmentation en 1760.
Les habillemens & les parures de pelleterie foqt
fujets aux mêmes droits d’entrée que les pelleteries
apprêtées en venant de l’ étranger 3 mais quand
ces objets font expédiés du royaumé pour le pays
étranger , ils ne doivent qu’ un pour cent de leur
valeur , conformément à l’article 8 de l’arrçt du
i j mai 1760.
Des pelleteries qui viendroient du levant oit
feroient de même nature que celles qui en font
apportées ordinairement, comme peaux de lion ,
de tigre & de loups cerviers , fçroient,- non-feulement
fujettes aux droits dont il a été fait mention
, mais de plus , au droit de vingt pour cent
fi elles n'étoiçnt pas accompagnées du certificat
prefcrit par l’arrêt du confeil de 1750 , ainfi qu’qn
l’a dit au mot L e v a n t , tom. 2 , pag. 714,
. P E N ,S IO N , f. f. Sous le nom de penfiçn y
on n’entend qu'une gracé , ou une récoiiipénfe
du fouveraini E t , commééês fortes de 'dons ont ^
S f