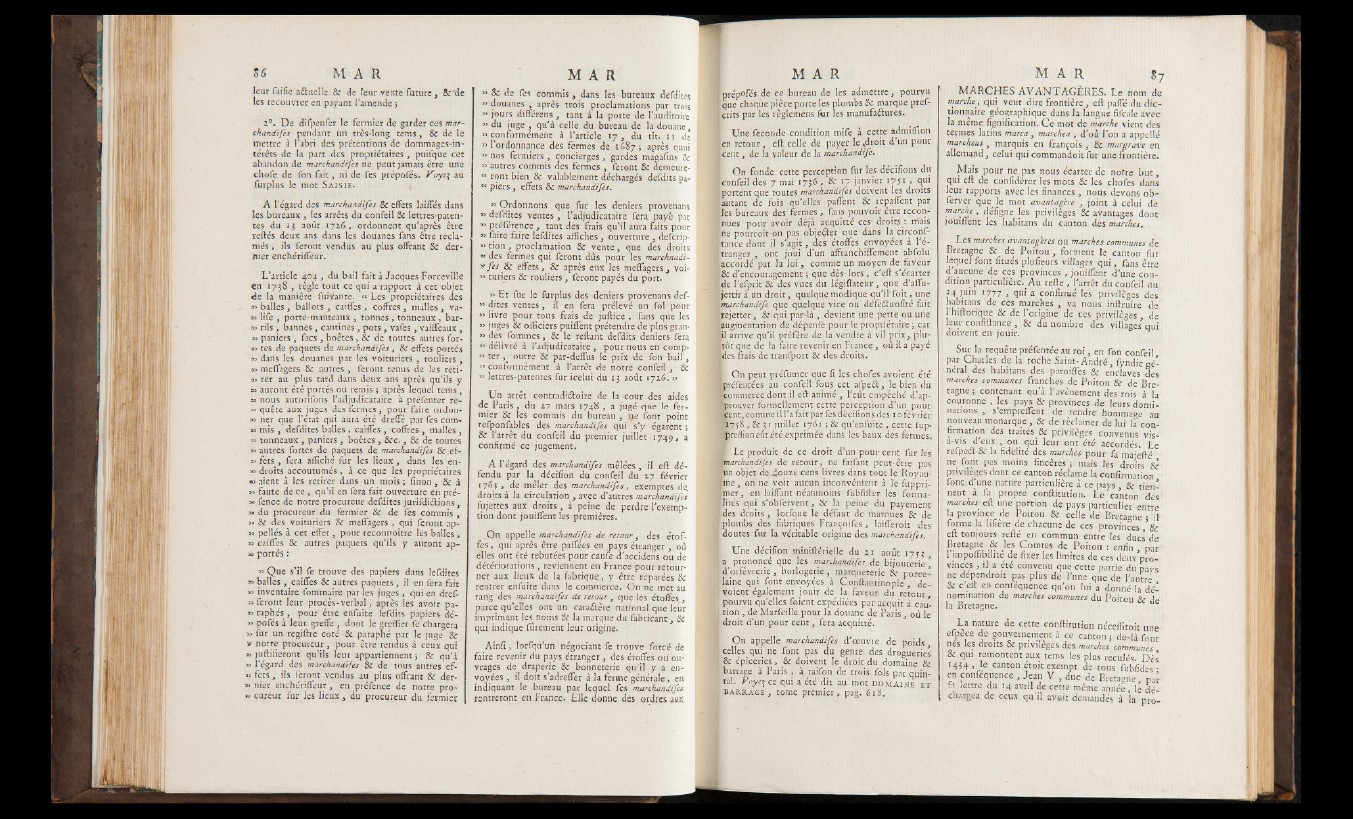
SS M a R
leur faille aéluelle & de leur vente future , &'de
les recouvrer en payant l'amende j
l° . De difpenfer le fermier de garder ces marchandises
pendant un très-long tems, & de le
mettre à l’abri des prétentions de dommages-intérêts
de la part des propriétaires , puifque cet
abandon de marchandises ne peut jamais être une
chofe de fon fait , ni de fes prépofés. f^oye^ au
furplus le mot S a i s i e .
A l’égard des marchandises & effets laides dans
les bureaux , les arrêts du çonfeil & lettres-patentes
du 1 3 août 1726, ordonnent qu’après être
reliés deux ans dans les douanes fans être réclamés
, ils feront vendus au plus offrant & dernier
enchérifleur.
L ’article 404 , du bail fait à Jacques Forceville
en 1738 , règle tout ce qui a rapport à cet objet
de la manière fui^ante. “ Les propriétaires des
- » balles, ballots , caiffes >. coffres , malles , va-
» life , porte-manteaux, tonnes, tonneaux, bar-
» rils , bannes, cantines , pots , vafes , vaiffeaux 3
« paniers, facs 3 boêtes , & de toutes autres foras
tes de paquets de marchandises, & effets portés
»s dans les douanes par les voituriers , rouliers ,
aa meffagers & autres, feront tenus de les relias
rer au plus tard dans deux ans après qu’ils y
as auront été portés ou remis \ après lequel tems,
as nous autorifons l’adjudicataire à préfenter reas
quête aux juges des fermes 3 pour faire ordon-
as ner que l’état qui aura été dreffé par fes comas
mis , defdites balles , caiffes , coffres , malles,
as tonneaux 3 paniers, boêtes 3 & c . , & de toutes
as autres fortes de paquets de marchandises & ef-
as fe t s , fera affiché fur les lieux , dans les en-
as droits accoutumés, à ce que les propriétaires
•a aient à les retirer dans un mois ; finon, & à
as faute de c e , qu’ il en fera fait ouverture en pré-
» fence de notre procureur defdites jurifdiétions,
a* du procureur du fermier & de fes commis ,
a» des voituriers & meffagers , qui feront ap-
as pellés à cet effet, pour reconnoître les balles,
as caiffes & autres paquets qu’ ils y auront ap-
ao portés :
as Que s’il fe trouve des papiers dans lefdites ,
» balles , caiffes & autres paquets , il en fera fait
as inventaire fommaire parles juges , qui en dref-
as feront leur procès-verbal, après les avoir pa-
as raphés , pour être enfuitè lefdits papiers d'é-
as pofés à leur, greffe , dont le greffier fc chargera
as fur un regillre coté & paraphé par le juge &
y notre procureur, pour être rendus à ceux qui
as juftifieront qu’ils leur appartiennent} & qu’a
as l’égard des marchandises & de tous autres ef-
>s fets , ils feront vendus au plus offrant & der-
as nier enchériffeur, en préfence de notre pro-
*> cureur fur les lieux, du procureur du fermier
M A R
** & de fes commis, ” douanes , après troisd anpsr olcelsa mbautrieoanusx pdare fdtrioteiss
” jours différens, tant à la porte de l’auditoire
M du juge, qu’à celle du bureau de la douane,
=»»s lc’oonrdfoornmnaénmceen dt esà fle’armrtiecsl ed e1 71,6 8d7u; atiptr.è s1 1q udoei
«« naoutsr efse rcmomiemrsi,s dceosn cfeiermrgeess ,, gfaerrdoenst &m adgeamfinesu re&-
ccce pfoienrts b, ieenff e&ts valablement déchargés defdits pa- & marchandises.
« Ordonnons que fur les deniers provenans « defdites ventes , l’adjudicataire fera payé par
«préférence, tant des frais qu’il aura faits pour
« faire faire lefdites affiches, ouverture, deferip-
« tion, proclamation & vente, que des droits
« des fermes qui feront dûs pour les marchnadi-
»Ses & effets, & après eux les meffagers, voi-
« turiers & rouliers, feront payés du port.
« d»i tEest vfuern tlee s,f uripl luesn defesr ad epnriéelresv pé rouvne nfaonl sp doeufr-
«» ljiuvgrees p&o uorff itcoiuerss pfruaiifsf ednet pjruéitleincder,e dfaen ps luqsu ger alnes-
«» ddeésli vfroém àm le’asd, ju&d iclea tarierleia ,n t pdoeufrd intso udse ennie rcso mfepra- » te r, outre '& par-deffus le prix de fon bail,
«« lceotntrfeosr-mpaétmenetnets fàu rl ’iacrerlêuti ddeu n13o tareo ûct o1n7f2e6il. ,» &
Un arrêt contradictoire de la cour des aides
de Paris , du 27 mars 1748 , a jugé que le fermier
& les commis du bureau, ge font'point
refponfables des marchandises qui s’y égarent j
& l’arrêt du confeil du premier juillet 1749, a
confirmé ce jugement.
A l’égard des marchandises mêlées, il elt défendu
par la décifîon du confeil du 27 février
d1r7o6i3t s, à dJea mcirêcleurl atdieosn m, aavrcehca dn’daiusetrse, s exemptes de. marchandises tfiuojnet tdeosn at ujxo udifrfoenitts l,e sà ppreeminieè rdese. perdre l’exempOn
appelle marchandises de retourg des étoffes
, qui après être paffées en pays étranger, où
deléletésr oionrta téitoén rse,b ruetvéeiesn pnoeunrt ecnau Ffera dn’caec cpioduenr sr eotuo udre
ner aux lieux de la fabrique, y être réparées &
rraenngtr edre se nfuite dans le commerce. On ne met au marchandises de retour 3 que lés étoffes,
parce qu’elles ont un caraâère national que leur
iqmuip riinmdieqnute l efsû rneommesn t& l elua rm oarirgqiunee .du fabricant, &
Ainfi, Iorfqti’un négociant fe trouve forcé de
fvariargee sre vdeen idr rdaup epraiey s& é trbaonngneert,e rdiees qétuo’filf esy oau eonuivnodyiéqeusa
n, t ill ed obitu sre’aadur eplfaerr làe qlau efle rmfees générale, en marchandises rentreront en France. Elle donne des ordres aux
M A R
[prépofés de ce bureau de les admettre, pourvu
[ que chaque pièce porte les plombs & marque pref-
I çrits par les règlemens far les manufactures.
i Une fécondé condition mife à cette admilfion
[en retour, efl celle de payer le vdroit d un pour
[cent , de la valeur de h marchandise*
On fbnd'e cette perception fur les décifïons du
[confeil des 7 mai 1736, & 17 janvier 1751 , qui
[portent que toutes marckahdifes doivent les droits
[autant de fois qu’elles paffent & repaffent par
les bureaux des fermes , fans pouvoir être recon-
[nues pour avoir déjà acquitte ces droits : niais
ne pourroit-on pas objeÇter que dans la circonf-
ftance dont il' s”agit, des étoffes envoyées à l’étranger
, ont joui d’un affranchiffement abfolu
[accordé par la lo i , comme un moyen de faveur
l& d’encouragement 5 que dès-lors, c’efl s’écarter
de l ’efprit & des vues du légiflateur, que d’affu-
[jettir à un droit, quelque modique qu’il fo it, une
\marchandiSe que quelque vice ou défeCtuofîté fait
[rejetter, & qui par-là , devient une perte ou une
[augmentation de dépenfe pour le propriétaire -, car
;il arrive qu’ il préfère de la vendre à vil prix, plu-
Itôrque de la faire revenir en France, où il a payé
Ides frais de tranfport & des droits.
i ' On peut préfiimer que fi les choies avoient été
Ipréfentées au confeil fous cet afpeCt, le bien du
«commerce dont il eft animé, l’eût empêché d’ap-
^prouver formellement cette perception d’un pour
fcent, comme il l’a fait par fes décifions des 1 o février
1758, & 31 juillet 1761 j & qü’enfuite , cette fup-
prdîioneût,été exprimée dans les baux des fermes.
K Le produit de ce droit d’un pour cent fur les
miarckandijes de retour, ne faifant peut-être pas.
iun objet de^ouze cens livres dans tout leEloyau-
■ me, on ne voit aucun inconvénient à lé fuppri-
imer, en laiffant néanmoins fubfifier les forma-
llités qui s’obfervent, & la peine du payement
[des droits, lorfque le défaut de marques & de
I plombs des fabriques Françoifes, lailferoit des
doutes fur la véritable origine des marchandises.
Une décifion miniflerielle du 21 août 1753
j a prononcé que les marchandises de bijouterie fe
I d’orfèvrerie , horlogerie, marqueterie & porcelaine
qui font envoyées à Gonftantinople, dévoient
également jouir de la faveur du retour
[ pourvu qu’elles foient expédiées par acquit à eau-
I tion, de Marfeille pour la douane de Paris , où le
[ droit d’un pour cent, fera acquitté.
I On appelle marchandises d’oeuvre de poids
.celles qui ne font pas du genre des drogueries
& épiceries, & doivent le droit du domaine &
barrage à Paris, à raifon de trois fols par quin-
| tal. Voyei ce qui a été dit au mot d o m a in e e t
| b a r r a g e , tome premier, pag. 618.-
M A R 87
MARCHES AVANTAGÈRES. Le nom de
marche, qui veut dire frontière , eft pafle du dictionnaire
géographique dans la langue fifcale avec
la meme fignification. C e mot de marche vient des
termes latins marca 3 tnarchca , d'Jou J’on a appelle
marcheus |! marquis en fiançois , & margrave en
allemand, celui quicommandoitfur une frontière.
Mais pour ne pas nous écarter de notre b u t,
qui eft de confîdérer les mots & les chofes dans
leur rapports avec les finances, nous devons ob-
ferver que le mot avantaghe , joint à celui de
marche , défigne les privilèges & avantages dont
jouilfent les habitans du canton des marches. ,
Les marches avantagées ou marckes communes de
Bretagne & de Poitou , forment le canton fur
lequebFont fitués plufieurs villages q u i, fans être
d'aucune de ces provinces , jouiffent d’une condition
particulière. Au refte , l'arrêt du çonfeil ou
24 juin 1777 , qui a confirmé les privilèges des
habitaiTS de ces marches , va nous inflruire de
l’hiftorique & de l'origine de ces privilèges de
leur confiftance , du nombre des villages’ qui
doivent en jouir. M
Sur la requête préfentée au ro i, en fon confeil
par Charles de la roche Saint-André, fyndiegé-
■ néral des habitans des paroiffes & enclaves des
marches communes franches de Poitou & de Bretagne,;.
contenant q u i l'avènement des rois à la
couronne , les pays & provinces de leurs dominations
, s’empreffent de rendre hommage au
nouveau monarque, & de réclamer de lui la confirmation
des traités & privilèges convenus vis-
à-vis d'eux , ou qui leur ont été accordés. Le
refpeél & la fidélité des marches pour fa mahtfté
ne font pas moins fincères ; mais les droits &
privilèges dont ce canton réclame la confirmation
font, d'une nature particulière à ce pays , & tien-
nent à fa propre conftitution. Le canton des
marches- eft une portion de pays particulier entre
la province de Poitou & celle de Bretagne • il
forme la Kfiere de chacune de ces provinces &
eft toujours, nefté en commun entre les ducs de
Bretagne & les Comtes de Poitou : enfin par
l’impoflibiuté de fixer les limites de ces deux provinces
, il: a été convenu que cette partie du pays
ne dépendrait pas.plus de l'une que de l’autre
& c'elt en confequence qu’on lui a dorme la dt£
nomination de marches communes du Poitou & Je
la Bretagne.
La nature de cette conftitution néceflitoit une
efpece de gouvernement à ce canton ; de-là font
nés les droits & privilèges des marches communes
& qui remontent aux tems les plus reculés. Dès
1434, le canton étoit exempt de tous fubfides -
; en confequence , Jean V , duc de Bretagne par
fa lettre du 14 avril de cette même année, le-déchargea
de ceux qu'il avait demandés à la pro