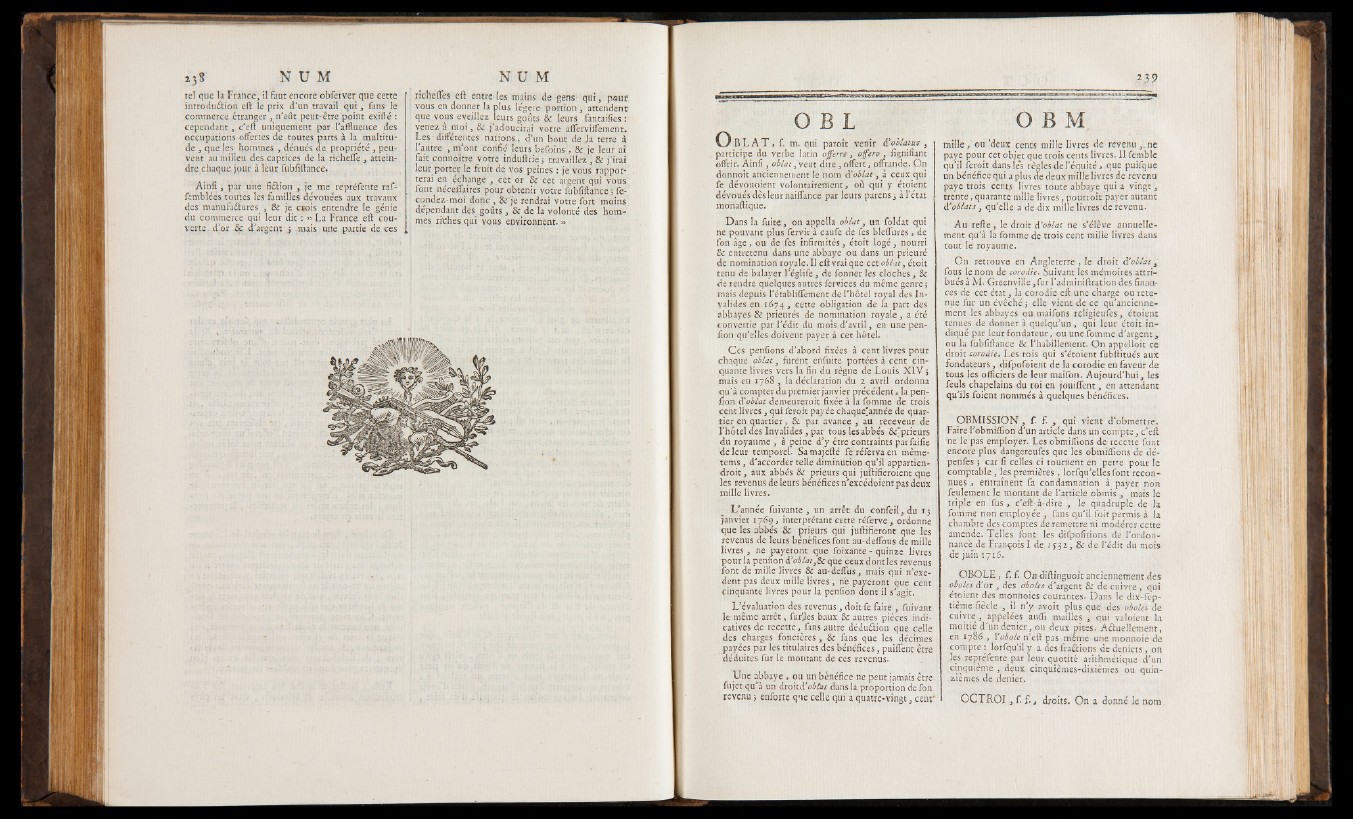
138 N U M
tel que la France, il faut encore obferver que cette
introduction eft le prix d'un travail q u i, fans le
commerce étranger , n'eût peut-être point exiflé :
cependant, c’elt uniquement par l'affluence des
occupations offertes de toutes parts à la multitude
, que les hommes , dénués de propriété , peuvent
au milieu des caprices de là richeffe , atteindre
chaque jour à leur fubfîftance.
A in fi, par une fiction , je me repréfente raf-
femblées toutes les familles dévouées aux travaux
des manufactures , & je crois entendre le génie
du commerce qui leur dit : » La France eft couverte.
d’or & d'argent 5 mais une partie de ces
N U M
richeffes eft entre les mains de gens q ui, peut
vous en donner la plus légère- portion, attendent
que vous eveillez .leurs goûts & leurs fântaifies :
v e n e z àm o i , & j'adoucirai votre afferviffement.
L e s . differentes nations, d'un bout de la terre à
! l’autre , m'ont confié leurs befoins , & je leur ai
fait çonnoître votre induftriej travaillez, & j ’irai
leur porter le fruit de vos peines : je vous rapporterai
en échangé , cet, or & cét argent qui vous
font néceffaires pour obtenir votre fubfîftance 5 fe-
condez-moi donc , de'je rendrai votre fort moins
dépendant des goûts, & de la volonté des hommes
riches qui you,s environnent. »
O B L
O B L A T , f. m. qui paroît venir d’oblatus ,
participe du verbe latin offerre, offero, lignifiant
offrir. Ainfi, oblat, veut dire, offert, pffrande. On
donnoit anciennement le nom à* oblat-, à ceux qui
fe dëvouoient volontairement , où qui y étoient
dévoués dès leur naifîance par leurs parensj à l’état
monaftique.
Dans la fuite, on appella oblat, un foldat qui
ne pouvant plus fervir à caufe de fes bleffures, de
fon âge, ou de fes infirmités, étoit lo gé, nourri
& entretenu dans une abbaye ou dans un prieuré
de nomination royale. Il eft vrai que cet oblat, étoit
tenu de balayer l'églife, de fonner les cloches, &
de rendre quelques autres fervices du même genrej
mais depuis l’établiffement de l'hôtel royal des Invalides
en 16 74 , cette obligation de la part des
abbayes & prieurés de nomination royale, a été
convertie par l'édit du mois d’avril, en une pen-
fion qu'elles doivent payer à cet hôtel.
Ces penfions d'abord fixées à cent livres pour
chaque oblat, furent enfuite portées à cent, cinquante
livres vers la fin du règne de Louis X IV ;
mais en .1768, la déclaration du 1 avril ordonna
qu’à compter du premier janvier précédent, la pen-
fion d'oblat demeureroit fixée à la fomme de trois
cent livres, qui feroit payée chaque'année de quartier
en quartier, & par avance , au receveur de
l ’hôtel des Invalides, par tous les abbés &"prieurs
du royaume à peine d'y être contraints par faifie
de leur temporel. Samajefté fe réfervaen même-
tems, d'accorder telle diminution qu’il appartien-
droit, aux abbés & prieurs qui juftifieroient que
les revenus de leurs bénéfices n'excédoient pas deux
mille livres.
L'année fuivante, un arrêt du confeiI,du 13
janvier 1769, interprétant cette réferve, ordonne
que les abbés & prieurs qui juftifieront que les
revenus de leurs bénéfices font au-deffous de mille
livres , ne payeront que foixante - quinze livres
pour la penfiond’o^A^&que ceuxdontles revenus
font de milleiivres & au-defius, mais qui n'exe-
dent pas deux mille livres, né payeront que cent
cinquante livres pour la penfion dont il s'agit.
L ’évaluation des revenus, doit fe faire , fuivant
le même arrêt, fur’jles baux & autres pièces indicatives
de recette, fans autre déduction que celle
des charges foncières -, & fans que les décimes
payées par les titulaires des bénéfices, puiffent être
déduites fur le montant de ces revenus.
Une abbaye, ou un bénéfice ne peut jamais être
fujet qu'à un droitd * oblat dans la proportion de fon
revenu j enforte que celle qui a quatre-vingt, cent'
239
O B M
mille, ou'deux cents mille livres de revenu,,ne
paye pour cet objet que trois cents livres. Il femble
qu'il feroit dans les règles de l'équité,.que puifque
un bénéfice qui a plus de deux mille livres de revenu
paye trois cents livres toute abbaye qui a v in gt,
trente, quarante mille livres, pourroit payer autant
iVoblats, qu’elle a dé dix mille livres de revenu.
Au refte, le droit d ’oblat ne s'élève annuellement
qu’à la fomme de trois cent mille livres dans
tout le royaume.
On retrouve en Angleterre , le droit d'oblat,
fous le nom de corodie. Suivant les mémoires attribués
à M. Greenviile,fur l’adminiftration des finances
de cet état, la corodie eft une charge ou retenue
fur un évêché 5 elle vient de ce qu'ancienne-
ment les abbayes ou maifons religieufes, étoient
tenues de donner à quelqu'un, qui leur étoit indiqué
par leur fondateur, ou une fomme d'argent,
ou la fubfîftance & l’habillement. On appelloit ce
droit corodie. Les rois qui s'étoient fubftitués aux
fondateurs, difpofoient de la corodie en faveur de
tous les officiers de leur maifon. Aujourd’hui, les
feuls chapelains du roi en jouiflent, en attendant
qu'ils foient nommés à quelques bénéfices.
OBMISSION , f. f. , qui vient d'obmettre.
Faire I'obmiffion d’un article dans un compte, c'eft
ne le pas employer. Les obmiffions de recette font
encore plus dangereufes que les obmiffions de dé-
penfes 3 car fi celles-ci tournent en perte pour le
comptable, les premières , lorfqu'elles font reconnues
, entraînent fa condamnation à payer non
feulement le montant de l’article obmis , mais le
triple en fu s , c'eft-à-dire , le quadruple de la
fomme non employée , fans qu'il foit permis à la
chambre des comptes de remettre ni modérer cette
amende. Telles font les difpofitions de l'ordonnance
de François I de. x532, & de l'édit du mois
de juin 1716.
O B O L E , f. f. On diftinguoit anciennement des
oboles d'or , des àboles d'argent & de cuivre , qui
étoient des monnoies courantes. Dans le dix-fep-
tième fiècle , il n'y avoit plus que des oboles de
cuivre , appelées auffi mailles , qui valoient la
moitié d'un denier, ou deux pites. A&uellement,
en 1786 , \obolen'eft’pas même une monnoie de
compte : lorfqu’il y a des fractions de deniers , on
les repréfente par leur quotité arithmétique d'un
, cinquième , deux cinquièmes-dixièmes ou quinzièmes
de denier.
OCTROI, f. f., droits. On a donné le nom