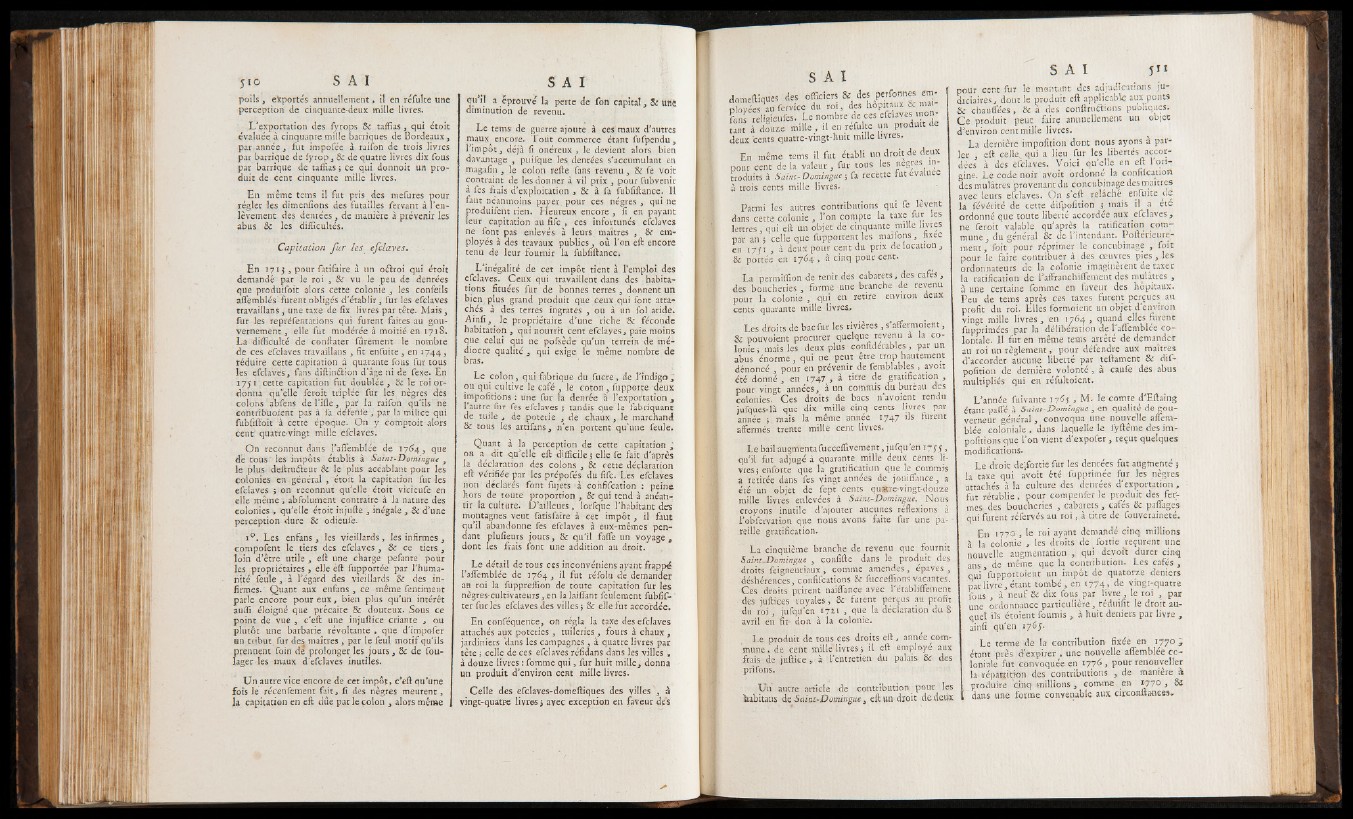
jio S A I
poils , exportés annuellement, il en réfulte une
perception de cinquante-deux mille livres.
L ’exportation des fyrops & taffias, qui étoit
évaluée à cinquante mille barriques de Bordeaux
par,année j fut impofée à raifon de trois livres
par barrique de fyrop, & de quatre livres dix fous
par barrique de taffias} ce qui donnoit un produit
de cent cinquante mille livres.
En même tems il fut pris des mefures pour
régler les dimenfions des futailles fervant à l’en-
lèvement des denrées , de manière à prévenir les
abus 5c les difficultés.
Capitation fur les efclaves.
En 1713 s pour Tarifaire à un oélroi qui étoit
demandé par le roi , & vu le peu de denrées
que produifoit alors cette colonie , les confeils
affemblés- furent obligés d’établir , fur les efclaves
travaillans , une taxe de fix livres par tête. Mais,
fur les repréfentations qui furent faites au gouvernement
, elle fut modérée à moitié en 1718.
La difficulté de conftater fûrement le nombre
de ces efclaves travaillans 3 fit enfuite 3 en 1744 3
réduire cette capitation à quarante fous fur tous
les efclavés, fans diftin&ion d’âge ni de fexe. En
1751 cette capitation fut doublée 3 & le roi ordonna
qu’elle feroit triplée fur les nègres des
colons abfens de Tille, par la raifon qu’ils ne
éobtribuoient pas à fa.déferife, par la milice qui
fubftftoit à cette époque. On y comptoir alors
cent’ quatre-vingt mille efclaves.
On reconnut dans Talfemblée de 17(34, que
dé tons les impôts établis à Saint-Domingue 3
le plusfteftru&eur & le plus accablant pour les
colonies en général , étoit la capitation fur ies
efclaves ; on reconnut qu’elle étoit vicieufe en
elle même ; abfolument contraire à la nature des
colonies;, qu’elle étoit injufte , inégale , & d’une
perception dure & odieufe.
i Q. Les enfans , les vieillards, les infirmes ,
compofent le tiers des efclaves , & ce tiers ,
loin d’être utile , eft une charge pefante pour
les propriétaires > elle éft fupportée par l’humanité'
feule, à l’égard des vieillards & des infirmes.'
Quant aux enfans , ce même fentiment
parle encore pour eux, bien plus qu’un intérêt
auffi éloigné que précaire & douteux. Sous ce
point de vue , c’eft une injuftice criante , ou
plutôt une barbarie révoltante , que d’impofer ,
ïin tribut, fur des maîtres , par le feui motif qu’ils
prennent foin de prolonger les jours , & de fou-
lagerles maux d'efclaves inutiles.
Un autre vice encore de cet impôt, c’eft qu’une
fois le récenfement fait, fi des nègres meurent,
la capitation en eft due par le çolon , alors même
s a 1
qu’il a éprouvé la perte de fon capital, & imfc
diminution de revenu.
Le tems de guerre ajoute à ces maux d’autres
maux encore. Toiit commerce étant fufpendu,
l’impôt, déjà fi onéreux , le devient alors bien
davantage , puifque les denrées s’accumulant en
magafin , le colon refte fans revenu, & fe voit
contraint de les donner à vil prix , pour fub venir
à fes frais d’exploitation , & à fa fubfiftance. 11
faut néanmoins payer, pour ces nègres , qui ne
produifent rien. Heureux encore , fi en payant
leur capitation au fifc , ces infortunés efclaves
ne font pas enlevés à leurss maîtres , 8t employés
à des travaux publics, où Ton eft encore
tenu de leur fournir la fubfiftance.
L’inégalité de cet impôt tient à l’emploi des
efclaves. Ceux qui travaillent dans des habitations
fituées fur de bonnes terres , donnent un
bien plus grand produit que ceux qui font attachés
à des terres ingrates , ou à un fol aride.
Ainfî, Je propriétaire d’une riche 1k féconde
habitation , qui nourrit cent efclaves, paie moins
que celui qui ne pofsède qu'un terrein de médiocre
qualité , qui exige le même nombre de
bras.
Le colon, qui fabrique du fucre, de l ’indigo
ou qui cultive le café , le coton, fupporte deux
impofitiôns : une fur la denrée a l’exportation 3
l’ autre fur fes efclaves j tandis que le fabriquant
de tuile , de poterie , de chaux , le marchand
& tous les artifans, n’en portent qu’une feule.
Quant à la perception de cette capitation
os a^ dit qu’ elle eft difficile 3 elle fe fait d’après
la déclaration des colons , & cette déclaration
eft vérifiée par les prépofé^ du fifc. Les efclaves
non déclarés font fujets 'à confifcation : peine
hors de toute proportion , & qui tend à anéan-.
tir la culture. D’ailleurs , lorfque l’habitant des
montagnes veut fatisfaire à cet impôt, il faut
qu’il abandonne fes efclaves à eux-mêmes pendant
plufieurs jours, & qu’il fafle un voyage ,
dont les frais font une addition au droit.
Le détail de tous ces inconvéniens ayant frappé
Talfemblée de 17 6 4 , il fut réfolu de.demander
an roi la fuppreffion de toute capitation fur les
nègres-cultivateurs, en lalaiflant feulement fubfîf-
ter furies efclaves des villes j 8c elle fut accordée.
En conféquence, on régla la taxe des efclaves
attachés aux poteries , tuileries, fours à chaux,
jardiniers dans les campagnes , à quatre livres par
tête j celle de ces efclaves réfidans dans les villes ,
à douze livres : fomme q u i, fur huit mille, donna
un produit d’environ cent mille livres.
Celle des efclaves-domeftiques des villes ', à
vingt-quatre livres 3 avec exception en faveur des
domeftiques des. officiers perfonne. g j
Dlovées au fervice'du roi, des hôpitaux mai
fons religieufes. Le nombre de ces efclaves montant
à douze mille j $ en refaite un produit de
deux cents quatre-vingt-huit mille livres.
En même tems il fut établi un droit de deux
pour cent de la valeur, fur tous les negres in-
troduits à Saint-Domingue 5 fa reefette rut eva
à trois cents mille livres.
Parmi les autres contributions qui fe lèvent
dans cette colonie I l'on compte la taxe fur les
lettres, qui eft un objet de cinquante mille livres
par an ; celle que Apportent les maifons, nxee
en 1751 , à deux pour cent du prix de location ,
& portée en 1764 , à cinq pour cent.
La permiffion de tenir.des cabarets , des cafés,
des boucheries I forme une branche de revenu
pour la colonie , qui en retire environ deux
cents quarante mille livres.
Les droits de bac fur les rivières , s'affermoient,
& pouvoient procurer quelque revenu a la colonies
mais les deux plus confrderables , par un
abus énorme, qui ne peur etre trop hautement
dénoncé , pour en prévenir de femblables , avoir
été donné, en 1747 , à titre de gratification ,
pour vingt années, à un commis du burèau des
colonies. Ces droits de bacs n’avoient rendu
jufques-là que dix mille cinq cents livres par
année, s, mais la même annee 1 7 4 7 tls furent
affermés trente mille cent livres.
Le bail augmentafucceffivement, jufqu’en 175-5,
qu'il fut adjugé à quarante mille deux cents livres;
enforte que la gratification que le commis
a retirée dans fes vingt années de jouiflance, a
été un objet de fept cents quatre-vingt-douze
mille livres enlevées à Saint-Domingue. Nous
croyons inutile d'ajouter aucunes réflexions à
l’obfervatkm que nous avons faite fur une p a--
refile gratification.
La cinquième branche de revenu que fournit
Saint-Domingue , confifte dans le produit des ..
droits feigneutiaux, comme amendes, épaves,,
déshérences, confifcations & fucceffions vacantes.
Ces droits prirent naiflance avec l'établiffement
des juftices royales, & furent perçus au profit
du r o i, jufqti’en 17x1 , que la déclaration du S
avril en fit- don à la colonie.
Le produit de tous ces droits e ft, année commune,
de cent mille livres, il eft employé aux
frais de juftice , à 1 entretien du palais & des
prifons.
Un autre article de contribution pour les
habitans de Saint-Domingue, eft un droit dedetix
pour cent fur le montant des adjudications judiciaires,
dont le produit eft applicable aux ponts
Se chauffées, & à des conftruétions publiques.
C e produit peut faire annuellement un objet
d'environ cent mille livres.
La dernière impofition dont nous ayons a parler
, eft cellet qui a lieu fur les libertés accordées
à des èfclaves. Voici qu'elle en eft 1 origine.
Le code noir avoit ordonné la confilcarion
des mulâtres provenant du concubinage des maures
avec leurs efclaves. On s'eft relache^ enfuite dé
la févérité de cette difpofition ; mais il a ete
ordonné que toute liberté accordée aux efclaves,
ne feroit valable qu’après la ratification commune,
du général & de. l'intendant. Poftérieure-
ment, fait pour réprimer le concubinage , foie
pour le faire contribuer à des oeuvres p ie s , les
ordonnateurs de la colonie imaginèrent de taxer
la ratification de l’affranchiffement des mulâtres ,
à une certaine fomme en faveur des hôpitaux.
Peu de tems après ces taxes furent perçues au
profit du roi. Elles formoient un objet d’environ
vingt mille livre s, en 1764 , quand elles furent
fupprimées par la délibération de l'affemblee coloniale.
Il fut en même tems arrêté de demander
au roi un règlement, pour défendre aux maîtres
d’accorder aucune liberté par teftament & difpofition
de dernière volonté , à caufe des abus
multipliés qui en réfultoient.
L ’année fuivante iy é ; , M. le comte d’Eftaing
étant paffé à S a in t-D om in g u e , en qualité de gouverneur
général, convoqua une nouvelle aflenr-
blée coloniale , dans laquelle le fyftême des im-
' pofitions que l’on vient d'expofer, reçut quelques
modifications.
Le droit de'jfortte fur les denrées fut augmenté ;
la taxe qui avoit été fupprimée fur les nègres
attachés à !a culture des denrées d’exportation,
fut rétablie, pour compenfer le produit des fermes
des boucheries , cabarets, cafés & paflages
qui furent réfetvés au r o i , à titre de fouveraineté.
En 1 7 7 0 , le roi ayant demandé cinq millions
à la colonie , les droits de fottie reçurent une
nouvelle augmentation , qui devoft durer cinq
ans de même que la contribution. Les cafés ,
qui’ fapportoienr un impôt de quatorze deniers
par livre, étant tombé, en 1 7 7 4 , de vingt-quatre
fou s , à neuf & dix fous par livre, le roi , par
une ordonnance particulière, réduifit le droit auquel
ils étoient fournis ,, à huit deniers par livre ,
ainfi qu'en 1765,
Le terme de la- contribution fixée en 1770 ;
étant près d’expirer , une nouvelle affemblée coloniale
fût convoquée en IJ 7(>, pour renouveller
la. répartition des contributions , de manière a
I produire cinq millions, comme .en r-770 , 8d
1 dans une forme convenable aux circonitances.