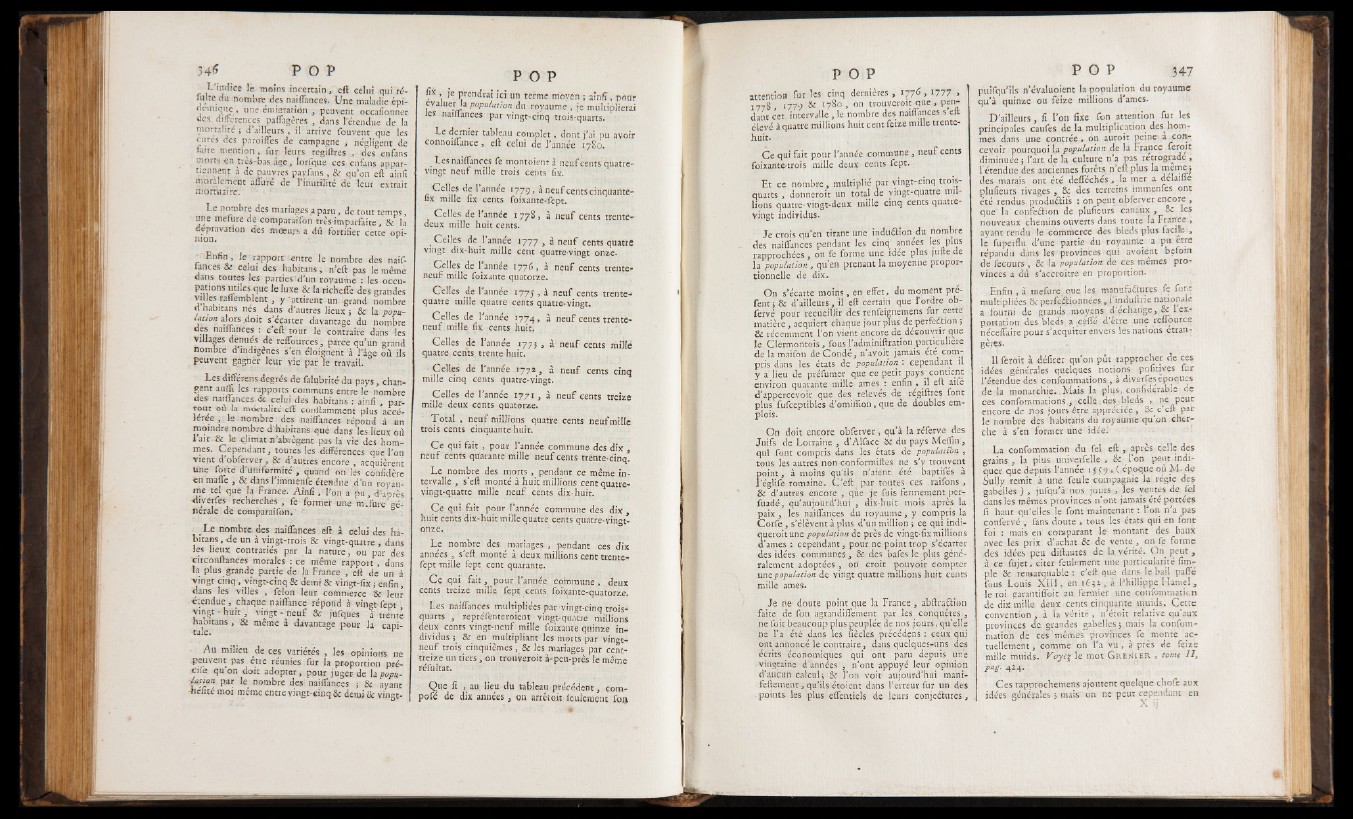
_ ^ ’indice le moins incertain, eft celui qui ré-
fulte du nombre des naiflances. Une maladie épi-
demique , une émigration , peuvent occafîanner
des différences paffagères , dans l’étendue de la
mortalité > d ailleurs , il arrive fouvent que les
cures des paroifies de campagne j négligent de
faire mention, fur leurs regiftres , des enfans
morts en très-bas âge j lorfque ces enfans appar-
nennent à de pauvres pay.fans , & qu*on eft ainfi
moralement afluré de l’inutilité de leur extrait
mortuaire.
Le nombre des mariages .a paru, de tout temps,
nne mefure de comparaifon très-imparfaite , & la
dépravation des moeurs a dû fortifier cette opinion.
r
' Enfin, le rapport entre le nombre des nâif-
ftnces 8c celui des habitans, nJeit pas le même
dans toutes les parties 'd'un royaume : les occu-
» utiles que le luxe & la richeffe des grandes
villcs i-afiembient , y'attirent un -grand nombre
d habitans nés dans d'autres lieux ; & la population
alors .doit s'éçarter davantage du nombre
des naiflances : c'eft. tout le contraire dans les
villages demies de reflources, parce qu’un grand
nombre d indigènes s’en éloignent à l'âge où ils
peuvent gagner leur vie par le travail.
Les différais degrés de falubrité du pays, changent
auffi les rapports communs entre le nombre
des naiflances, & celui des habitans : ainfi , partout
où la mortalité e lï conftamment plus accélérée
, le nombre des .naiflances répond -à un
moindre nombre d habitans que dans les lieux où
1 air -•& le çlimat .n abrègent pas la vie des horn-
mes. Cependant ,. toutes les différences que Fon
vient d’obferver, 8c d'autres encore , acquièrent
une forte d'uniformité , quand on les confîdère
en mafle , & dans l'immenfe étendue d'un royaume
tel que la France. A in fi, Fon a pu, d'-après
divérfés recherches, fé‘ former une hnfure gé- 1
nerale de comparaifon. ■
L e nombre, des naiflances eft à Gelai deshà- ■
Ditans, de un a vingt-trois & vingt-quatre , dans
les lieux contrariés par la nature, ou par des
circonftances morales : ce même rapport, dans
la plus grande partie de la France , ett de un à
vingt-cinq , vingt-cinq & demi & vingt-fix ; enfin,
dans les villes , félon leur commerce & leur
étendue , chaque naiffance répond à1 vingt-fept
v in g t -h u it , v in g t-n eu f 8c jtifques àtrenté
habitans, & même à davantage pour la capitale.
- , H j j *
A u milieu de ces variétés , les opinions ne
peuvent pas erre reunies fur la proportion pré-
cife qu on doit adopter, pour juger- de la popu-
T f. lr n, pAr. K nom^re des naiflances ; & ayant
-hefité moi même entre vingt-cinq te demi te vingtprendrai
ici un terme moyen ; ainfi-, pour
évaluer_iapopulation.du royaume, je multiplierai
les naiflances par vingt-cinq trois-quarts.
^-e ^£Tnier tableau complet, dont j’ai pu avoir
connoiflance, eft celui de l’année 1780. '
.< ^-es naiflances fe montoient à neuf cents quatre-
vingt neuf mille trois cents fïx.
Celles de 1 annee 1779, à üx mille fix cents foixante-nfeeputf. cents cinquante-
Celles de l’année 17 7 8 , à neuf cents trente-
deux mille huit cents.
Celles de l’année 1777 , à neuf cents quatre
vingt dix-huit mille cent quatre-vingt onze.
Celles de l’année 17 76 , à neuf cents trente-
neuf mille foixante quatorze.
Celles de l’année 1 7 7 ; , à neuf cents trente-
quatre mille quatre cents quatre-vingt.
neCufe lmlesil lde ef ixl’ acnennétes 1hu7i7t4. , à neuf cents trente-
Celles de l’année 1775 , à neuf cents miilé
quatre cents trente-huit.
- Celles de l’année » , à neuf cents cinq
mille cinq cents quatre-vingt.
Celles de l’année 1771 , à neuf cents treize
mille deux cents quatorze.
' Total , neuf millions quatre cents neuf mille
trois cents cinquante-huit.
Ç e qui fait , pour l’année commune des dix |
neuf cents quarante mille neuf cents trente-cinq.
Le nombre des morts , pendant ce même intervalle
, s’eft monté à huit millions cent quatre-
vingt-quatre mille neuf cents dix-huit.
C e qui fait pour l’année commune des d ix ,
huit cents dix-huit mille quatre cents quatre-vingt-
onze.
Le nombre des mariages , pendant ces dix
années , s’eft monté à deux milüojis cent trente-
fept Tnille fept cent quarante.
C e qui fait, pour l’année cotamune, deux
cents treize mille fept 'cents, fpïxante-quatorze.
Les naiflances multipliées-par vingt-cinq trois-
quarts , repréfenteroient vingt-quatre millions
deux cents vingt-neuf mille foixante quinze individus
; te en multipliant les morts par vingt-
neuf trois cinquièmes, & les mariages par cent-
treize un tiers, on trouverait à-pett-près le même
réfultat.
Que fl , au lieu du tableau précédent, c,om-
pofé de dix années, on arrêtoit feulement foa
attention fur les cinq dernieres , 1 7 7 6 ,1777 >
I7 7 g 177^ & 1780, on trouveroit q u e , pendant
cet intervalle, le nombre des naiflances s eft
élevé à quatre millions huit cent feize mille trente-
huit.
C e qui fait pour l’année commune, neuf cents
foixante-trois mille deux cents fept.
Et ce nombre, multiplié par vingt-cinq trois-
quarts , donneroit un total ae vingt-quatre millions
quatre-vingt-deux mille cinq cents quatre-
vingt individus.
Je crois qu’en tirant une induétion du nombre
des naiflances pendant les cinq années les plus
rapprochées , on fe forme une idee plus juite de
la population J qu’en prenant la moyenne propor-
On s’écarte moins , en effet, du moment pre-
fent 5 te d’ailleurs, il eft certain que l’ordre ob-
fervé pour recueillir des renfeignemens fur cette
matière, acquiert chaque jour plus de perfection ;
& récemment l’on vient encore de découvrir que
le Clèrmontois > fous radminiftration partieuhere
de la maifon d eC on d é , n’avoit jamais ete compris
dans les états de population : cependant il
y a lieu de préfumer que ce petit pays" contient
environ quarante mille âmes : enfin , il efl aife
d’appercevoir que des relevés de regiftres font
plus fufceptibles d’omiflion, que de doubles emplois.
On doit encore obferver, qu’ à la réferve des
Juifs de Lorraine , d’Alface te du pays Meffin,
qui font compris dans les états de population ,
tous les autres non conformiftes ne s’y trouvent
point, à moins qu’ ils n’aient été baptifes à
l ’églife romaine. C ’eft t par toutes ces raifons ,
& d’autres encore , que je fuis fermement per-
fuadé, qu’aujour.d’hui , dix-huit mois après la
p aix , les naiflances du royaume, y compris la
C o r fe , s’élèvent à plus d’un million ; ce qui indiquerait
une population de près de vingt-fix millions
d’ames : cependant, pour ne point trop s’écarter
des idées communes, & des bafes le plus généralement
adoptées , on croit pouvoir compter
une population de vingt quatre millions huit cents
mille âmes.
Je ne- doute point que la France, abftni&îon
faite de fon agrandiflement par.les conquêtes,
ne foit beaucoup plus peuplée de nos jours, qu’elle
ne l’a été dans les fiècles précédçns : ceux qui
ont annoncé le contraire, dans quelques-uns des
écrits économiques qui ont paru depuis une
vingtaine d'années , n’ont appuyé leur opinion
d’aucun calcul; te l’on voir aujourd’hui mani-
feftement , qu’ils étoient dans l’erreur fur un des
points les plus eflentiels de leurs conjectures,
puifqu’ils n’évaluoient la population du royaume
qu’à quinze ou feize millions d’ames.
D ’ailleurs, fi l’on fixe fon attention fur les
principales caufes de la multiplication des hommes
dans une contrée, on aurait peine- a ^concevoir
pourquoi la population de la France ferait
diminuée ; l’art de la culture n’a pas rétrograde,
1 étendue des anciennes forêts, n’ellplus la meme ^
des marais ont été deflechés, la mer a delaifle
plufieurs rivages , te des terreins immenfes ont
été rendus productifs : on peut obferver encore ,
que la confection de plufieurs canaux, te les
nouveaux chemins ouverts dans toute la France ,
ayant rendu le commerce des bleds plus facife ,
le fuperflu d’une partie du royaume a pu être
répandu dans les provinces qui a voient befoin
de fecours , & la population de ces memes provinces
a dû s’accroître en proportion.
Enfin , à mefure ■ que les. manufactures fe font
multipliées te perfectionnées, f induitrie nationale
a fourni de grands moyens d'échange, & 1 exportation
des bleds a .ceffé d’être une rèflource
nêceflaire pour s’ acquiter envers lés nations étrangères.
Il ferait à défirer qu’on pût rapprocher de ces
idées générales quelques notions pofitives fur
l’étendue des confommations , à diverfes époques
de la monarchie., Mais la plus, considérable ce
ces confommations., .celle des .bleds , pe peut
encore de nos jours être appréciée, te c’ eft par
le nombre! des habitads du royaume qu’on cherche
à s’en former une idée!
La confommation du fel eft , après çelle des
grains , la plus univerCelle , & Ton peut indiquer
que depuis l’année 1J 5.9 »Xepoque op M. de
Sully remit à une feule compagnie la régie des
gabelles ) , jufqu’ à nos jours-, les ventes de fei
dans les mêmes provinces n’ont jamais^été portées
fi haut qu’elles le font maintenant : l’on n a pas
confiervé , fans doute , tous les états qui en font
foi : mais en comparant le montant des baux
avec les prix d’achat .te de vente, on fe forme
des idées peu diftantes de la vérité. On p eu t,
à ce fujet, citer feulement, une particularité Ample
& remarquable : c’ eft que dans le bail paffé
fous Louis X I I I , eni6$i , à Fhillippe Hamel,
le rai garantiffoit au fermier une confommation
de dix mille deux cents cinquante muids. Cette
convention , . à la vérité , n’etoit relative qu aux
provinces de, grandes gabelles; mais la confommation
de ces mêihés provinces fe monte actuellement
, comme on l’a vu , à près de feize
mille muids. Voyè^ le mot G r e n i e r , tome I I ,
pag. 424.
Ces rapprochemens ajoutent quelque çhofe aux
idées générales j mais' on ne peut cependant en