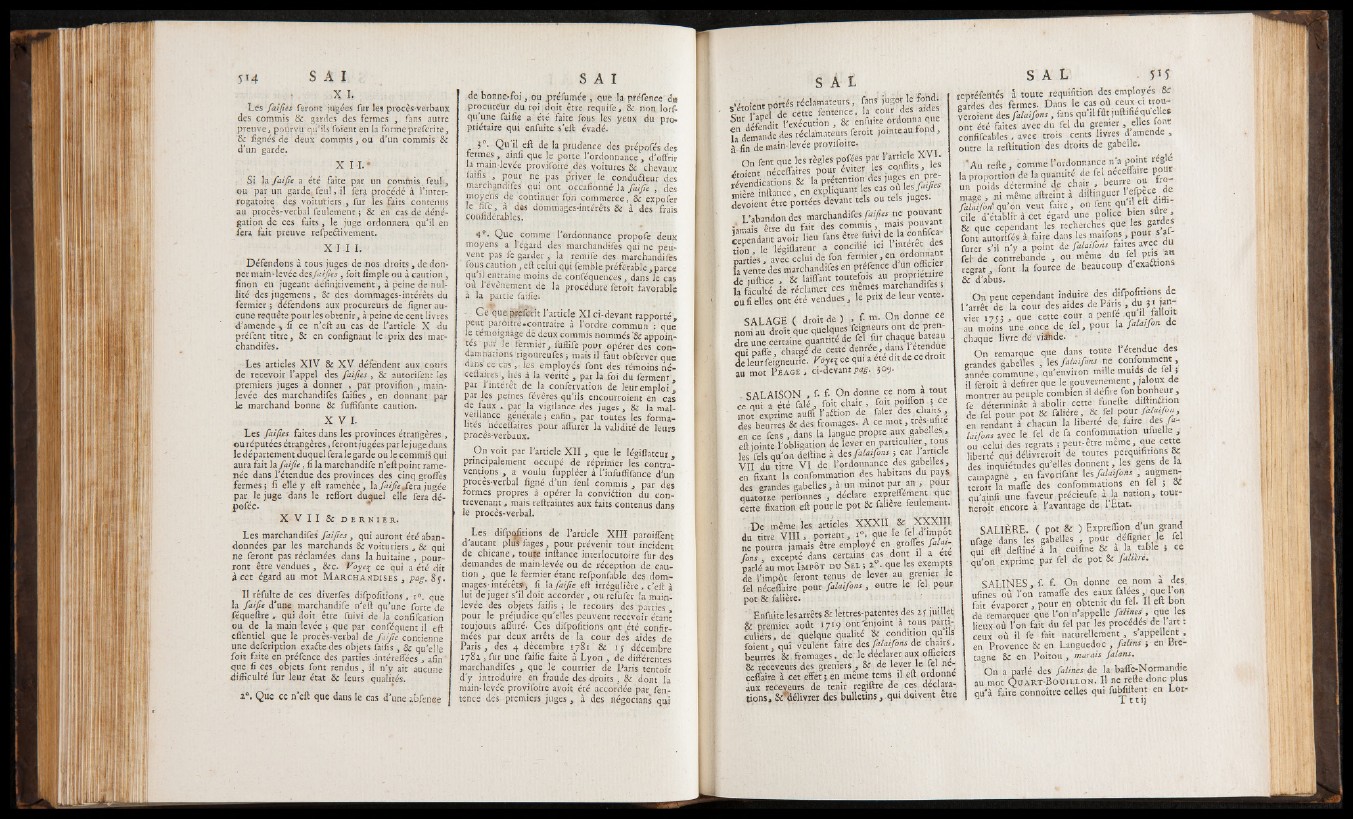
j i 4 S A I
t X I.
Lès fa i f i es feront jugées fur les procès-verbaux
des commis & gardes des fermes , fans autre
preuve j pourvu qif ils foient en la forme prefcrite,
& fignés de deux commis, ou d’ un commis &
d’un garde.
X I I.*
Si la. faifie z été faite par un comtois. feul^
ou par un garde» feul, il fera procédé à l’interrogatoire
dq$ voituriers , fur les faits contenus
au procès-verbal feulement j & en cas de dénégation
de ces faits, le juge ordonnera qu’il en
fera fait preuve refpe&ivement.
X I I I .
Défendons à tous juges de nos droits, de.don-
ner main-levée desfa i f i e s foit fimple ou à caution,
linon en jugeant définitivement, à peine de nullité
des jugemens , & des dommages-intérêts du
fermier 5 défendons aux procureurs de ligner aucune
requête pour les obtenir, à peine de cent livres
d’amende-5 fi ce n’eft au cas de l’article X du
préfent titre, & en confignant le s prix des mar-
chandifes.
Les articles X IV & X V défendent aux cours
de recevoir l’appel des faifies , & autorifent Iqs
premiers juges à donner , par provifîon , mainlevée
des marcharidifes failles, en donnant par
le marchand bonne & fuffifante caution.
X V I .
Les faifies faites dans les provinces étrangères ,
ou réputées étrangères, feront jugées par le juge dans,
le département.duquel fera le garde ou le commis qui
aura fait la faifie y li la marchandife n’ eft point ramenée
dans l’ étendue des provinces des cinq grolfes
fermes > li elle y eft ramenée, la faifie%fera jugée
par le juge dans le relfort duquel elle fera dé-
pofée.
X V I I & DERNIER.
Les marchandifes* faifies, qui auront été abandonnées
par les marchands & voituriers , & qui
ne feront pas réclamées dans la huitaine , pourront
être vendues , & c . Voye1 ce qui a été dit
à cet égard au mot Marchandises , pag. 8y. i
II réfulte de ces div.erfes difpofitions, i° . que
la faifie d’une marchandife n’eft qu’une forte de
féqueftre , qui doft être fuivi de la confifcation
ou de la main -levée ; que par conféquent il eft
eflèntiel que le procès-verbal de faifie contienne
une description exaéte des objets failis , & qu’elle
foit faite en préfence des parties dntérelfées, afin'
que li ces objets font rendus, il n’y ait aucune
difficulté fur leur état & leurs qualités.
2°. Que ce n’eft que dans le cas d’ une abfenee I
S A I
de bonne-foi, ou .préfumée , que la préfence’ d»
procureur du.roi doit être requife, & non lorfc
^nu.ne faille a‘ été- faite fous les yeux du propriétaire
qui enfui te s’ell évadé.
5°. Q u ’il eft de la prudence des prépofés des
fermes , ainfi que je porte l’ordonnance , d’offrir
Y B f « ptovifoire^des voitures 8c chevaux
laifis , pour ne pas priver ,1e conducteur des
marchandifes qui ont oçcafionné Ja faifie des
moyens de continuer fori commerce, 8c expofer
le fifc, à des dommages-intérêts 8c à des frais
Cpnüdérablés.
Que comme l’ordonnance propofe deux
moyens a l’égard des marchandifes qui ne peuvent
pas fe garder , la remife des. marchandifes
fous,caution, eft celui qui femble préférable ,parce
qu il entraîne moins de conféquences, dans le cas
ou l’évènement de la procédure feroic favorable
a la partie faille-.
C e "que prefcrit 1 article X I ci-devant rapporté «
peut parôltre .contraire à l’ordre commun : que
le témoignage dè deux commis nommés '8c appoint
tes pai; le fermier, fùffife pour opérer des condamnations
rigoiireufes } mais il faut obferver que
dans ce-cas ,, les employés font des témoins né-
celiaires , liés à la vérité , par la foi du ferment *
par l’intérêt de la confervation de leur emploi
par les peines févères qu’ils encoürroient en cas
de faux par la vigilance des juges, 8c la malveillance
générale 5 enfin, par toutes les formalites
nécelfaires pour affiner la validité dé leurs
procès-verbaux.
On voit par l ’article X I I , que le légiftateur
principalement occupé de réprimer les contraventions
, a voulu fuppléer à l’infuffifance d’un
procès-verbal figné d’un feul commis , par des
formes propres à opérer la conviction du contrevenant
> mais reftraintes aux faits contenus dans
le procès-verbal.
Les difpcgïtions de l’article XIII paroiffent
d ’autant plus fages, pour prévenir tout incident
de chicane, toute inftance interlocutoire fur des
.demandes de main levée ou de réception de caution
, que le fermier étant refponfable des dommages
intérêts, fi la faifie eft irrégulière, c’eft à
lui déjuger s’il doit accorder, ou refufer la mainlevée
des objets faifis ; le recours des parties
pour le préjudice qu’elles peuvent recevoir étant
tou jours afin ré. Ces difpofitions qnt été confirmées
par deux arrêts de la cour des aides de
Paris, des 4 décembre 1 7 8 1 '& iy décembre
1782, fur une faifie faite à Lyon , de différentes
marchandifes , que le courrier de Paris tentoit
d’y introcUiire en fraude des droits, $c dont la
main-lëvéê provifoire ayoit été accordée par fe-n-
tence des premiers juges , à des négociant qui
s À t
> S w nortés réclam ateurs., fans' jugér l i (MH
ü g » l l fentelice. la cour des aides
Sl“ . i g S i t l ’exécution ! & enfuite ordonna que
la demande des réclâmateurs ferait jointe au fopd , à- fin de main-levée provifoire, ; ,
Gn fent que les règles pofees P?r ies
ÿ S S S S i S S S S ^ ^
L ’abandon des marchandifes faifies ne pouvant
• Ta* être du fait des commis, mais pouvant
cependant avoir Heu fans êere fuivi de la confifca-
tion le légiflateur a concilie ici 1 interet clés
parties, ayec celui de fou fermier, en ordonna«
fa vente des marchandifes en prefence d un officier
d / fu ftk e , & biffant toutefois au proprietaire
la faculté de réclamer ces memes marchandifes,
ou fi elles ont été vendues f le prix de leur vente.
SA LAG E ( droit de ) . f- «• ° n ce
noffi au droit que quelques Teigneurs ont de pren-
dre une certaine quantité de fel fur chaque bateau
oui oaffe X g e ^ d e cette denrée, dansTetendùe
de leur feigneurie. V o y ie z qui a ete dit de ce droit
au mot Péage » ci-devant PQë’
CAT A K O N . f. f. On donne ce nom à tout
ce qui a été fa lé ,: foit chair , foit poiffon.; ce
mot exprime aufli l’aftion de faler des.chairs-,
des beurres Se des, fromages. A ce mot,
en ce fens, dans la langue propre aux gabelles,,
eft jointe 1 obligation de lever en particulier, tous
les fels qu’on deftine à des falaifons ; car i article
VII du titre V I de ^ordonnance des gabelles,
en fixant la confommation des habitans du pays
des grandes gabelles, à un minot par an , pour
quatorze perfonnes , déclare «preffement que,
cette fixation eft pour le pot & faliere feulement.
De même, les articles X X X I I &. X X 5ÇIII:
du titre V III. portent, i ” , que Te fel d impôt
ne pourra jamais être employé en greffes faillirons
, excepté dans certains cas dont il a ete
parlé au mot Impôt dü Sel ; 29. que les exempts
de, l'impôt feront tenus de lever au grenier ,1e
fel néeeflaire pour falaifons , outre le fel pour
pot & faüère.
Enfuite les arrêts & léttres-patentès des 2 y juillet
& premier août 1719 on} ’én j oint ‘ à tous parn-,
culiêrs, dé quelque qualité 8ç condition qu ils
foient, qui veulent faire des falaifons de chairs,
beurres &. fromages, de: le déclarer aux officiers 8c receveurs des greniers , 8c.de lever le fel ne-
ceffaire à cet effet j en même tems il eft ordonne
aux receveurs de tenir regiftre de ces déclara-
tions» &*é liv re r des bulletins, qui doivent etre
S A L PS
reptéfentés 5 toute requifition des employés &
gardes des fermes.. Dans le cas où .ceux-ci trou-
vèroient des falaifons, fans qu il fût juftifiequ elles
ont été faites avec du fel du gremer . elles font
cdiififcables, avec trois cents livres d amende ,
outre la reftitution des droits de gabelle.
*Au ré ile , comme l’ordonnance n’a point régie
la proportion de la quantité de fel nec^“ a‘ r^ Pf
un poids déterminé de chair , bellrï, f . j e
mage , ni même attreint a diftinguer 1 efpe
faUifon'. qu’on veut faite , ^ S“ i I e* 'a «
cile d’ établft à cet égard une police
& que cependant les recherches que les gardes
fon? a u t o r L à faite dgns.les.maifons, pour s af-
furer s’ il n’y a point de falaifons faites ar
fef de contrebande , ou meme du .
regrat, font la fourcc de beaucoup d exactions
& d’abus.
On peut cependant induire des difpofitions de
l ’aoe"Pde la L u t des aides de P â tis , g g g l e vier
1755 , que cette cour a penfe qu il falloir
au moins une .once de. fe l, pour la falaifon de
chaque livre de vilhde.
On remarque que dans toute l’étendue des
grandes gabelles , les falaifons ne confomment,
année commune , qu’environ mille mutds de f e l ,
il feroit à defirer que le gouvernement, jaloux de
montrer au peuple combien il d! firePon b°,.
fe déterminât à abolir cette’ funefte diftimftion
de fel pour pot & faüêre, & / e l pour falaifon,
en rendant à chacun la liberté de faire des fa-
laifons avec le I fel de fa confommation ufuelle ,
ou celui des regrats ; peut-être meme, que cette
liberté qui délivrerait de toutes perqumtions 8c
des inquiétudes quelles donnent, les gens de la
campagne , en favorifa'nt les falaifons , s“ gmed-
teroit la malle des confommations en fel ; 8C
qu'ainfi une faveur,précieufe à .la nation, tournerait
encore à l’avantage de 1 Etat.
SALIÈRE. ( pot & ) Expreffion d’un grand
ufage dans les gabelles , pour defîgtier le fel
qui eft deftiné à la. cuifine 8c a la table } ce
qu’on exprime par fel de pot, & faherè.
S A L IN E S , f f. On donne ce nom à des.
ufines où l’ on ratnaffe des eaux falées,_ que fo n
fait évaporer, pour en obtenir du fel. Il elt bon
de remarquer que l’on n'appelle fahnes , que les
lieux-où* l’on fait du fel par les procédés de 1 art :
ceux où il fe fait naturellement, s appellent ,
en Provence 8c en Languedoc-, fàlins j en Bretagne
8c en Poitou , marais falans.
H a parlé des falines de la baffe-Normandie
au mot Q uart-Bouillon. Il ne relie donc plus
qu’ à faire cônnoître celles qui fubfiftent en Lot-
T 1 1 ij