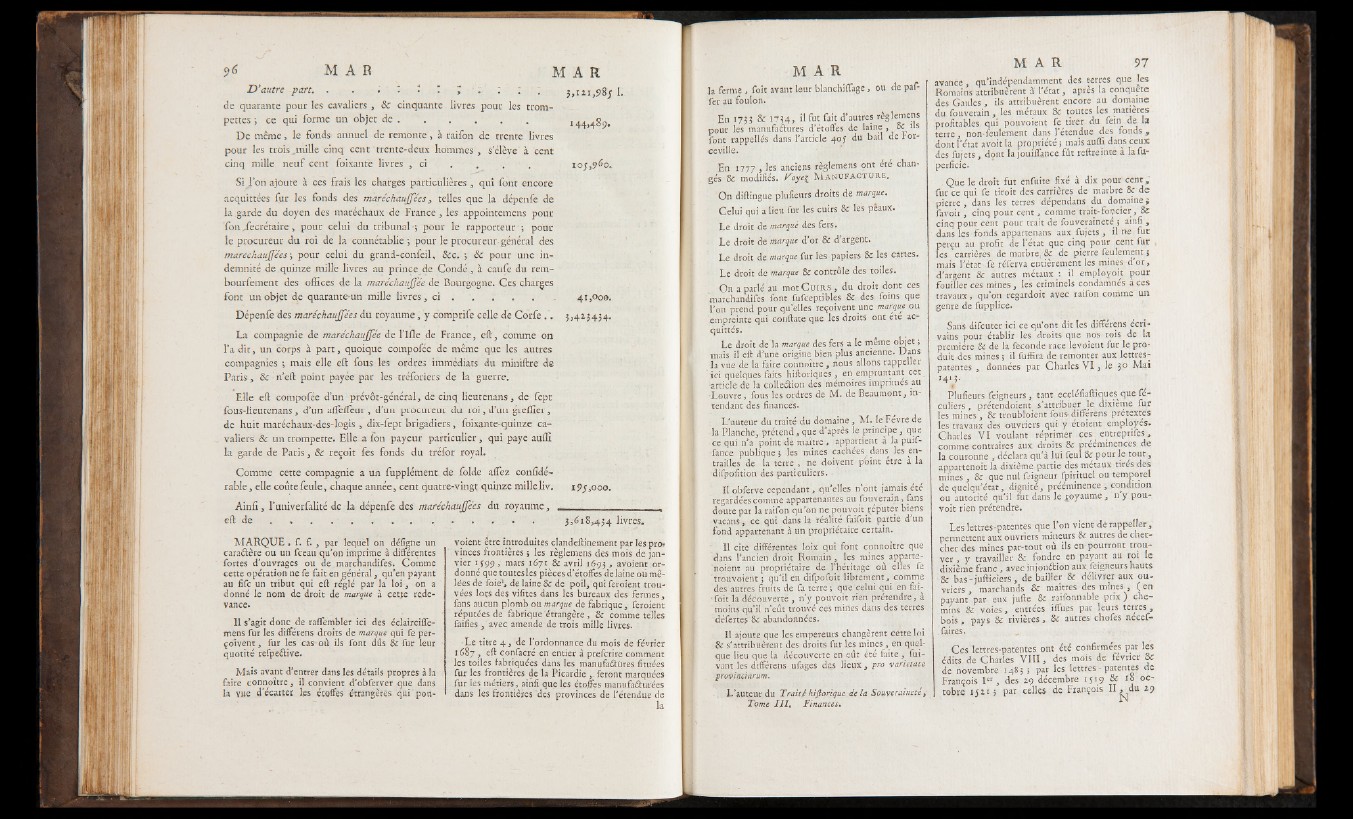
D ’autre part. . . . Z t • 1 * 7 : ; 7
de quarante pour les cavaliers , 6c cinquante livres pour les trompettes
•, ce qui forme un objet de . ^.
De même, le fonds annuel de remonte , à raifon de trente livres
pour les trois jnille cinq cent trente-deux hommes , s'élève à cent
cinq mille neuf cent foixante livres , ci . .
Si l’on ajoute à ces frais les charges particulières , qui font encore
acquittées fur les fonds des maréchaujfées y telles que la dépenfe de
la .garde du doyen des maréchaux de France, les appointemens pour
Ton Secrétaire, pour celui du tribunal -, pour le rapporteur ; pour
le procureur du roi de la connétablie -, pour le procureur- général des
maréchaujfées 3 pour celui du grand-confeil, 6cc. -, 6c pour une indemnité
de quinze mille livres au prince de Condé, à caufè du rem-
bourfement des offices de la maréchaujfée de Bourgogne. Ces charges
font un objet de quarante-un mille livres, c i .
Dépenfe des maréchaujfées du royaume, y comprife celle de Corfe . .
La compagnie de maréchaujfée de llfle de France, eft, comme on
Ta die, un corps à part, quoique compofée de même que les autres
compagnies 3 mais elle eft fous les ordres immédiats du miniftre de
Paris, 6c n eft point payée par les -tréforiers de la guerre.
3,121,98; 1.
144,489.
105,960.
41,00®.
3,423434.
Elle eft compofée d’un prévôt-général, de cinq lieutenans, de fept
fous-lieutenans, d’un aflèfïeur, d’un procureur du roi, d’un greffier,
de huit maréchaux-des-logis , dix-fept brigadiers, foixante-quinze cavaliers
6c un trompette. Elle _a Ion payeur particulier, qui paye auffi
la garde de Paris, 6c reçoit fes fonds du tréfor royal.
Comme cette compagnie a un fupplément de folde affez confïdé-
rable, elle coûte feule, chaque année, cent quatre-vingt quinze milleliv. 19;,000.
Ainfi, l’univerfalité de la dépenfe des maréchaujfées du royaume, -
eft de . . . . . V « . . . . . 33618,434 livres.
M A R Q U E , f. f. , par lequèl on défigne un
caractère ou un fceau qu’on imprime à différentes
fortes d’ouvrages ou de marchandifes. Comme
cette opération ne fe fait en général, qu'en payant
au fife un tribut qui eft réglé par la lo i , on a
donné le nom de droit de marque à cetfe redevance.
I l s’agit donc de raffembler ici des éclairciffe-
mens fur les différens droits de marque qui fe perçoivent,
fur les cas-où ils font dûs & fur leur
quotité refpe&ive.
Mais avant d’entrer dans les détails propres à la
faire connoître, il convient d’obferver que dans
la Yue d'écarter les étoffes étrangères qui'pouvoient
être introduites clandeftinement par les provinces
frontières 5 les règlemens des mois de janvier
i f 99 , mars 1671 & avril 1693 , avoient ordonné
que toutes les pièces d’étoffes de laine où mêlées
de foie1, de laine & de poil, qui feroiènt trouvées
loçs des vifites dans les bureaux des fermes,
fans aucun plomb ou marque de fabrique, feroient
réputées de fabrique étrangère , & comme telles
faifies , avec amende de trois mille livres.
■ Le titre 4 , de l’ordonnance du mois de février
1687, eft confacré en entier à preferire comment
les toiles fabriquées dans lès manufaâûres fituées
fur les frontières de la Picardie feront marquées
fur les métiers, ainfi que les étoffes manufacturées
dans les frontières des provinces de l’étendue de
la
Ja ferme, foit avant leur blanchiffage, ou de paf-
fer au foulon.
En 1733 8c 1734, il fut fait d’autres règlemens
pour les manufactures d’étoffes de laine , & ns
font rappellés dans l’ article 40 y du bail de ror-
ceville.
En 1777 > les anciens règlemens ont été changés
8c modifiés, f^oye^ M a n u f a c tu r e .
On diftingue plufieurs droits de marque.
Celui qui a lieu fur les cuirs 8c les peaux.
Le droit de marqué des fers.
Le droit de marque d’or 8c d argent.
Le droit de marque fur les papiers 8c les cartes.
Le droit de marque 8c controle des toiles.
On a parlé au mot C u ir s , du droit dont ces
marchandifes font fufceptibles & des foins que
l’on prend pour quelles reçoivent une marque ou
empreinte qui conftate que les droits ont ete acquittés.
Le droit de la marque des fers a le même objet ;
mais il eft: d’une origine bien plus ancienne. Dans
la vue de la faire connoître , nous allons rappeller
ici quelques faits hiftoriques , en empruntant cet
article de la collection des mémoires imprimes au
Louvre, fous les ordres de M. de Beaumont, intendant
des finances.
L ’auteur du traité du domaine, M. le Fevre de
la Planche, prétend , que d’ après le principe, que
ce qui n’a point de maître, appartient à la puif-
fance publique 5 les mines cachées^, dans^ les entrailles
de la terre , ne doivent point etre a la
difpofition des particuliers. -
Il obferve cependant, qu’elles n’ont jamais ete
regardées comme appartenantes au fouverain, fans
doute par la raifon qu’on ne pouvoit ^eputer biens
vacâns, ce qüi dans la réalité faifoit partie d un
fond appartenant à un propriétaire certain.
Il cite différentes loix qui font connoître que
dans l’ancien droit Romain, les mines apparte-
noien.t au propriétaire de l’héritage où elles fe
trouvoient ; qu’il en difpofoit librement, comme
des autres fruits de fa terre ; que celui qui en faifoit
la découverte , n’y pouvoit rien prétendre, à
moins qu’il n’eût trouvé c,es mines dans des terres
déferte^ & abandonnées.
Il ajoute que les empereurs changèrent cette loi
$c s’ attribuèrent des droits fut les mines , en quelque
lieu que la découverte en eût été faite , fui-
vant les différens ufages des lieux , pro varietate
provitiçiarum.
L ’auteur du Traité hiftorique de la Souveraineté,
Tome 111. Financés.
M A R 97
avance , qu'indépendamment des terres que les
Romains attribuèrent a l’état, après la conquête
des Gaules, ils attribuèrent encore au domaine
du fouverain, les métaux 8c toutes les matières
profitables qui pouvoient fe tirer du fein de la
terre, non-feulement dans l’étendue des fon d s ,
dont l’état avoit la propriété ; mais auffi dans ceux
des fujets, dont la jouiffance fut reftreinte a lafu*
perfide.
, Que le droit fut enfuite fixé à dix pour c en t,
fur ce qui fe tiroit des carrières de marbre & de
pierre, dans les terres dépendans du domaine;
favoir, cinq pour cen t, comme trait-foncier, &
cinq pour cent pour trait de fouveraineté ; ainfi ,
dans les fonds appartenans aux fujets , il ne fut
perçu au profit de l’état que cinq pour cent fur
les carrièrès de marbre, 8c de pierre feulement 5
mais l’état fe réferva entièrement les mines-d’o r ,
d’argent & autres métaux : il employoit pour
fouiller ces mines, les criminels condamnés à ces
travaux, qu’on regardait avec raifon comme un
genre de fupplice.
Sans difeuter ici ce qu’ont dit les différens écrivains
pour établir les droits que nos rois de la
première & de la fécondé race levoient fur le produit
des mines 3 il fuffira de remonter aux lettres-
patentes , données par Charles V I , le 30 Mai
1413.
Plufieurs feigneurs, tant eccléfiaftiques que fe-
culiers, prétendoient „s’attribuer le dixième fur
les mines , 8c troubloient fous- différens prétextes
les travaux des ouvriers qui y etoient employés.
Charles V I voulant réprimer ces / entreprifes,
comme contraires aux droits 8c prééminences de
la couronne , déclara qu’ à lui feuî 8c pour le tout,
appartenoit la dixième partie des métaux tires des
mines , & que nul ftigneur fpirituel ou temporel
de quelqu’état, dignité, prééminence, condition
ou autorité qu’ il fut dans le Royaume , n’y pouvoit
rien prétendre.
Les lettres-patentes que l’on vient de rappeller,
permettent aux ouvriers mineurs 8c autres de chercher
des mines par-tout où ils en pourront trouver
, y travailler 8c fondre en payant au roi le
dixième franc, avec injonction aux. feigneurs hauts
8c bas-jufticiers, de bailler 8c délivrer aux ouvriers
, marchands & maîtres des naines^, ( en
payant par eux jufte 8c raifonnable prix ) chemins
& voies, entrées ifîùes par leurs terres,
b o is , pays 8c rivières, 8c autres chofes necef-
faires.
Ces'lettres-patentes ont été confirmées par les
édits de Charles V I I I , des mois de février 8c
de novembre 1483 j par les lettres - patentes de
François 1er, des 29 décembre 1 y 19 & m octobre
15213 par celles de François I I , du 29