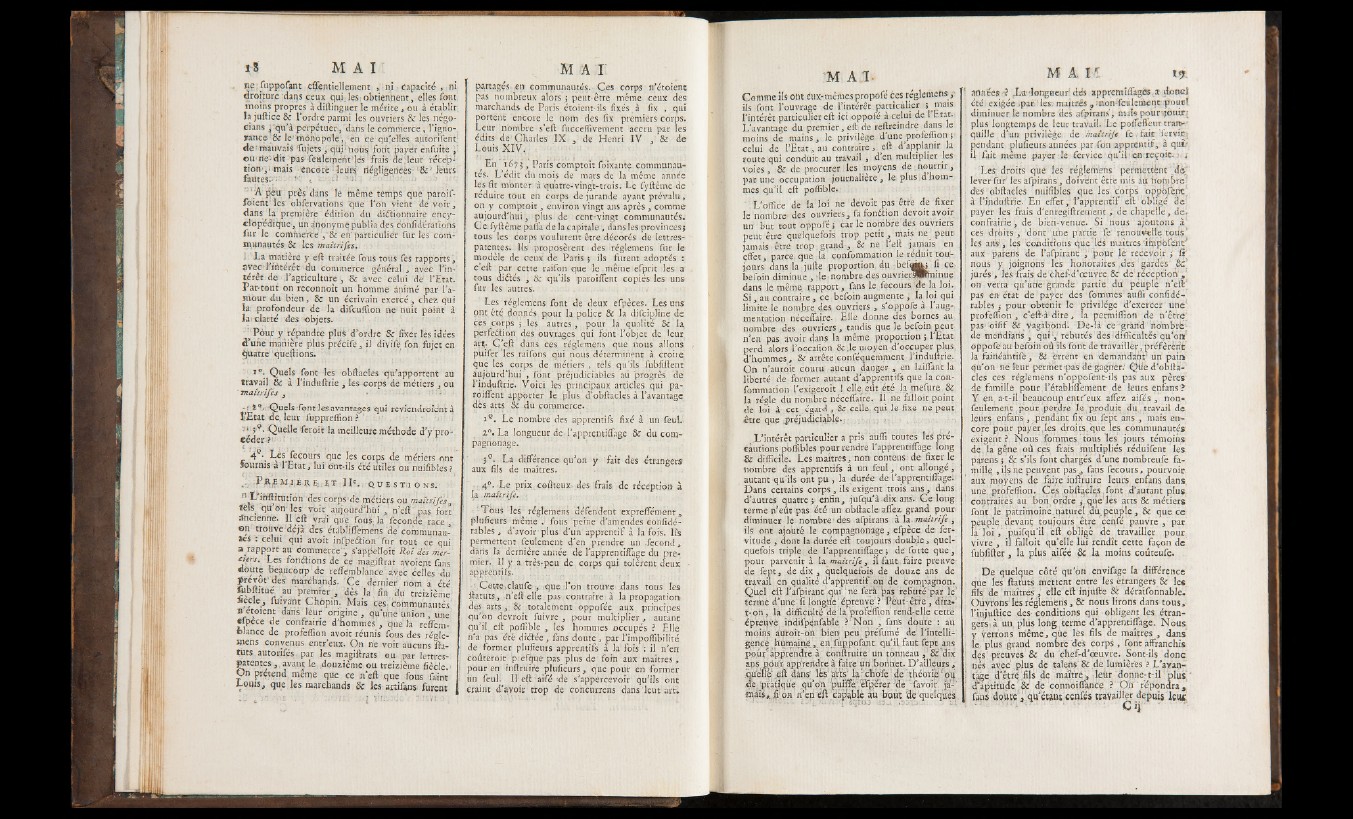
i8 M A I M A I
ne ; fuppofant e^feptiellement , - ni 3 Capacité , ni
droiture dans ceux qui-les- obtiennent , elles font,
moins propres à diftinguer le mérite , ou à établir
la juftice & l’ordre parmi les ouvriers & lés négo-
cians jq u ’ à perpétuer:, dans le commerce ; l’igrio-,
xance;& le-mônopolé, en ce qu’elles aiïtorifent;
d e r mauvais 'fujets, qui*'noüs font payer enfuite II
©U‘rie-dit pasj feulcmëifit'Iës frais de/lëur recép-*
tiornymais èncorë1 leurs riëgligerieès: /fours
fautes^" ' r iu ?noî3itoqi»n
' A peu près dans le même temps que paroif-
foient'les obfervatiohs que l’on vient d e v o ir ,
<lan^la première édition du diélionnaire encyclopédique1,
un anonyme publia des cônfîdérauons
fur le commérte eh‘ particuiiéï fur les com-y
munautési & hsmaUriJis.
i L a matière y eft traitée fous tous fes rapports y
ayecTiriterjet du commerce général:, avec l’ intérêt,
de ,l’agriculture-, & avec celui dè* l’Etat.
Par-tout on reconnoît un homme animé par l’amour
du bien, & un écrivain exercé-3 chez qui
la; profondeur de la difcuffion ne nuit point à
la clarté des objets.
jP à u t yLépahdre pi iis d’ordre &,fixér lès idées
d’ une manière pliis précife , il divife fon fujet en
quatre ■ quel! ion s:
i° . Quels-font les obftacles qü’apport'ënt aü
travail & à l’induftrie , les corps de métiers , ou
‘ maîtrifés ,
- r i^ Q u e l s font les avantages qui reviendroidnt à
ljEtat de. leur fuppreflion ? ' :
Quelle ferait la meilleure méthode d’y procéder?
n fiî
,4 • fecours que les corps de métiers ont
soumis a '1 Etat, lui 'ont-ils été utiles on nuifibles ?
.ai ftf?.'Wi&**Bj^T I I Cr, QUE STII O NS. »
des!'corps1 de métiers cmmaîtrife/^
tèis qu oir les vbit aujourd’hui n’eft pas fort
ancienne. Il eft vrai que fous la fécondé race .
®P. tro^vf'déjà- des étdblifTemens de communautés
. celui qui avoit infpeéfcîon^ fur touç cè qui
»rapport au commerce ",/s’appeHoît R o i des niér-
eters. Les fondions de Ce magiftrat ayoiept fans
• fÿ jjg he^ucoup1 de refTèmblance;avec celles du
prévôt'des marchands. 'C e dernier' nom a été
fubffiÉué au premier , dès la . fui du treizième^
3*ecle, fuiyâht Chôpîn. Mais ces- communautés^
B étoient dans Wur origine , qu'une u n io n u n e
«lpàce de confrairie d'hommes1, quêta reffem-
©lance de profeffion avoit réunis fous des réglé-
mens convenus entr’eux. On ne voit aucuns fta-
tuts autorifés. par les magiftrats ou par lettres-
patentes, , avant le douzième ou treizième fièble.1
P n P^fÇnd, meme que ce .n’eft que fous farnt
Lqms, que les marchands & les artiians furent
partagés ,en> communautés. Ces corps îî’étoient
pas nombreux alors ; peut-être même ceux des
marchands de Paris, étoient-ils fix é sà fix , qui
portent encore le nom des fix premiers corps.
Leur nombre s’eft fucceflivement accru par les
édits-de1 Charles IX y de Henri IV , & de
L ô u isX lV .
£ n $ p $ ? , Paris comptoit foixarite communau-
( tés. L’édit du mois de mars de la même année
| les fit m!onter-.rà 'quatre-vingt-trois. Le fyftême de
réduire tout en corps de jurande ayant prévalu,
on y comptoit, environ vingt ans après, comme
aujourd’hui, plus- de cent-vingt communautés;
C e fyftême pafla de la capitale", dans les provinces^
tous les corps voulurent être décorés de let/tres-
pàtentes. Ils proposèrent des f églemens fur le
modèle de ceux de Paris î ils furent adoptés :
c’eft par cette raifon que le même efprit les. a
tous diélés j & qu’ils paroiffent copiés-les uns
fur les autres.
Les réglemens font de deux efpèces. Les uns
ont été çionpés, pour l,a police & la difcipline.de
ces corps j les autres, pour la qualité & la,
perfeétiqn des ouvrages qui font l’objet de leur
àr$* Ç ’eft dans ces régtemens que nous allons
püifer les raîfons qui nous déterminent à croire
que les corps de métiers , téls.qu'ils fubfiftent
aujourd'hui , font préjudiciables au progrès de
l’induftrie. Voici les principaux articles, qui pa-
foiffent apporter le plus d’obftaclés à l’avantage
dès arts Si du commerce..
i Q. Le nombre des apprentifs fixé à un feuL
20. La longueur de- l’apprentiftage & du com-
pagnonage.
5°. La différence qu’on y fait des étrangers1
aux fils de maîtres.
. 4°. L e pnx coûteux>.des -frais de réception à
{a maîtrife, <
-Tous dès réglemens défendent expréffément,
plufieurs même v fous 'peine d’ainendes ëonfidé-
rables, d’avoir plus d’un apprentif à la fois. Ifs
permettent feulement d’ en prendre un .fécond,
dans la dernière année de l’apprentifTage du premier
II y à très-peu de corps qui tolèrent deux •
apprenti fs.
^Cetjte.claüfe y ique;l*on trouve dans tous les
ftatuts,, .n’eft elle pas, contraire: à la propagation
des arts ,; & totalement oppofée aux principes
qu’on devroit fuivre , pour multiplier, autant
qu’ il, eft poflible , les hommes occupés ? Elle
n’a pas été dîétée, fans doute, par l’impoflîbilité
de former plufieurs apprentifs à la fois : il n’en
cbûtéroit p:efque pas plus de foin aux maîtres ,
pour en; fnftruir’e plufieurs, que polir en former
lin feul. Il: eft ai Té de s’appercevoir' qu’ils ont
craint d’avoir tro-p de concuriens dans leut art*
M A l
Comme ils ont éux-mêmes propofé ces réglemefts,-
ils font l’ouvrage de l’intérêt particulier } mais
l ’intérêt particulier eft ici oppofé à>celui de 1 Etat.’
L ’avantage du premier, eft de rèftreindre dans le
moins de mains, le privilège d’une profeifion- ;
celui de l’Etat> au contraire, eft d’applanir la
route qui conduit au travail , d’en multiplier les
voie s , & de procurer les moyens de.nourrir,
pat une occupation journalière, le plus;dhommes
qu’ il eft poflible*;
‘ L’ office de la loi ne de voit pas êtrè de fixer
le nombre- des ouvriers , fa fonéiion devoir avoir
un but tout oppofé car le nombre des ouvriers
peut être quelquefois trop p e tit, mais ne peut
jamais être trop, grand , & ne 1 eft jamais en
effet, parce, que la confomm,ation le,réduit tou-
jpurs dans la jufte proportion; dp ;bef<M^j fi çe^
befoin diminue., de; nombre des o.uvr-ier^Pïninue
dans le même rappprt, fans le feçours, de la loi.
Si y au contraire J ce befoin augmente y la loi qui
limite le nombre, d,es. ouyriçrs , s’oppofe a 1 augmentation
néceffaire. Elle donne des bornes au,
nombre des ouvriers, tandis que le befoin peut
n’en pas avoir ctans la même proportion j 1 Etat:
perd alors l’occafion & .le m°y^n d occuper plus,
d ’hommesc, & arrête conféquemment rinduftrie.,
On n’auroit couru aucun danger , en laifiant la
liberté de former autant d’apprentifs que la con-
fommation l’exigeroit ! ellpeût été la meftire &,
la régie du nombre néceffaire. I l , ne falloit point
de loi à cet égard , & celle, qui le fixe ne peut
«tre que préjudiciable. ;
L'intérêt particulier a prisJauffi toutes lès précautions
pbffibles pour rendre l’apprentiffage long
& difficile. Les maîtres, non contons de fixer le
nombre des apprentifs à un feul ont allonge,
autant qu’ils ont pu , la durée de l’apprentiffaget
Dans certains corps, ils exigent .trois ans , dans;
d’autres quatre 5 enfin, ijufqu’à dix;ans. :Ge long
terme n’euc pas été un obftacle aifez grand pour-
diminuer le nombre1 des afpirans à la.maîtrife^
ils ont ajouté le compagnonage ÿ efpèce. de fer-
vitude , dont la- durée eft toujours double, queb
quefois triple de l’apprentiflage} de forte q u e ,
pour parvenir à la maîtrife, il faut., faire preuve'
de. fept, de dix , quelquefois de douze ans de
travail en qualité d’a'ppreritif. ou de compagnon.
Quel eft j ’ afpirant :qui';‘ nëie^rà!|)as rebuté'par le]
terme d’une- fi lbflgjié * épreuve’? ' 'Pé'ut-.ê):èe:, dirà^
t-on , la difficulté d é là ’prpfëâipn- rend-elle cette
épteqvé indifpenfab'îe ?’ Non , fans doute : aü
moins aqroit-on bien peu préfumé de l ’intelligence
humaine^,. enLuppofant. qu’il faut fept- ans
pour^apprêntlre à, cqnftruire lin tonneau ’dix
ans bburappYeridre à faire'üriborîhet. D ’ailleurs,
"quêTl& „eft aâbtf lès'/aYfe la^cWbfe de *thébT^fb’ü
de 'prauque .qu’o’n puiffid“ !Hpcrer Jde ‘ faVcnr. Ja-
iu'aîs y fi on • n’en èft J â u bdüt ?dé'quelques
M A M
années!r'? fL’a'^ong0cur: dés appremifTagds,a’ donc)
été; exigée ..pab'les: maftnés <, ?Eton-feiiilemenq,p’ouc 1
diminuer le nombre des afpwans; buis poünjôuir;
plus longtemps de, leur travail. L e pofiTefleur tram*r
quille d’un privilège.. de maîcrije fevfaic fervir;
pendant plufieurs années par fon apprentify à qui-
il fait même payer le 1er vice 'qu’il fencreçoit. >■. i
/Les; droits que leS réglefh:ens' permetiènt/db*
lever mr'1 lès afpirans'., doivént être mis ad ftofnbre-
dëS ! obftacles nuifibles que les c'orp^ oppoforit
à rinduftfje. En effet, l’appreptif eft obligé ae
payer les frais d’enregiftrement i, de chapelle, dèj-
confraifie t de bieti-venue. Si nous ajoutons a 1
ces drbits , 'dont ube partie fe' ' renondelle toUâ *
les ans1, lés conditions quedéè maîtres 'ifùpb{enti
aux païens de i-afpirant'^ pour le recevoir ; fi'
nous y. jbignbns les honoraires ,des : gardes
jurés , les frais de chef-d’oeuvre. 8à dé' réception , '
on verra qu’urie- grande partie du péiiple n’eft'
pas en-état de payer des fommes auffi confidé-
rables j pour obtenir le privilège d’exet'cei: une'
profeffion, c’eft-àdire, îa permiffion de n’êtré
pàsfôifif Sê^yagabbiidl De-là c'e^gfàhd ncrmbrb;
de mCûdiàrfs , qu* v rebutés ' dès : difficultés' qu’on1
oppofe au bëfôin où îls font dè travailler ^ préfèrent
la fairiéahtifè , Si errent en demandant' up pain
qu’on ne lèur pérmèt pas: dè gagner.’ Q u e d ’obfta-
cles ces réglemens n’oppofent-ils pas aux pères
de,famille pour rétabliflement de leurs enfans'?
Y en. a-t-il beaucoup entr’eux a fiez aifés , non*
feulement ‘ pour perdre le p_rodujtj pu/travail de
leurs enfans, pendant fix qü fept ins , mais en-
çô^e pour payer.les droits.que les communautés'
exigent ? ÎNo.usrfommes, tous les jours témoins
de. Ja gêne ; où eps frais multipliés rédùifent les
parehs > & s’ils font chargés d’une nombreufe famille:
,i($ ne peuvent pas , fans fecours, pourvoir
aux moyens de .faire inflri^Fe leurs enfans dans
une,profeffion. C e s .obft^çtes font .d’autant plus
contraires au b ôn p td rè yq p ed e s arts & métiers
font , le pàtrimoiné..qaturél,du peuple, & que ce
peuple; t devant toujours être cènfé pauvre , par
la loi / puifqu’il eft oblige de travailler pour
vivre', il falloit qu’elle lui rendît cette façon de
fubfifter , la plus aiféé 8c la moins coûteufe.
De quelque côté qu’ôii envifage la différence
que lés ftatuts mettent entre les étrangers & le«
fils de'hiâîtrës , elle eft irtjùfte 8b déraifonnable.
Oiivfons lès réglemëhs, & noüs lirons dans tous*
Linjuftice des conditions qui obligent les étran-
gçrsîa un, plus long terme d’apprentiffage. Nous
y verrons même, que les fils de maîtres , dans
■ Je, plus grand nombre des corps , font affranchis
pes; preuves & du chef-d’oeuvre. Sont-ils donc
ries , avec plus, dç taien^/& de lumières ? L’avantage
d’êtr^fils de matfrey Jeür dopne-t-il plus
d’aptitude ' 8c dè conrioiflance ? On répondra 9
fins dqjiçç i ,qü*étj(nt cenfés travailler depuis IçW