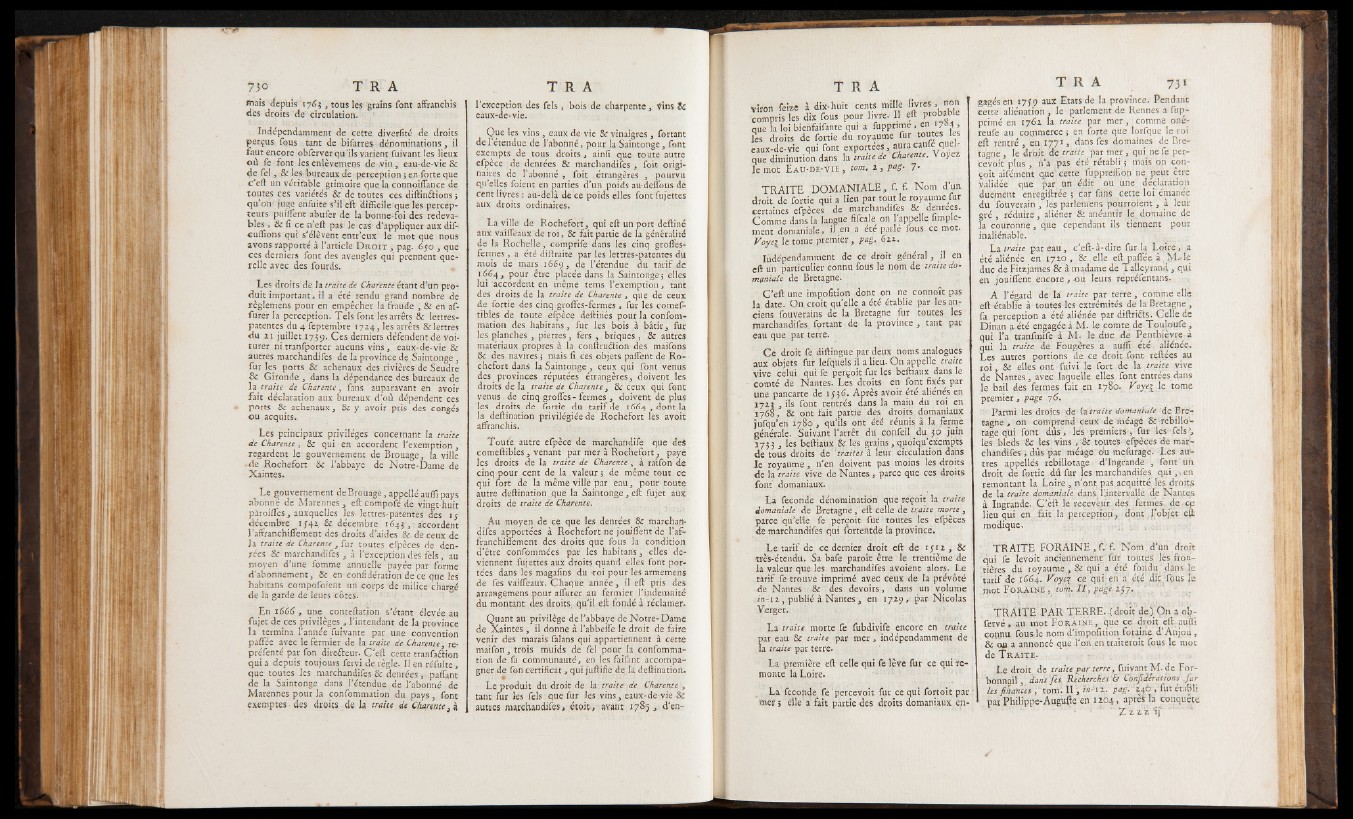
mais depuis 1763 , tous les grains font affranchis
dés droits de circulation.
Indépendamment de cette diverfité de droits
perçus fous tant de bifarres dénominations, il
faut encore obferver qu'ils varient fuivant les lieux
où fe font lesenlèvemens de v in , eau-de-vie &
de fe l, & les' bureaux de perception ; en forte que
c’eft un véritable grimoire que la connoiffance de
toutes ces variétés & de toutes ces diftin&ions 5
qu'on' juge enfuite s*il eft difficile que-les percepteurs
puifiTent abufer de la bonne-foi des redevables
, & fi ce n’eft pas le ca-S' d'appliquer aux dif-
cuflions qui s’élèvent entr’eux le mot que nous
avons rapporté à l ’article D roit , pag. 6 ƒ o , que
ces derniers font des aveugles qui prennent querelle
avec des fourds.
Les droits de la traite de Charente étant d’un produit
important* il a été rendu grand nombre de
règlemens pour en empêcher la fraude * & en af-
furer la perception. Tels font les arrêts & lettres-
patentes du 4 feptembre 17 24 , les arrêts & lettres
du 21 juillet 1739. Ces derniers défendent de voi-
turer ni tranfporter aucuns vins, eaux-de-vie &
autres marchandifes de la province de Saintonge ,■
fur les ports & achenaux des rivières de Seudre
& Gironde , dans la dépendance des bureaux de
la traite de Charente 3 fans auparavant en avoir
fait déclaration aux bureaux d'où- dépendent ces
ports & achenaux 3 & y avoir pris des congés
ou acquits*
Les principaux privilèges concernant la traite
de Charente, & qui en accordent l'exemption ,
regardent le gouvernement de Brouage, la ville
• de Rochefort & l’abbaye de Notre-Dame de
Xaintes.
Le gouvernement de Brouage, appellé auffi pays
abonné de Marennes , eft cômpofé de vingt-huit
pàroiiTes , auxquelles les- lettres-patentés des 15
décembre 1542. & décembre 1643, accordent
l ’affranchiffement des droits d’aides & de ceux de
la traite de Charente 3 fur toutes efpèces de denrées
& marchandifes 3 à l’exception des fels, au
moyen d’une fomme annuelle payée par forme
d’abonnement 3 & en confidération de ce que les
habitans compofoient un corps de milice chargé
de la garde de leurs côtes. : ■'
En 1666 3 une conteftation s’étant élevée au
fujet de ces privilèges^ l’intendant de la province
la termina l’année fuivante par une convention
paffée avec le fermier de la traite de Charente re-
préfenté par fon dire&eur. G ’eft cette tranfa&ion
quia depuis toujours fervi déréglé. lien réfulte*
que toutes les .marchandifes & denrées v paftànt
de la Saintonge dans l’étendue de l’abonné de
Marennes pour la confommation du pays 3 font
exemptes - des droits de la traite de Charente, 4
l ’exception des fe ls , bois de charpente ,. tins te
eaux-de-vie.
Que les vins , eaux de- vie 3c vinaigres, fortant
de l’étendue de l’abonné, pour la Saintonge, font
exempts de tous droits, ainfi que toute autre
efpèce de denrées & marchandifes , foit originaires
de l’abonné , foit étrangères , pourvu
qu’elles foient en parties d’un poids audeffous de
cent livres : au-delà de ce poids elles font fujettes
aux droits ordinaires.
La ville de Rochefort, qui eft un port deftiné
aux Vaiffeaux de roi, & fait partie de la généralité
de la Rochelle , comprife dans les cinq groffes-
fermes , a été diftraite par les lettres-patentes du
mois de mars 1669, de l’étendue du tarif.de
1664, pour être placée dans la Saintonge j elles
lui accordent en mêpre tems l’exemption* tant
des droits de la traite de Charente * que de ceux
de fortie des cinq groffes-fermes, fur les comef-
tibles de toute efpèce deftiiiés pour la confommation
des habitans, fur les bois à bâtir, fur
les planches , pierres* fe rs , briques, & autres
matériaux propres à la conftruétion des maifons
& des navires ; mais fi ces objets paffent de Rochefort
dans la Saintonge , ceux qui font venus
des provinces réputées étrangères, doivent les
droits de la traite de Charente , 3c ceux qui font
venus de cinq groffes- fermes , doivent de plus
les droits de fortie du tarif de 1664 , dont la
la deftination privilégiée de Rochefort les avoit
affranchis.
Touée autre efpèce de marchandife que dei
comeftibles, venant par mer à Rochefort, payé
les droits de la traite de Charente , à raifon de
cinq pour cent de la valeur j de même tout ce
qui fort de la même ville par eau, pour toute
autre deftination que la Saintonge, eft fujet aux
droits de traite de Charente.
Au moyen de ce que les denrées & marchandifes
apportées à Rochefort rie jouifient de l’af>-
frane.hifiement des droits que fous la- condition
d’être confommées par les habitans, elles deviennent
fujettes aux droits quand elles font portées
dans les magafins du «roi pour les armemens
de les vaiffeaux. Chaque année, il eft pris des
arrangemens pour affurer au fermier l’indemnité
du montant des droits- qu’il eft fondé à réclamer.
Quant au privilège de l’abbaye de Notre-Dame
de Xaintes , il donne à l’abbeffe le droit de faire
venir des marais fàlans qui appartiennent à cette
maifon, trois muids de fel pour la confommation
de fa communauté, en les faifant accompagner
de fon certificat, qui juftifie de la deftination.
Le produit du droit de la traite de Chdrente y
tant fur les fels que fur les vins, eaux-de-vie &
autres marchandifes, étoit» avant 1785 j d’environ
feize à dix-huit cents mille livres , non
Compris les dix fous pour livre. Il eft probable
eue la loi bienfaifante qui a fuppnme, en 1784 ,
les droits de fortie du royaume fur toutes les
eaux-de-vie qui font exportées, aura caule quelque
diminution dans la 'traite de Charente. Voyez
je mot Ea u -de-v ie , tom. 2 , pag* 7-
T R A IT E D O M A N IA L E , f. f- Nom d’un
droit, de fortie qui a lieu par tout le royaume fur
certaines efpèces de marchandifes & denrees.
Comme dans la langue ftfcale on 1 appelle hmple-
ment domaniale. il. èn a été parlé fous ce mot.
. Voyei le tome premier, pag., é i i .
Indépendamment de ce droit général, il en
eft un particulier connu fous le nom de traite do'-
maniale de Bretagne.
1 C ’eft une impofition dont on ne connoît pas
la date. Ori croit quelle a été établie par lesanr
ciens fouverains de la Bretagne fur toutes, les
marchandifes, fortant de la province , . tant par
eau que; par terre.
C e droit fe diftingue par deux noms analogues
aux objets fur lefquels il a lieu. On appelle traite
vive celui qui fe perçoit fur les beftiaux dans le
| comté de Nantes. Les droits en font fixés par
une pancarte de 1536. Après avoir été aliénés en
1723 , ils font rentrés dans la main du roi en
1768, & ont fait partie des droits domaniaux
jufqu’eri 1780 , qu’ils ont été réunis à h y fe p ie
générale. Suivant l’arrêt du confeil du 30 juin
1 7 3 3 , les beftiaux & les grains, qiioiqu’exempts
de tous droits de 'traites z leur circulation dans
le royaume, n’en doivent pas moins les droits
de la traite vive de Nantes, parce que ces droits
font domaniaux.
La fécondé dénomination que reçoit la traite
domaniale de Bretagne, : eft celle de traite morte ,
parce qu’elle fe perçoit fur toutes les efpèces
de marchandifes qui fortentde la province.
Le tarif de ce dernier droit eft de i j u , &
très-étendu. Sa bafe paroît être le trentième de
la valeur que les marchandifes avoient alors- Le
tarif fe trouve imprimé avec ceux de la prévôté
de Nantes & des devoirs, dans un volume
in - 12 , publié à Nantes, en 1729*■ par Nicolas
.Verger.
La traite morte fe fubdiyife encore en traite
par eau 3c traite par mer * indépendamment de
la traite par terre.
La première eft celle qui fe lève fur ce qui Remonte
la Loire.
La fécondé fe percevoit fyr ce qui fortoit par
mer} elle a fait partie des droits domaniaux engagés
en 1739 aux États de la province. Pendant
cette aliénation , le parlement de Rennes a fup-
primé en 1762 la traite par mer, comme oné-
reufe au commerce ; en forte que lorfque le roi
eft rentré, en 1 7 7 1 , dans fes domaines de Bretagne
, le droit- de triiite put mer, qui ne fe percevoit
plus , n’ à pas été rétabli ; mais on conçoit
aifément que'cette fuppreftion ne peut être
validée que par un édit ou une déclaration
dùement enregiftrée î car fans cette loi émanée
dû Souverain, les parlemens pourroient, à leur
gré , réduire, aliéner & anéantir le . domaine de
la couronne, que cependant ils tiennent pour
inaliénable.'
La traite pat eau, c’eft-à-dire fur la Loire, a
été aliénée en 1720 , & .elle eft paffée à M., le
duc de Fitzjames & à madame de Talleyranti, qui
en jouiffent encore , -ou leurs répréfentans.. jj
A l’ égard de la traite par terre, comme elle
eft établie à toutes les extrémités de la Bretagne,
fa. perception a été aliénée pat diftriéts. Celle de
Dinan a-été engagée à M. le comte de Tou loufe ,
qui l’ a tranfmife à M. le duc. de Penthièvre à
qui la traite de Fougères a aufli été aliénée.
Les autres portions de ce droit.font reliées au
r o i , & elles ont fuïvi le fort de la traite vive
de Nantes. , avec laquelle elles font entrées dans
le bail des fermes fait en 1780., IVycç le tome
premier, page 76.
Parmi les droits de la traite domaniale de Bretagne
, on comprend ceux de ihéàgè & ;rébil!6L
tage qui font dûs, les premiers-,'fur lë s fe ls ',
les bleds & les vins , & toutes efpèces de mar1-
chandifeS', dûs par méage' du mefurage. Les autres
appelles rebillotage d’ ingrande , -fontTm
droit de fortie dû fur les marchandifes q u i, > en
remontant la Loire , n’ont pas acquitté les droits
de la traite domaniale dans. Uinter valle .de Nantes
à Ingrànde. C ’ ëft le teceveut des .fermés, d e ,ce
lieu qui en . fait" la perception, dont, l’objet; ètt
modique. " - : ; . . itI ■ .g ll0; : i
' T R A IT E F O R A IN E , f.' f. Nom d’ un droit
qui fe le voie anciennement fiïr toutes lés frontières
du royaume . & qui a été fondu dans le
tarif de 1664. Voyt\ ce'qui“ en; a été .dit'fous le
;mot Foraine , tom. 11, jgàgii^j. .
T R A IT E P A R T E R R E ..( droit de.fOn a ob-
fervé, au mot Fo r a in e , ijûe ce dr;oit elVpûîfi
cppnu fousde nom d’impofition foraine d’Anjoii,
& ob a annoncé que l’on en traiteroit fous le mot
de T raite, j
Le droit de traite par terre, fuivant M. de For-
bonnail, ians'fcs. Rtcherches b Confdbatiàns .fur
Us finances , tom. I I , uî-'h . pag. ' is.b , fut établi
, pat Philîppe-AuguÇe en 1204, aprèflû tmnquete
’ " X ï z z i) ~