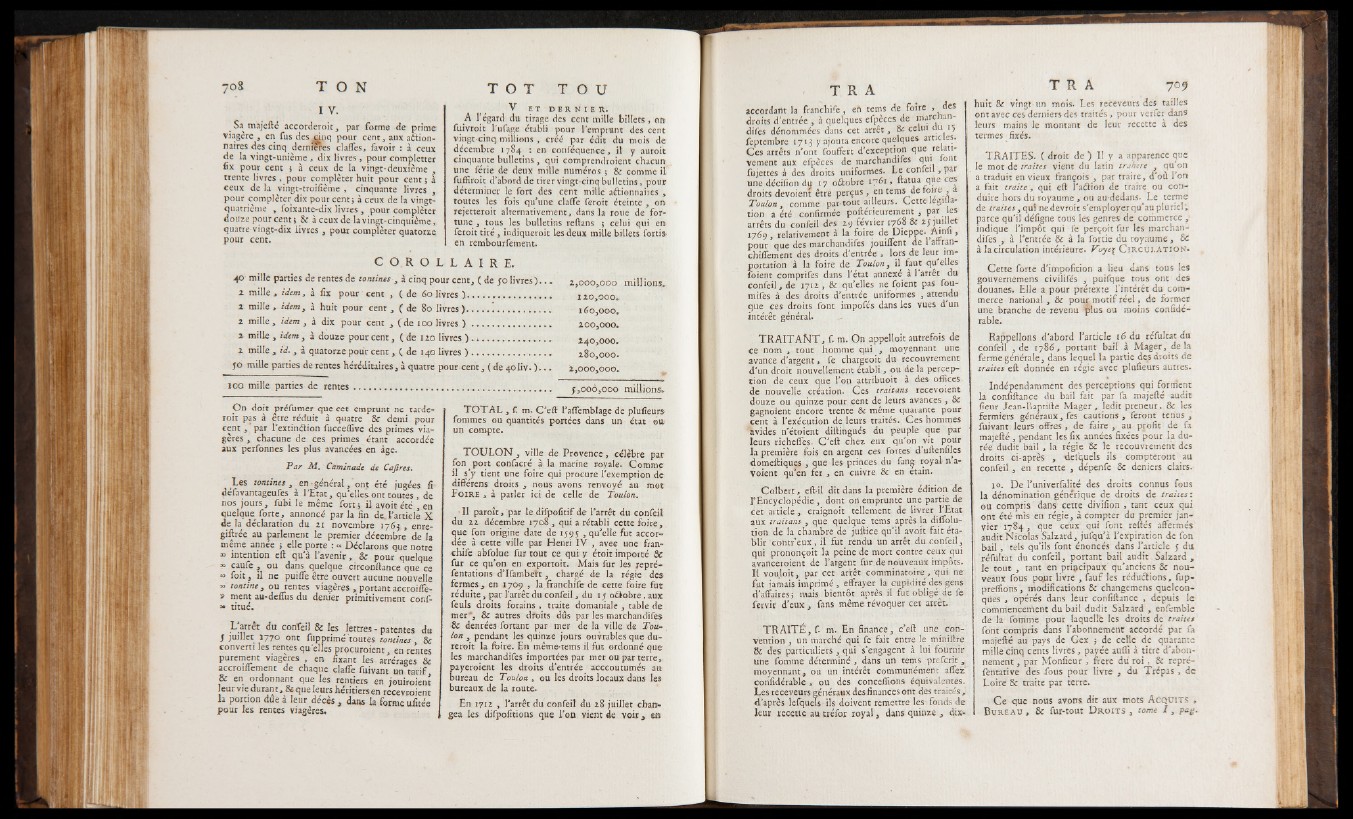
7 0 8 T O N T O T T O U
i y .
Sa^ majefté accorderoit , par forme de prime
viagère , en fus des ^ i q pour cent , aux aéfcion-
naires des cinq dernieles dafTes, favoir : à ceux
de la vingt-unième , dix livres, pour completter
fix pour cent j à ceux de la vingt-deuxième y
trente livres , pour compléter huit pour cent j à
ceux de la vingt-troifième , cinquante livres ,
pour compléter dix pourcent} a ceux de la vingt-
quatrième , foixante-dix livres , pour compléter
douze pour cent j & à ceux de la vingt-cinquième,
quatre-vingt-dix livres , pour compléter quatorze
pour cent.
V ET D E R N I E R .
A l’égard du tirage des cent mille billets, on
fuivroit l'ufage établi pour l'emprunt des cent
vingt-cinq millions , créé par édit du mois de
décembre 1784 : en conféquenee, il y auroit
cinquante bulletins, qui comprendroient chacun
une férié de deux mille numéros } & comme il
fuffiroit d’abord de tirer vingt-cinq bulletins, pour
déterminer le fort des cent mille a&ionnaires ,
toutes les fois qu’une clafle feroit éteinte , on
rejetteroit alternativement, dans la roue de fortune
3 tous les bulletins reftans j celui qui en
feroit tiré , indiqueroit les deux mille billets fortis
en rembourfement.
C O R O L L A I R E .
40 mille parties de rentes de tontines-, à cinq pour cent, ( de 50 liv r e s ) ... 2,000,000 millions. 1 m ille , idem, à fix pour cent , (d e 6 0 liv r e s ) .................................... 120,000.
1 mille, idem, à huit pour cent , ( d e 80 livre s)......... ’. ........................ 160,000.
2 mille, idem , à dix pour cent , (d e io olivres ) ............. 200,000.
2 mille, idem, à douze pourcent, ( de 120 livres ) .................................. 240,000.
2 mille , i d . , i quatorze pour cent, ( de 140 livres ) ...... ........................... 280,000.
50 mille parties de rentes héréditaires , à quatre pour cent, ( de 40 liv. ) . . . i , 000,000.
100 mille parties de rentes..................................................................................... $,000,000 millions.
On doit préfumer que cet emprunt ne tarde“
toit pas à être réduit à quatre & demi pour
cent , ’ par l'extinélion fucceifive des primes viagères
, chacune de ces primes étant accordée
aux perfonnes les plus avancées en âge.
Par M, Caminade de Cafires.
Les tontines , en-général, ' ont été jugées fi
défavantageures à l'E ta t, qu’elles ont toutes, de
nos jours , fubi le même fort ; il avoir été en
quelque forte, annoncé par la fin de. l’article X
d e là déclaration du 21 novembre 17 6 4 , enre-
giftrée au parlement le premier décembre de la
meme annee j elle porte : « Déclarons que notre
13 intention eft qu’à l’avenir, & pour quelque
» cairfe , ou dans quelque circonllance que ce
» fo it , il ne puifle être ouvert aucune nouvelle
” tontine, ou rentes viagères , portant accroiffe-
» ment au-deffus du denier primitivement conf-
» titué.
L ’arrêt du confeil & les lettres - patentes du
ƒ juillet 1770 ont fupprimé toutes tontines &
converti les rentes qu'elles procuraient en rentes
purement viagères , en fixant les arrérages &
accromement de chaque clafîe fuivant un tarif
& en ordonnant que les rentiers en jouiraient
leur vie durant, & que leurs héritiers en recevraient
la portion dde à leur décès , dans la forme ufitée
pour les rentes viagères«
T O T A L , f. m. C ’eft l’ affemblage de plufîeurs
fommes ou quantités portées dans un état dm
un com-pte.
T O U L O N , ville de Provence, célèbre par
fon port confacré à la marine royale. Comme
il s’y tient une foire qui procure l’exemption de
différens droits , nous avons renvoyé au mot
F oire , à parler ici de celle de Toulon.
’ Il paroît, par le drfpofitif de l’arrêt du confeil
du 21 décembre 1708, qui a rétabli cette foire,
que fon origine date de 1595 , qu’elle fut accordée
à cette ville par Henri IV , avec une fran-
chife abfolue fur tout ce qui y étoit importé &
fur ce qu’on en exportoit. Mais fur les repré-
fentations d’Ifambett, chargé de la régie des
fermes, en 1709 , la.franchife de cette foire fut
réduite, par l’arrêt du confeil, du 1 y o&obre, aux
feuls droits forains , traite domaniale , table de
mer*, & autres droits dûs par les marchandifes
& denrées fortant par mer de la ville de Toulon
, pendant les quinze jours ouvrables que du-
reroit la foire. En même-tems il fut ordonné que
les marchandifes importées par mer ou par terre,
payeroient les droits d’entrée acccoutumés an
bureau de Toulon , ou les droits locaux dans les
bureaux de la route*
En 1712 , l’arrêt du confeil du 28 juillet changea
les difpoiîtions que l’on vient de v o ir , m
T R A
accordant la franchife, eft teens de foire » 1des
droits d’entrée , à quelques efpèces de marenan-
difes dénommées dans cet arrêt, & celui du 15
feptembre 1713 y ajouta encore quelques articles.
Ces arrêts n’ont fouffert d’exception que relativement
aux efpèces de marchandifes qüi lont
fujettes à des droits uniformes. Le confeil, par
une décifion du 17 octobre 1761» ftatua que ces
droits dévoient être perçus, en tems de foire , a
Toulon 3 comme par tout ailleurs. Cette legilla-
tion a été confirmée pofterieurement, par les
arrêts du confeil des 29 février 1768 & MI«11“ *
1769, relativement à la foire de Dieppe. A in ii,
pour que des marchandifes jouiffent de 1 anran-
chiffement des droits d’entrée , lors de leur importation
à la foire de Toulon, il faut qu elles
foient comprifes dans l’état annexé à 1 arrêt du
confeil, de 1712 , & qu’ elles ne foient pas fou-
mifes à des droits d’entrée^ uniformes , attendu
que ces droits font impofés dans les vues d un
T R A 709
huit & vingt- un mois. Les receveurs des tailles
ont avec ces derniers des traités, pour verfer dans
leurs mains le montant de leur recette à des
termes • fixés.
TR A IT E S . ( droit de ) Il y a apparence que
le mot de traites vient du latin trahere , qu’on
a traduit envieux françois , par traire, d’où l’on
a fait traite, qui eft l’aétion de traire ou conduire
hors du royaume , ou au-dedans. Le terme
de traites 3 qui nedevroiu s’employer qu’ au pluriel*,
parce qu’il défigne tous les genres de commerce ,■
indique l’impôt qui fe perçoit fur les marchandifes
, à l’entrée & à la fortie du royaume, &
à la circulation intérieure. Voye-{ C ir c u l a t io n .
Cette forte d’impofition a lieu dans tous les
gouvernemens civilifés , puifque tous ont des
douanes. Elle a pour prétexte l’intérêt du commerce
national, & pour motif ré e l, de former
une branche de revenu plus ou moins confidé-
rable.
T R A I T A N T , f. m. On appelloit autrefois de
ce nom , tout homme qui , moyennant une
avance d’argent, fe chargeoit du recouvrement
d’un droit nouvellement établi, ou de la perception
de ceux que l’on attribuoit à des offices
de nouvelle création. Ces traitons recevoient
douze ou quinze pour cent de leurs avances, &
gagnoient encore trente & même quarante pour
cent à l’exécution de leurs traités. Ces hommes
avides rietoient diftingués du peuple que par
leurs richeffes. C ’eft chez eux qu’on vit pour
la première fois en argent ces fortes d’uftenfiles
domeftiques , que les princes du fang royal n a-
voient qu’en fer , en cuivre & en étain.
C o lb e r t, eft-il dit dans la première édition de
l’Encyclopédie, dont on emprunte une partie de
cet article, craignoit tellement de livrer l’Etat
aux traitons , que quelque tems après la diffolu-
tierfl. de la chambre de juftice qu’il avoit fait établir
contr’eux, il fut rendu un arrêt duxonfeil,
qui prononçoit la peine de mort contre ceux qui
ayanceroient de l’argent fur de nouveaux impôts.
Il vouloit, par cet arrêt comminatoire, ‘qui ne
fut jamais imprimé, effrayer la cupidité des gens
d’affaires j mais bientôt après il fut obligé de fe
fervir d’eux , fans même révoquer cet arrêt.
T R A I T É , f. m. En finance, c’eft une convention
, un marché qui fe fait entre le miniftre
& des particuliers , qui s’engagent à lui fournir
une fomme déterminé, dans un tems preferit,
moyennant, ou un intérêt communément affez
confidérable, ou des concédions équivalentes.
Les receveurs généraux des finances ont des traités ,
d'après lefquels ils doivent remettre les fonds de
leur recette au tréfor royal, dans quinze , dix-
Rappellons d’abord l’article 16 du réfultat du
confeil , de 1786, portant bail à Mager, d elà
ferme générale, dans lequel la partie des droits de
traites eft donnée en régie avec plufieurs autres.
Indépendamment des perceptions qui forment
la connftance du bail fait par fa majefté audit
fieur Jean-Baptifte Mager , ledit preneur, & les
fermiers généraux, fes cautions , feront tenus,
fuivant leurs offres, de faire , au profit de fa
majefté, pendant les fix années fixées pour la durée
dudit bail , la régie & le recouvrement des
droits ci-après , delquels ils compteront au
confeil, en recette , dépenfe & deniers clairs.
10. De l’univerfalité des droits connus fous
la dénomination générique de droits de traites :
ou compris dans cette divifion , tant ceux qui
ont été mis en régie, à compter du premier janvier
1784 , que ceux qui font reliés affermés
audit Nicolas Salzard, jufqu’ à l’expiration de fon
b a il, tels qu’ils font énoncés dans l’article 5 du
réfultat du confeil, portant bail audit Salzard,
le tout , tant en principaux qu’anciens & nouveaux
fous potur livre , fauf les réductions, fup-
preflions, modifications & changemens quelconques
, opérés dans leur confiftance , depuis le
commencement du bail dudit Salzard , enfemble
de la fomme pour laquelle les droits de traites
font compris dans l’abonnement accordé par fa
majefté au pays de Gex } de celle de quarante
mille cinq cents livres, payée aufti à titre d’ abonnement
, par Monfieur , frere du r o i , & repré-
fentative des fous pour livre , du Trépas , de
Loire & traite par terre.
C e que nous avons dit aux mots A cqu its ,
Bu r e au , & fur-tout D r o it s , tome I , pag*