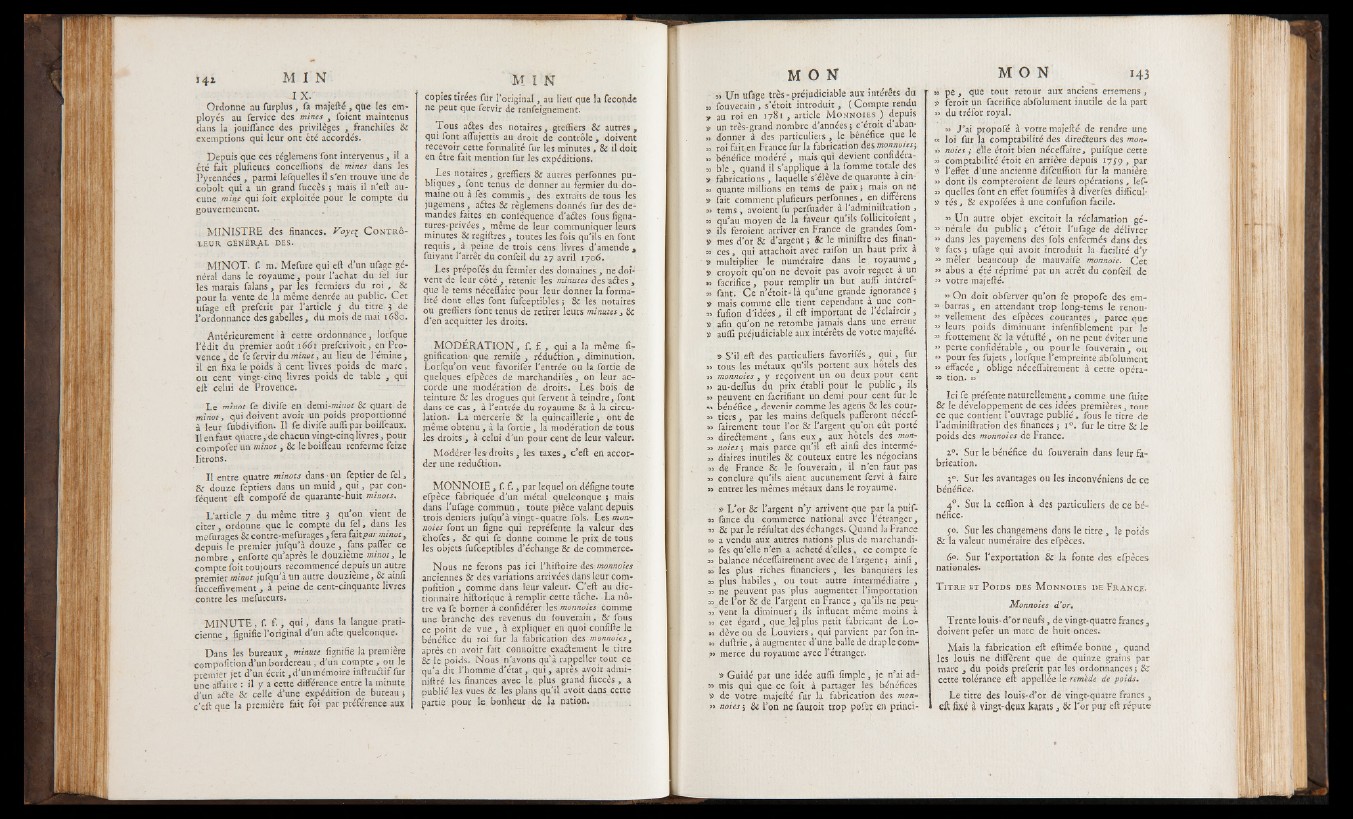
i4i MIN
I X . '
Ordonne au furplus, fa majefté , qùe les employés
au fervice des mines , foient maintenus
dans la jouiffance des privilèges , franchifes 8c
exemptions qui leur ont été accordés.
Depuis que ces réglemens font intervenus , il a
été fait plufieurs concédions de mines dans les
Pyrennées , parmi lefquellesil s'en trouve une de
cobolt qui a un grand fuccès i màis il n’ eft aucune
mine qui foit exploitée pour le compte du
gouvernement.
M IN IS TR E des finances. Voy e^ C o n t r ô l
e u r . G É N É R A L D E S .
M IN O T . f. m. Mefure qui eft d’ un ufage général
dans le royaume, pour l’achat du fel fur
les marais falans, par les fermiers du roi , &
pour la vente de la même denrée au public. C e t
ufage eft preferit par l’article 5 du titre 3 de
l’ordonnance des gabelles, du mois de mai 168p.
Antérieurement à cette ordonnance, lorfque
l’édit du premier août 1661 preferivoit, en Provence
, de fe fervir du minât, au lieu de l'émine,
il en fixa le poids à cent livres poids de marc,
ou cent vingt* cinq livres poids de table , qui
eft celui de Provence.
Le minot fe divife en demi-minot 8c quart de
jninot 3 qui doivent avoir un poids proportionné
à leur fubdivifion. Il fe divife auffi par boiffeaux.
Il en faut quatre, de chacun vingt-cinq livres, pour
compofer un minot , 8c le boineau renferme feize
litrons.
Il entre quatre minots dans - un feptier de fe l,
& douze feptiers dans un muid, q u i, par con-
féquent eft compofé de quarante-huit minots.
L ’article 7 du même titre 3 qu’on vient de
c ite r , ordonne que le compte du fe l, dans les
mefurages 8c contre-mefurages , fera fait par minot,
depuis le premier jufqu’ à douze , fans paffer ce
nombre , enforte qu’après le douzième minot 9 le
compte foit toujours recommencé depuis un autre
premier minot jufqu’àün autre douzième, & ainfi
fucceffivement , à peine de cent-cinquante livres
contre les mefureurs.
M IN U T E , f. f . , q u i, dans la langue praticienne
, .lignifie l’original d’un aéte quelconque.
Dans les bureaux, minute lignifie la première
compofition d’un bordereau, d’un compte , ou le
premier jet d’un écrit, d’ un mémoire inftru&if fur
une affaire : il y a cette différence^ entre la minute
d'un a<fte 8c celle d’une expédition de bureau 3
c'eft que la première fait foi par préférence aux ,
M I N
copies tirées fur l ’original, au lieu que la fécondé
ne peut que fervir de renfeignement.
Tous a&es des notaires, greffiers & autres,
qui font affujettis au droit de contrôle, doivent
recevoir cette formalité fur les minutes, & il doit
en être fait mention fur les expéditions.
Les notaires, greffiers 8c autres perfonnes publiques
, .font tenus de donner au fermier du domaine
ou à fes commis, des extraits de tous les
jugemens, aéies & réglemens donnés fur des demandes
faites en conléquence d’aéles fous figna-
tures-privées, même de leur communiquer leurs
minutes 8c regiftres , toutes les fois qu’ils en font
requis, à peine de trois cens livres d’amende ,
fuivant l’arrêt du confeil du 17 avril 1706.
Les prépofés du fermier des domaines, ne doivent
de leur côté , retenir les minutes des -aéfces ,
que le tems néceffaire pour leur donner la formalité
dont elles font fufceptibles ; 8c les notaires
ou greffiers font tenus de retirer leurs minutes, 8c
d’en acquitter les droits.
M O D É R A T IO N , f. £ , qui a la même lignification
que remife , réduction, diminution.
Lorfqu’on veut favorifer l’entrée ou la fortie de
quelques efpècès de marchandifes, on leur accorde
une modération de droits. Les bois de
teinture & les drogues qui fervent à teindre, font
dans ce cas , à l’entrée du royaume & à la circulation.
La mercerie 8c la quincaillerie, ont de
même obtenu, à la fortie, la modération de tous
les droits , à celui d'un pour cent de leur valeur.
Modérer lesrdroits, les taxes, c’eft en accorder
une réduction.
M O N N O IE , f f . , par lequel on défigne toute
efpèce fabriquée d’un métal quelconque $ mais
dans l’ ufage commun, toute pièce valant depuis
trois deniers jufqu’à vingt-quatre fols. Les mon-
noies font un ligne qui repréfente la valeur des
fchofes , 8c qui fe donne comme le prix de tous
les objets fufceptibles d’ échange & de commerce*
Nous ne ferons pas ici l’hiftoire des monnoies
anciennes & des variations arrivées dans leur compofition
, comme dans leur valeur. C ’eft au dictionnaire
hiftorique à remplir cette tâche. La nôtre
va fe borner à confidérer les monnoies comme
une branche des revenus du fouverain, & fous
ce point de vue , à expliquer en quoi confifte le
bénéfice du roi fur la fabrication des monnoies,
après en avoir fait connoître exactement le titre
8c Je poids. Nous n’avons qu’à rappeller tout ce
qu’ a dit l’homme d’éta t, q u i, après avoir admr-
niftré les finances avec le plus grand fuccès, a
publié les vues & les plans qu’ il avoit dans cette
partie pour le bonheur de la nation.
M O N
3, Un ufage très - préjudiciable aux intérêts du
as fouverain , s’étoit introduit, ( Compte rendu
y au roi en 1781 , article Monnoies ) depuis
» un très-grand nombre d’années ; c'étoit d’aban-
3j donner à des particuliers, le bénéfice que le
s? roi faffen France fur la fabrication des monnoies^
33 bénéfice modéré , mais qui devient confidera-
33 ble , quand il s’applique à la fommè totale des
» fabrications,. laquelle s’élève de quarante a cin-
» quante millions en tems de paix > mais on ne
» fait comment plufieurs perfonnes, en differens
33 tems, avoient fu perfuader a 1 adminiftration ,
33 qu’au moyen de la faveur qu ils follicitoient,
$ ils feroient arriver en France de grandes fom-
» mes d’or 8c d’argent ; 8c le miniftre des finan-
« ce s , qui attachoit avec raifon un haut prix a
v multiplier le numéraire dans le royaume,
^ croyoit qu’on ne devoit pas avoir regret à un
»» facrifice, pour remplir un but auffi intéref-
33 fant. C e n’étoit-là qu’une grande ignorance ;
•» mais comme elle tient cependant a une conas
fufîon d’idées, il eft important de l’éclaircir,
» afin qu’on ne retombe jamais dans une erreur
» auffi préjudiciable aux intérêts de votre majefté.
» S’il eft des particuliers favorifés, cjui, fur
33 tous les métaux qu’ils portent aux hôtels des
33 monnoies , y reçoivent un ou deux pour cent
33 au-deffus du prix établi pour le public, ils
33 peuvent en facrifiant un demi pour cent fur le
33 bénéfice, devenir comme les agens 8c les cour-
33 tiers, par les mains defquels pafferont nécef-
33 fairement tout l’or 8c l’argent qu’on eût porté
33 dire&ement, fans eux , aux hôtels des mon-
33 noies-3 mais parce qu’il eft ainfi des mtermé-
33 diaires inutiles & coûteux entre les négocians
33 de France & le fouverain, il n’en faut pas
33 conclure qu’ ils aient aucunement fervi à faire
33 entrer les mêmes métaux dans le royaume.
» L ’or 8c l’argent n’y arrivent que par la puif-
33 fance du commerce national avec l’étranger,
33 & par le réfultat des échanges. Quand la France
33 a vendu aux autres nations plus de marchandi-
33 fes qu’elle n’en a acheté d’elles,, ce compte fe
33 balance néceffairement avec de l ’argent ; ainfi ,
33 les plus riches financiers, les banquiers les
33 plus habiles x ou tout autre intermédiaire ,
33 ne peuvent pas plus augmenter l’importation
33 ,de l’or 8c de l’argent en France, qu’ ils ne peu-
33 vent la diminue^; ils influent même moins à
33 cet égard, q uejel plus petit fabricant de Lo-
33 dève ou de Louviers, qui parvient par fon in-
33 duftrie, à augmenter d’une balle de drap le com-
33 merce du royaume avec l’étranger.
» Guidé par une idée auffi fimple, je n’ ai ad-
»3 mis qui que ce foit à partager les bénéfices
» de votre majefté fur la . fabrication des mon-
3» noies 5 8c l’ on ne fauroit trop pof^t en princi-
M O N 143
as p e , que tout retour aux anciens erremens,
» feroit un facrifice abfolument inutile de la part
33 du tréfor royal.
33 J’ai propofé à votre majefté de rendre une
ce loi fur la comptabilité des directeurs des mon-
33 noies ; elle étoit bien néceffaire, puifque cette
33 comptabilité étoit en arrière depuis 17 5 9 , par
» l’effet d’une ancienne difeuffion fur la manière
33 dont ils compteroient de leurs opérations, lef*
33 quelles font en effet foumifes à diverfes difficul-
» té s , & expofées à une confufion facile.
33 Un autre objet excitoit la réclamation gé-
» nérale du public ; c’étoit l’ufage de délivrer
» dans les payemens des fols enfermés dans des
» facs ; ufage qui avoit introduit la facilité d’y
59 mêler beaucoup de mauvaife monnoie. C e t
99 abus a été réprimé par un arrêt du confeil de
99 votre majefté.
99 On doit obferver qu’on fe propofe des em-
99 barras, en attendant trop long-tems le renou-
99 vellement des efpèces courantes , parce que
99 leurs poids diminuant infenfiblement par le
99 frottement & la vétufté, on ne peut éviter une
99 perte confidérable , ou pour le fouverain, ou
99 pour fes fujets , lorfque l’empreinte abfolument
99 effacée, oblige néceffairement à cette opérat
i o n . «
Ici fe préfente naturellement, comme une fuite
8c le développement de ces idées premières, tout
ce que contient l’ouvrage publié, fous le titre de
l’adminiftration des finances ; i° . fur le titre & le
poids des monnoies de France.
i ° . Sur le bénéfice du fouverain dans leur fabrication.
30. Sur les avantages ou les inconvéniens de ce
bénéfice.
4°. Sur la ceffion à des particuliers de ce bénéfice.
50. Sur les changemens dans le titre, le poids
8c la valeur numéraire des efpèces.
60. Sur l’exportation 8c la fonte des efpèces
nationales.
T itre et Poids des M onnoies de France.
Monnoies d’or.
Trente louis-d’or neufs, de vingt-quatre francs ,
doivent pefer un marc de huit onces.
Mais la fabrication eft eftiméo bonne, quand
les louis ne diffèrent que de quinze grains par
marc , du poids preferit par les ordonnances ; 8c
cette tolérance eft appellée le remède de poids.
Le titre des louis-d’or de vingt-quatre francs , eft fixé à Yingt-dewx karats, 8c Tor pur eft réputé