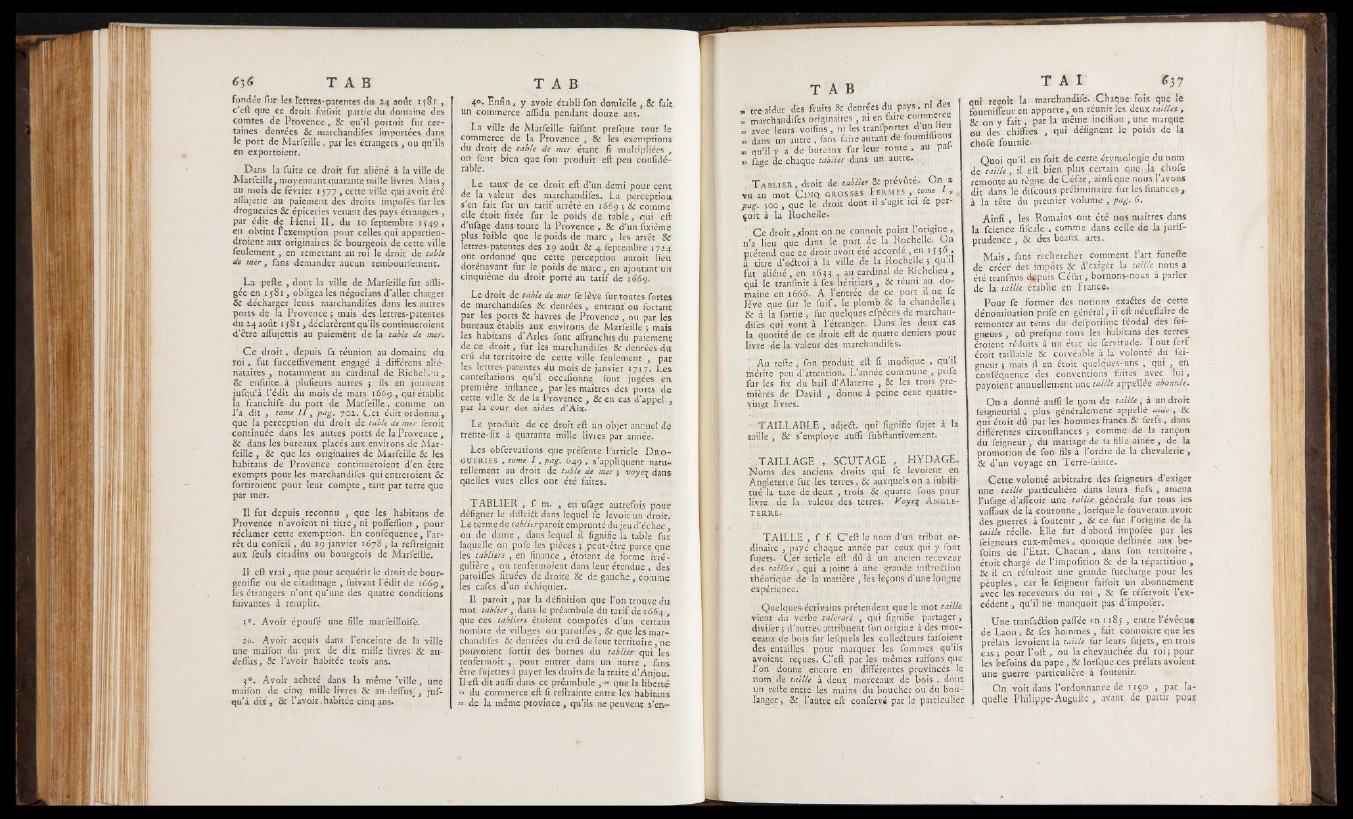
fondée fur les lettres-patentes du 14 août i ç & r ,
c ’eft que ee droit faifoit partie du domaine des
comtes de Provence r & qu'il portait fur certaines
denrées & marchandifes importées dans
le port de Marfeille, par les étrangers , ou qu’ils
en exportoienr.
Dans la fuite ce droit fut aliéné à la ville de
Marfeille,.moyennant quarante.mille livres. Mais*
au mois de février 15 7 7, cette ville qui a voit été
afiujetie au paiement des droits impofés fur les
drogueries & épiceries venant des pays étrangers ,
par édit de Henri II > du 10 feptembre 1 £49 »
en obtint 1 exemption, pour celles qui appartien-
droient aux originaires 8c bourgeois de cette ville
feulement , en remettant au roi le droit de table
de mer , fans demander aucun rembourlément.
L a pelle , dont la ville de Marfeille fut affligée
en .1 y 8 i , obligea les négocians d'aller charger
8c décharger leurs marchandifes dans les autres
ports de la Provence j mais des lettres-patentes
du 24 août 1 j 8 1 , déclarèrent qu’ils continueroient
d’être aflujettis au paiement de la table de mer.
C e d ro it, depuis fa réunion au domaine du
r o i , fut fucceffivement engagé à différens alié-
nàtaires , notamment au cardinal de Riche lvu*
& enfuite.à plufieurs autres j ils en jouirent
jufqu’à l'édit du mois de mars 1669, qui établit
la franchife du port de Marfeille, comme on
l ’a dit * tome I I x pag. 702. C et édit ordonna,
que la perception du droit de table de mer feroit
continuée dans les autres ports de la Provence ,
& dans les bureaux placés aux environs de Marfeille
* 8c que les originaires de Marfeille 8c les
habitans de Provence continueroient d'en être
exempts pour les marchandifes qui entreroient &
fortiroient pour leur compte, tant par terre que
par met.
Il fut depuis reconnu , que les habitans de
Provence n'avoient ni titre, ni poffeffion , pour
réclamer cette exemption. En conféquence, l'arrêt
du confeil, du 29 janvier 1678 , la reftreignit
aux feuls citadins ou bourgeois de Marfeille.
Il eft vrai, que pour acquérir le droit de bour-
geoifie ou de citadinage , fuivant l ’édit de 1669,
les étrangers 11'ont qu'une des quatre conditions
fuivantes à remplir.
1 9. Avoir époufé une fille marfeilloile.
20. Avoir acquis dans l’enceinte de la ville
une maifon du prix de dix mille livres & au-
deffus, 8c l'avoir habitée trois ans.
30. Avoir acheté dans la même'ville, une
maifon de cinq mille livres 8e au-defifus], jufqu’à
d ix , & l’avoir.habitée cinq ans.
4°. Enfin, y avoir établi fon domicile , 8e fait
un commerce affidu pendant douze ans.
La ville de Marfeille faifant prefque tout le
commerce de la Provence , 8e les exemptions
du droit de table de mer étant fi multipliées ,
on fent bien que fon produit eft peu confidé-
rable.
Le taux- de ce droit eft d'un demi pour cent
de la valeur des marchandifes. La perception
s’en fait fur un tarif arrêté en 1669 } 8e comme
elle étoit fixée fur le poids de table, qui eft
cfufage dans toute la Provence , 8e d’ un uxième
plus foible que le poids de marc , les arrêt 8e
lettres-patentes des 29 août 8e 4 feptembre 1724
ont ordonné que cette perception auroit lieu
dorénavant fur le poids de marc, en ajoutant un
cinquième du droit porté au tarif de 1669.
Le droit de table de mer fe lève fur toutes fortes
de marchandifes 8e denrées , entrant ou fortanc
par les ^o rts 8c havres de Provence , ou par les
bureaux établis aux environs de Marfeille * mais
les habitans d’Arles font affranchis du paiement
de ce droit , fur les marchandifes 8e denrées du
crû du territoire de cette ville feulement , par
les lettres-patentes du mois de janvier 1717. Les
conteflations qu’il occafioïine font jugées en
première inftance, par les maîtres des ports de
cette ville & de la Provence , & en cas d’appel ,
par la cour des aides d’Aix.
Le produit de ce droit eft un objet annuel de
trente-fîx à quarante mille livres par année.
Les obfervations que préfente l'article Drogueries
r tome I, pag. 649 , s’appliquent naturellement
au droit de table de mer 5 voyer dans
quelles vues elles ont été faites.
T A B L IER , f. m. , en ufage autrefois pour
défigner le diflriél dans lequel fe levoit un droit.
Le terme de tablitrpzïoit emprunté du jeu d’échec,
ou de dame, dans lequel il lignifie la table fur
laquelle on pofe les pièces j peut-être parce que
les tabliers , en finance , étoient de forme irrégulière
, ou renfermoient dans leur étendue , des
paroilfes fituées de droite 8c de gauche, comme
les cafés d’un échiquier.
Il paroît , par la définition que l’on trouve du
mot tablier , dans le préambule du tarif de 1664
que ces toçbiiers étoient compofés d’un certain
nombre de villages ou paroilfes, 8c que les marchandifes
& denrées du crû de leur territoire, ne
pouvoient fortir des bornes du : tablier qui les
renfermoit , pour entrer dans un autre , fans
être fujettes à payer les droits de la traite d'Anjou.
Il eft dit auffl dans ce p r é am b u le q u e la liberté
« du commerce eft fi reflrainte entre les habit-ans
« de la même province , qu'ils ne peuvent s'en-
, tre-aider des fruits Sc denrees du pays, m des
, marchandifes originaires * ni en faire
, avec leurs v o if in s n i les tranfportet d un Heu
> dans un autre , fans faire autant de foumiflions
3 qtfil y a de bureaux fur leur rou te, au pal-
. An ✓ -Vioni'w1» rabiLer dans un autre* .
T a b l ie r , droit d e tablier 8c prévôté.. On a
\u au mot C inq grosses Fermes , * ■ ..
pag. 500, que le droit dont il s agit ici fe perçoit
à la Rochelle.
C e droit, /dont .on ne connoît point l'origine ,
nra lieu que dans le port de ta Rochelle. Un
prétend que ce droit avoit été accorde , en 153“ »
a titre d’oétcoi à la ville de la RocheUe_ > qu il
fut aliéné, en 1633 , au cardinal de^ Richelieu ,
qui le tranfmit à fes héritiers , & réuni au domaine
en ï 666. A l'entrée de ce port il ne fe
Jèvé que fur le fuif, le plomb & la chandelle}
& à la fortie > fur quelques e'fpèces de marchandifes
qui vont à tl'étranger. Dans les deux cas
la quotité de ce droit efl de quatre deniers pour
livre de la valeur des marchandifes.
' Au relie , fon produit eft fi modique , qu’ il
mérite peu d’attention. L’année commune , prife
fur les fix du bail d’Alaterre , 8c les trois premières
de David , donne à peine cent quatre-
yingt livrés.
- T A IL L A B L E , adjèét. qui figpifie fujét à la
taille, & s’employe suffi fubflantivement.
g T A IL L A G E S CU T A G E , H YD A G E .
Noms des anciens droits qui fe levaient en
Angleterre fur les terres, 8c auxquels on a fubfli-
tûé la taxe de deux , trois & quatre fops pour
livre de. la valeur des terres. Voye[ A ngleterre.
T A IL L E , f. f. C'eft le nom d’un tribut ordinaire
, payé chaque année par ceux qui y font
fujets. C et article eft dû à un ancien receveur
des tailles , qui a joint à une grande inllruétron
théorique de la matière, lés leçons d’une longue
expérience.
Quelques écrivains prétendent que le mot taille
vient du verbe talerari , qui lignifie partager,
divifer ; d’autres-attribuent fon origine à des morceaux
de bois fur lefquels les collecteurs faifoient
des entailles pour marquer les fommes qu’ils
avoienc reçues. C ’ell par les .mêmçs raifons que
l’ on donne encore en différentes pro.vincés le
nom de taille à deux morceaux de bôis , dont
un relie entre les mains du boucher ou du boulanger
, 8c l’autre eft confervé par le particulier.
qui reçoit la marchandife.. Chaque fois que le
fourniffeur en apporte, on réunit les deux tailles ,
& on y f a i t , par la même incifion , une marque
ou des chiffres , qui défignerac le poids de la
chofe fournie.
Quoi qu’il en foit de cette étymologie du nom
de taille t il eft bien plus certain q u e ja chofe
remonte au règne de C é fa r , ainfique nous l’avons
dit dans le difeours préliminaire fur les finances,
à la tête du premier volume , pag. 6.
Ainfi , les Romains ont été nos maîtres dans
k fcience fifcale , comme dans celle de la jurisprudence
, 8t des beaux arts.
Mais, fans rechercher Comment l’art funefte
de créer des impôts & d'exiger la taille nous a
été tranfinis depuis C é fa r , bornons-nous à parler
de la taille établie en France.
Pour fe former des notions exactes de cette
dénomination prife en général, il eft néceffaire de
remonter au tems du defpotifme féodal des fei-
gneurs , où prefque tous les habitans des terres
étoient réduits à un état de fervitude. Tout fer f
étoit taillable 8c corvéable a la volonté du fei-
gneur } mais il en étoit quelques-uns , qui , en
conféquence des conventions faites avec hii',
pâyoient annuellement une taille appellée abonnée.
On a donné auffi le ^om de taille., a un droit
feigneurial , plus généralement appellé aide , &
qui étoit dû par les hommes francs &c Cerfs , dans
différentes circonftances > comme: de la rançon
du feigneur , du mariage de ià fille-aînée, de k
promotion de fon fils à l’ordre de la chevalerie ,
8c d’ un voyage en Terre-fainte.
Cette volonté arbitraire des feigneurs d’exiger
une taille particulière dans leurs . jfiefs , amena
l’ ufage d ’affeoir une taille générale fur tous les
vaffaux de la couronne, lorfquele fpuverain avoit
des guerres à foutenir, 8c ce fut l'origine de 1a
taille réelle. Elle fut d’abord impofée par les
feigneurs eux-mêmes, quoique dellinée aux be-
foins de l'Etat. Chacun , dans fon territoire ,
étoit chargé de l’impofition & de la répartition ,
& il en^réfultoit une grande furcharge pour les
peuples , car lé feigneur faifoit un abonnement
avec les receveurs du roi , 8c fe réfervoit l'excédent
, qu'il ne manquoit pas d'impofer.
Une tranfa&ion paffée en 1185 , entre l’évêçu«
de Laon, 8c fes hommes , fait connoître que les
prélats levoient la taille fur leurs^ fujets, en trois
cas } pour l’o l l , ou la chevauchée du roi} pour
les befoins du pape, & lorfque ces prélats avoient
j une guerre particulière à foutenir.
On voit dans l'ordonnance de 1190 , par laquelle
Philippe-Augufte , avant de partir poyj;