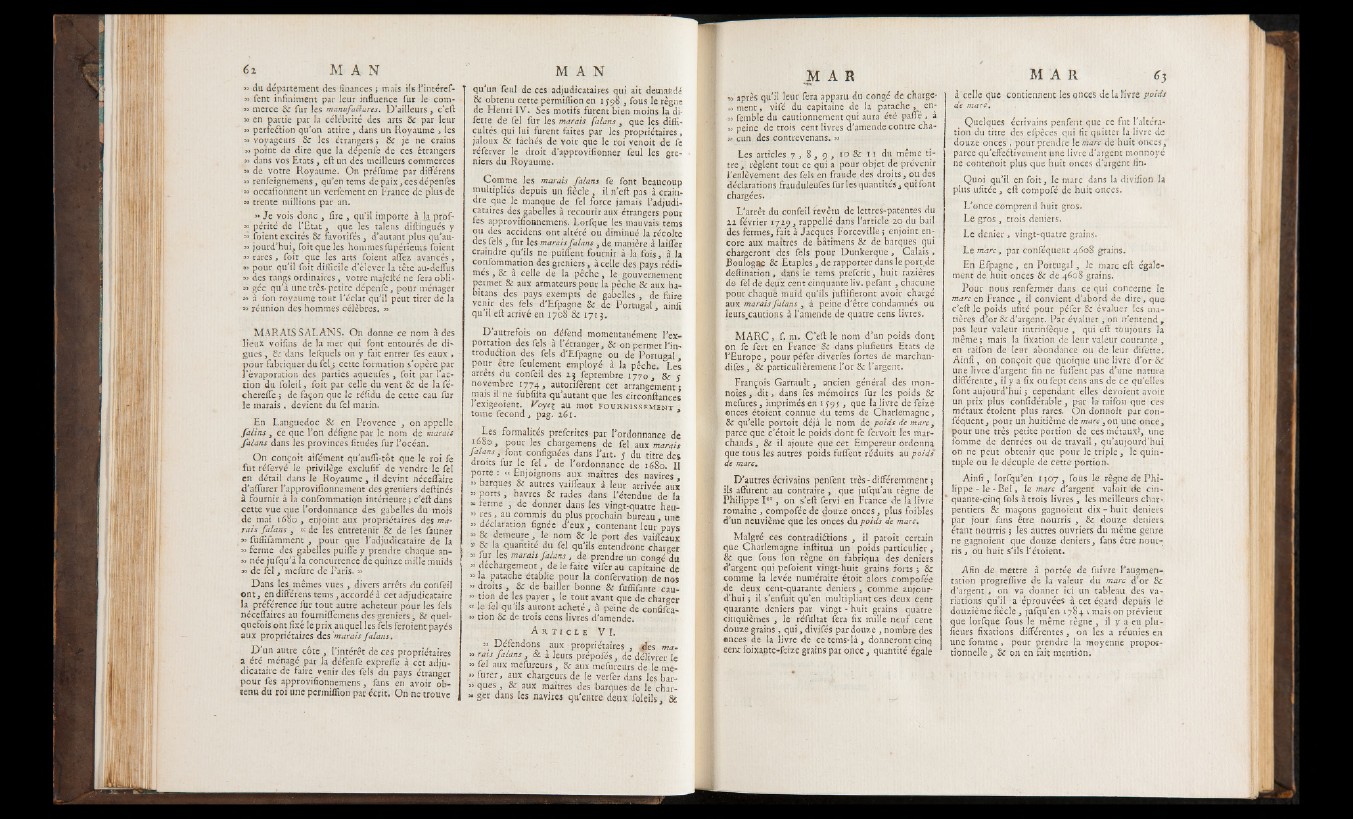
” du département des finances 5 mais ils l’intéref-
3» fent infiniment par leur influence fur le com-
»> merce & fur les manufactures. D ’ailleurs , c’eft
33 en partie par la célébrité des arts & par leur
« perreélion qu’on attire , dans un Royaume , les
y> voyageurs & les étrangers; & je ne crains
» point de dire que la dépenfe de ces étrangers
« dans vos Etats, eft un des meilleurs commerces
3» de votre Royaume. On préfuroe par différens
33 renfeignemens, qu’en tems depaix,cesdépenfes
33 occafionnent un verfement en France de plus de
3» trente millions par an.
3» Je vois donc , lire , qu’il importe à la prof-
33 périté de l’ E ta t, que les talens diftingués y
33 foient excités & favorifés , d’autant plus qu’au-
33 jourd’hui, foitque les hommes fupérieurs foient
33 rares, foir que les arts foient alfez avancés ,
33 pour qu’il foit difficile d’élever la tête au-deflus
33 des rangs ordinaires, votre ma/efté ne fera obli-
3» gée qu’à une très-petite dépenfe, pour ménager
33 à fon royaume tout l’éclat qu’il peut tirer de la
3» réunion des hommes célèbres, y»
MARAIS S A L A N S . On donne ce nom à des
lieux voifins de la mer qui font entourés de di~
gués j Sz clans lefquels on y fait entrer fes eaux ,
pour fabriquer du felj cette formation s’opère par
l ’évaporation des parties aqueufes , foit par l’action
du lo le il, fo.it par celle du vent & de la fé-
chereffe i de façon que le réfîdu de cette eau fur
le marais, devient du fel marin.
En Languedoc & en Provence , on appelle
falins , ce que l’on défigne par le nom de marais
falans dans les provinces fituées fur l’océan.
On conçoit aifément qu’aufli-tôt que le roi fe
fut réfervé le privilège exclufif de vendre le fel
en détail dans le Royaume, il devint néceffaire
d’affurer l’approvifionnement des greniers deftinés
à fournir à la confommation intérieure j c’eft dans
cette vue que l’ordonnance des gabelles du mois
de mai 1680, enjoint aux propriétaires des ma-
rais falans 3 ce de les entretenir & de les fauner
33 fuffifamment , pour que l’adjudicataire de la
33 ferme des gabelles puilfe y prendre chaque an-
33 née jufqu’à la concurrence de quinze mille muids
>3 de fe l, mefure de Paris. 33
Dans les mêmes vues , divers arrêts du confeil
©nt, en différens tems, accordé à cet adjudicataire
la préférence fur tout autre acheteur pour les Tels
néceffaires au fourniffemens des greniers, & quelquefois
ont fixé le prix auquel les fels feroient payés
aux propriétaires des 'marais falans.
D ’ un autre côte , l’intérêt de ces propriétaires
a été ménagé par la défenfe expreffe à cet adjudicataire
de faire venir des fels du pays étranger
pour fes approvifionnemens, fans en avoir obtenu
du roi une permiflion par écrit. On ne trouve
qu’un feul de ces adjudicataires qui ait demandé
& obtenu cette permiflion en 1590 , fous le règne
de Henri IV. Ses motifs furent bien moins la di-
fette de fel fur les marais falans 3 que les difficultés
qui lui furent faites par les propriétaires,
jaloux & fâchés de voir que le roi venoit de fe
réferver le droit d’approvifionner feul les greniers
du Royaume.
Comme les marais falans fe font beaucoup
multipliés depuis un fîècle, il n’eft pas à craindre
que le manque de fel force jamais l’adjudi-
cataires des gabelles à recourir aux étrangers pour
fes approvifionnemens. Lorfque les mauvais tems
ou des accidens ont altéré ou diminué la récolte
des fels, furies marais falans 3 de manière à laiffer
craindre qu’ils ne puiffent fournir à la fois, à la
confommation des greniers, à celle des. pays rédi-
més, & à celle de la pêche, le gouvernement
permet & aux armateurs pour la pêche & aux habitons
des pays exempts de gabelles , de faire
venir des fels d’Efpagne & de Portugal J ainfî
qu’il eft arrivé en 1708 & 1713.
D ’autrefois on défend momentanément l’exportation
des fels à l’étranger, & on permet l’in-
troduétion des fels d’Efpagne ou de Portugal,
pour être feulement employé à la pêche. Les
arrêts du confeil des 23 feptembre 17 70 , & c
novembre 1 7 7 4 , autorifèrent cet arrangement;
mais il ne fubfîfta qu’au tant que les circonftances
l’exigeoient. Voye^ au mot fournissement ,
tome fécond, pag. 261.
Les formalités prefcrites par l ’ordonnance de
1680, pour les chargemens de fel aux marais
Jaiaxu 3-font confignées dans l’art. 5 du titre des
droits fur le f e l , de l’ordonnance de 16&0. Il
porte : « Enjoignons aux maîtres des navires
33 barques & autres vaififeaux à leur arrivée aux
33 ports, havres & rades dans l’étendue de la
30 ferme , de donner dans les vingt-quatre heu-
” res , au commis du plus prochain bureau, une
33 déclaration fignéc d’eux , contenant leur pays
33 & demeure le nom & le port des vaifteaux
» & la quantité du fel qu’ils entendront charger
33 fur les marais falans , de prendre un congé du
33 déchargement, de le faire vifer au capitaine de
33 la patache établie pour la confervation de nos
33 droits , & de bailler bonne & fuffifante cau-
33 tion de les payer, le tout avant que de charger
« le fel'qu’ils auront acheté, à peine de confifca-
33 tion & de trois cens livres d’amende.
A r t i c l e V I .
33 Défendons aux propriétaires , des ma-
» rais falans , & à leurs prépofés, de délivrer Je
33 fel aux mefureurs, & aux mefureiirs de le me-
33 furer, aux chargeurs de le ver fer dans les bar-
33 ques , & aux maîtres des barques de le char-
3* ger dans les navires qu’entre deux foleils, de
« après qu’ il leur fera apparu du congé de chargeas
ment, vifé du capitaine de la patache , en-
33 femble du cautionnement qui aura été paflfé, à
33 peine de trois cent livres d’amende contre cha-
» cun des contrevenans. »3
Les articles 7 , 8 , 9 , 10 & 11 du même titre
, règlent tout ce qui a pour objet de prévenir
l’enlèvement des fels en fraude des droits, ou des
déclarations frauduleufes fur les quantités, quifont
chargées.
L ’arrêt du confeil Revêtu de lettres-patentes du
22 février 17 *9 , rappellé dans l’article 20 du bail
des fermes, fait à Jacques Forceville ; enjoint encore
aux maîtres de bâtimens & de barques qui
chargeront des fels pour Dunkerque, C alais ,
Boulogne & Etaples, de rapporter dans le port.de
deftination, dans le tems preferit, huit razières
de fel de deux cent cinquante liv. pefant, chacune
pour chaque muid qu’ils juftifieront avoir chargé
aux marais falans , à peine d’être condamnés ou
leurs.cautions à l’amende de quatre cens livres.
M A R C , f. m. C ’eft: le nom d’un poids dont
on fe fert en France & dans plufieurs Etats de
l’Europe, pour péfer diverfes fortes de marchandées
, & particulièrement l’or & l’argent.
François Garrault, ancien général des mon-
noies, d it, dans fes mémoires fur les poids &
mefures, imprimés en 159y , que la livre de feize
onces étoient connue du tems de Charlemagne,
& qu’elle portoit déjà le nom de poids de marc,
parce que c’étoit le poids dont fe fervoit les marchands
, & il ajoute que cet Empereur ordonna
que tous les autres poids fuflent réduits au poids
de marc.
D ’autres écrivains, penfent très-différemment ;
ils affurent au contraire, que jufqu’au règne de
Philippe Ier, on sfeft fervi en France de la livre
romaine, compofée de douze onces, plus foibles
d’ un neuvième que les onces du poids de marc.
Malgré ces contradictions , il paroît certain
que Charlemagne inftitua un poids particulier,
& que fous fon règne on fabriqua des deniers
d’argent qui pefoient vingt-huit grains forts ; &
comme la levée numéraire étoit alors compofée
,.de deux cent-quarante deniers , comme aujourd’hui
j il s’enfuit qu’en multipliant ces deux cent
quarante deniers par vingt - huit grains quatre
cinquièmes , le réfultat fera fix mille neuf cent
douze grains , qui, divifés par douze , nombre des
©nces de la livre de ce tems-là , donneront cinq
eent foixapte-feize grains par once, quantité égale
à celle que contiennent les onces de la livre poids
de marc'.
Quelques écrivains penfent que ce fut l’altération
du titre des efpèces qui fit quitter la livre de
douze onces , pour prendre le marc de huit onces,
parce qu’effeétivement une livre d’argent monnoyé
ne contenoit plus que huit onces d’argent fin.
Quoi qu’il en fo it, le marc dans la divifion la
plus ufitée, eft compofé de huit onces.
L ’once comprend huit gros.
Le gros, trois deniers.
Le denier, vingt-quatre grains.
Le marc, par conféquent 4608 grains.
En Efpagne, en Portugal, Je marc eft également
de huit onces & de 4608 grains.
Pour nous renfermer dans ce qui concerne le
marc en France , il convient d’abord de dire, que
c’eft le poids ufité pour péfer & évaluer les matières
d’or Hz d’argent. Par évaluer , on n’entend ,
pas leur valeur intrinfèque , qui eft toujours la
même j mais la fixation de leur valeur courante ,
en raifon de leur abondance ou de leur difette.
Ainfî , on conçoit que quoique une livre d’o r &
une livre d’argent fin ne fulfent pas d’ iine nature
différente, il y a fix ou fept Cens ans de ce qu’elles
font aujourd’hui ; cependant elles dévoient avoir
un prix plus confîdérable, par la raifon que ces
métaux étoient plus rares. On donnoit par conféquent,
pour un huitième de marc 3 ou une once,
pour une très petite portion de ces métaux!, une
fomme de denrées ou de travail, qu’aujourd’hui
on ne peut obtenir que pour le triple, le quintuple
ou le décuple de cette portion.
Ainfî, lorfqu’en 1307 , fous le règne de Philippe
- le - B e l, le marc d’argent valoit de cinquante
cinq fols à trois livres, les meilleurs charpentiers
& maçons gagnoient dix - huit deniers
par jour fans être nourris , & douze deniers
étant nourris ; les autres ouvriers du même genre
ne gagnoient que douze deniers, fans être nourris
, ou huit s’ils l’étoient.
Afin de mettre à portée de fuivre l’ augmentation
progreffive de la valeur du marc d’or &
d ’argent, on va donner ici un tableau des variations
qu’il a éprouvées à cet égard depuis le
douzième fiècle , jufqu’ en 1784 ; mais on prévient
que lorfque fous le même règne, il y a eu plufieurs
fixations différentes, on les a réunies en
une fomme, pour prendre la moyenne proportionnelle
, & on en fait mention.