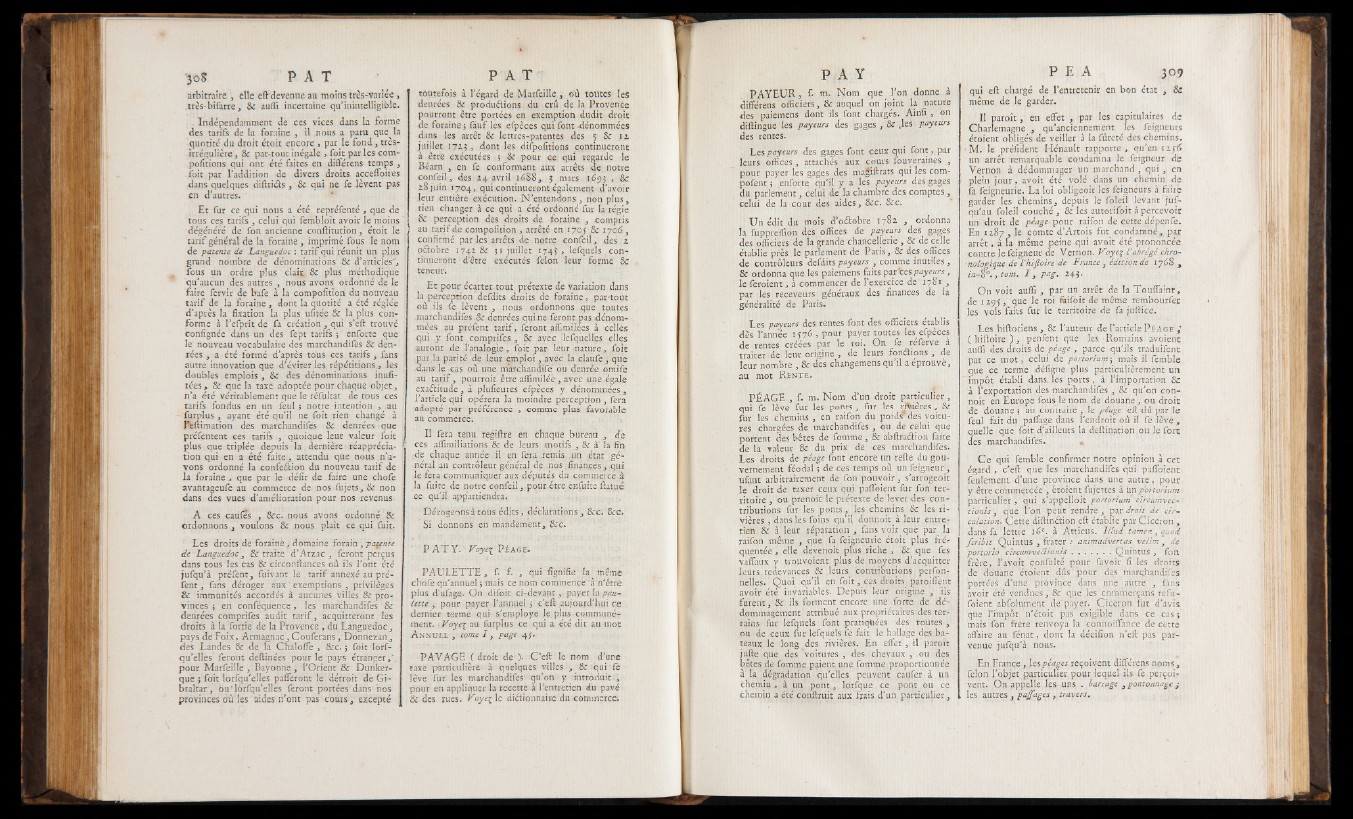
arbitraire , elle eflrdevenue an moins très-variée ,
;très-bifarre, & aufli incertaine qu’ inintelligible.
Indépendamment de ces vices dans la forme
des tarifs de la foraine , il nous a paru que la
quotité du droit étoit encore , par le fond , très-
irrégulière , & par-tout inégale * foit par les comportions
qui ont été faites en différens temps 3
foit par l’addition de divers droits accefioires
dans quelques diftritts 3 & qui ne fe lèvent pas
en d’autres.
Et fur ce qui nous a été repréfenté , que de
tous ces tarifs , celui qui fembloit avoir le moins
dégénéré de fon ancienne conftitution, étoit le
tarif général de la foraine 3 imprimé fous le nom
de -patente de Languedoc : tarif qui réunit un plus
grand nombre de dénominations & d’articles'',
fous un ordre plus clair; & plus méthodique
qu’aucun des autres , nous avons ordonné de le
faire fervir de bafe à la compofîtion du nouveau
tarif de la foraine , dont la quotité a été réglée
d’après la fixation la plus ufïtée & la plus conforme
à l’efprit de fa création, qui s’eft trouvé
confignée dans un des fept tarifs j enforte que
le nouveau vocabulaire des marchandifes & denrées
, a été formé d’après tous ces tarifs , fans
autre innovation que d’ éviter les répétitions., les
doubles emplois , 8c des dénominations inufî-
té e s , & que la taxe adoptée pour chaque objet,
n’a été véritablement que le réfultat de tous ces
tarifs fondus en un feul j notre intention , au
furplus , ayant été qu’il ne foit rien changé à
Intimation des marchandifes 8c denrées que
préfentent- ces tarifs , quoique leur valeur foit
plus que triplée depuis la , dernière : réappréciation
qui en a été faite, attendu que nous n’a- i
vons ordonné la confection du nouveau tarif de
la foraine, que par le défir de faire une chofe
avantageufe au commerce de nos fujets, 8c non
dans des vues d’amélioration pour nos revenus.
A ces caules , &c., nous avons ordonné &
ordonnons, voulons & nous plaît ce.qui fuit.
Les droits de foraine, domaine forain, patente
de Languedoc, & traite d’Arzac , feront perçus
dans tous les cas 8c circonstances où ils l’ont été
jufqu’ à préfent, fuïvant le tarif annexé au pré-
fen t, fans déroger aux exemptions, privilèges
8c immunités accordés à aucunes villes & provinces
3 en conféquence , les marchandifes 8c
denrées comprifes audit ta r if, acquitteront les
droits à la fortie de la Provence , du Languedoc,
pays de Foix, Armagnac, Couferans, Donnezan,
des Landes 8c de la Chaloffe , 8cc. 5 foit lorf-
qu’elles feront deftinées pour le pays étranger,',
pour Marfeille , Bayonne, l’Orient & Dunkerque
j foit lorfqu’elles pafleront le détroit de Gi~ j
braltar , bu'lorfqu’elles feront portées dans nos ;
provinces où les aides n’ont pas cours, excepté j
toutefois à l’égard de Marfeille , où toutes les
denrées 8c productions du crû de la Provence
pourront être portées en exemption dudit droit
de foraine j fauf les efpèces qui font -dénommées
dans les arrêt & lettres-patentes des 5 8c 12
juillet 1723 , dont les difpofîtions continueront
à être exécutées 5 & pour Ge qui regarde le
Béarn , en fe conformant aux arrêts de notre
confeil, des 24 avril .1688, 3 mars 1.693 > 8c
28 juin 1704, qui continueront également d’avoir
leur entière exécution. N ’entendons, non plus,
rien changer à ce qui a été ordbnné fur la régie
& perception des droits de foraine , compris
j au tarif de compofîtion , arrêté en 17 0 5 ,8c 1706 3
confirmé par les arrêts de notre confeil, des 2
pCtobre 1742 & 31 juillet 174^, lefquels, continueront
d’être exécutés félon leur forme 8c
teneur.
Et pour écarter tout prétexte de variation dans
la perception defdits droits de foraine, par-tout
où ils fe lèvent , nous ordonnons que toutes
marchandifes 8c denrées quine feront pas dénommées
au préfent tarif, feront aflimilees à celles
qui y font comprifes , 8c avec lefquelles elles
auront de l’analogie, foit par leur mature, foit
par la parité de leur emploi, avec la claufe, que
dans* le cas où une marçhandife ou denrée omife
au ta r if, pourroit être aflimilée, avec une. égale
exaCiitude, à plufîeures efpèces y dénommées,
l’article qui opérera la moindre perception, fera
adopté par préférence , comme plus favorable
au commerce.
Il fera tenu regiftre en chaque bureau ., de
ces aflimiliations 8c de leurs motifs , & à'la-fin
:de chaque année il en fera remis un .état général
au contrôleur général de nos. financés , qui
le fera communiquer aux députés du commerce à
la fuite de notre confeil, ,pour être. ensuite, ftatué
ce qu’il appartiendra.
Dérogeons à tous édits, déclarations , 8cc. 8cc.
Si donnons en mandement,
P A T Y . x Voyei Péage.
P A U L E T T E , f. f. , qui fîgnifie la même
chofe qu’annuel 3 mais ce nom commerice 'à n’êtré
plus d’ufage.' On difoit ci-devant, payer la pau-
lette 3 pour payer l’annuel 5 c’eft-aujourd’hui ce
dernier terme qui s’employe le plus communément.
' Vôye^ au furplus ce qui a été dit au mot
A nnuel , tome I , page 45.
P A V A G E C droit de j f C ’eft le nom d’une
taxe particulière à quelques villes , & ?qui fè
lève fur les marchandifes qu’on y introduit.,
pour en appliquer-la recette, à l’entretien du pavé
& des rues. Foyei le dictionnaire du commerce;
P A Y E U R , f m. Nom que l’on donne à
différens officiers, 8c auquel on joint la nature
des paiemens dont ils font chargés. Ainfi , on
diftingue les payeurs des gages, 8c Jes payeurs
des rentes.
Les payeurs des gages font ceux qui font , par
leurs offices, attachés;aux cours fouveraines ,
pour payer les gages des mafiftrats qui les com-
pofent 3 enforte qu’ il y a les payeurs des gages
du parlement, celui de la chambre des comptes,
celui de la cour des aides, 8cc. 8cc.
Un édit du mois d’oCtobre 1782. , ordonna
la fuppreffion des offices de payeurs des gages
des officiers de la grande chancellerie , & de celle
établie près le parlement de Paris, & des offices
de contrôleurs defdits payeurs , comme inutiles,
& ordonna que les paiemens faits partes payeurs,
le feraient, à commencer de l’exercice de' 1781 ,
par -les receveurs généraux des finances de la
généralité de Paris.
Les payeurs des rentes font des officiers établis
dès l’année ty jf lÿ pour payer toutes les efpèces
de rentes créées par le roi. On fe referve a
traiter de leur origine , de leurs fond ions, de
leur nombre , & des changement qu’il a éprouvé,
au mot Rente.
PÉAG E , f m. Nom d’ un droit particulier,
qui fe lève fur les ponts, fur les r&ières , &
fur les chemins , en raifon du poids* des voitures
chargées de marchandifes , ou de celui que
portent des bêtes de fomme, 8c abftra&ion faite
de la valeur 8c du prix de ces marchandifes.
Les droits de péage font encore un refte du gouvernement
féodal 3 de ces temps où un feigneur,
ufant arbitrairement de fon pouvoir, s’arrogeoit
le droit de taxer ceux qui paflbient fur fon territoire
, ou prenoitle prétexte de lever des contributions
fur les ponts, les chemins -8c les rivières
, dans les foins qu’il donnoit à leur entrer
tien 8c à leur réparation , fans voir que par la
raifon même , que fa feigneurie étoit plus fréquentée
, elle devenoit plus riche , 8c que fes
vaffaux y tro.uvqient plus de moyens d’acquitter
leurs, redevances ,& .leurs contributions perfon-
helles. Quoi qu’il en fo it, ces droits paroilfent
avoir été invariables. Depuis leur origine , ils
furent ,'8c ils forment encore une forte de dédommagement
attribué aux propriétaires des terrains
fur lefquels font pratiquées des routes ,
ou de ceux fur lefquels fe fait le hallage des bateaux
le long des rivières. En effet, il paraît
jufte que des 'voitures , des chevaux , ,ou des
bêtes de fomme paient une. fomme proportionnée
à’ la dégradation qu’ elles, peuvent ca.ufer à un
chemin, à un pont , lorfque ce pont ou ce
chemin a été confirait aux frais d’un particulier,
qui eft chargé de l’entretenir en bon état , 8c
même de Je garder.
Il paraît, en effet , par les capitulaires de
Charlemagne , qii’anciennement les feigneurs
étoient obligés de veiller a la fûreté des chemins.
■ M. le préfident Hénault rapporte , qu’en 1256
un arrêt remarquable condamna le feigneur de
Vernon à dédommager un marchand, q u i, en
plein jou r , avoit été volé dans un chemin de
fa feigneurie. La loi obligeoit les feigneurs à faire
garder les chemins, depuis le foleil levant juf-
qu’au foleil couché, & les autorifoit à percevoir
un droit de péage- pour raifon de cette dépenfe.
En 1287 s Ie comte d’Artois fut condamné, par
arrêt, à la même peine qui avoit été prononcée
contre le feigneur de Vernon. Voyeç Vabrégé chronologique
de L‘hiflaire de France , édition de 1768
in-86. , tom. 7 , pag. 243.
On voit aufli , par un arrêt de la Touffaint,
de 1295 3 que le roi faifoit de même rembourfer
les vols faits fur le territoire de fa jufiiee.
Les hiftoriens , 8c l ’auteur de l’article P éage
( hiftoire ) , penfent que les Romains avoient
aufli des droits de péage , parce qu’ils traduifent
par ce mot, celui de portorium3 mais il fcmble
que ce terme défîgne plus particulièrement un
impôt établi dans, les ports , à l’importation &
à l’exportation des marchandifes , 8c qu’on con-
noît en Europe fous le nom de douane , ou droit
de douane 5 au contraire, le péage eft dû par le
feul fait du paflage dans l’endroit où il fe lè ve ,
quelle que foit d’ ailleurs là deftination ou je fort
des marchandifes. „
C e qui femble confirmer notre opinion à cet
égard , c’ eft que les marchandifes qui paflbient
feulement d’une province dans une autre, pour
y être commercée , étoient fujettes à Un p'ortorium.
particulier , qui s’appelloit portorium circùmvec-
tionis, que Ton peut rendre , par droit de circulation.
Cette diftinétion eft établie par Cicéron ,
dans fa lettre 16®. à Atticus. Illud tamen 3 quod
feribit Quintus , frater : animadvertas velim 3 de
portoriô cir-cumvectio ni s . . . . . . . Quintus , fon
frère, l’avoit çonfulté pour favoir fi les droits
de douane étoient dûs pour dqs marchandifes
portées d’une province dans une autre , fans
avoir été vendues, 8c que les corpmerçans refu-
foient abfplument de'payer. Cicéron fut d’avis
que l’impôt n’étoit pas exigible dans ce cas 3
mais Ton frere renvoya la connoiffance de cette
affaire au fénat, dont la décifion n’ert pas parvenue
jufqu’à nous.
En France 3 lespéages reçoivent différens noms,
félon l’objet particulier pour lequel ils fe perçoivent.
On appelle les-uns . barrage , pontonnage
les autres , pajfages , travers.