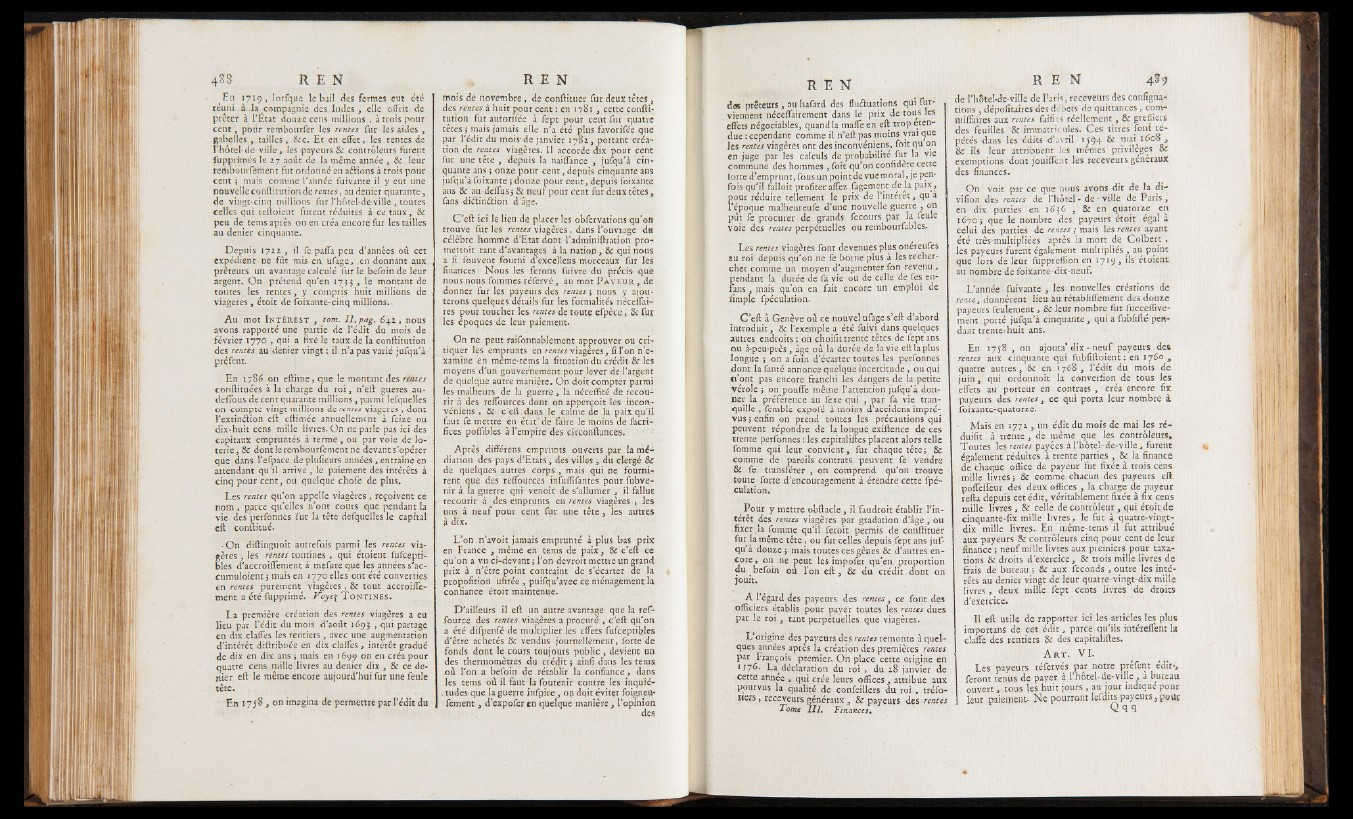
4SS R E N
En 1 7 19 , lorfqué le bail des fermes eut été
réuni à la ^compagnie des Indes, elle offrit de
prêter à l'Etat douze cens millions , à trois pour
cen t, pour rembourfer les rentes fur les aides ,
gabelles, tailles, & c . Et en effet, les rentes de
l'hôtel- de v ille, les payeurs & contrôleurs furent
fupprimés le 27 août de la même année , & leur
reriibourfement fut ordonné en allions à trois pour
cent ; mais comme l'année fuivante il y eut une
nouvelle conflitution de rentes} au denier quarante,
de vingt-cinq millions fur l'hotel-deville, toutes
celles qui reftoient furent réduites à ce taux, &
peu de tems après on en créa encore fur les tailles
au denier cinquante.
Depuis 1722 , il fe pafTa peu d'années où cet
expédient ne fût mis e a ufage, en donnant aux
prêteurs un avantage calculé fur ie befoin de leur
argent. On prétend qu'en 17 5 3 , le montant de
toutes les rentes, y compris huit millions de
viagères, étoit de foixante-cinq millions^
Au mot In tér e st , tom. Il.pag. 642, nous
avons, rapporté une partie de l’édit du mois de
février 1770 , qui a fixé le taux-de la conflitution
des rentés au denier vingt : il n'a pas varié jufqu'à
préfent.
En 1786 on eftime, que le montant des rentes
conftituées à la charge du r o i, n’eft gueres au-
deffous de cent quarante millions, parmi lefquelles
on compte vingt millions de rentes viagères , dont
l’extinétion eft eftimée annuellement à feize ou
dix-huit cens mille livres. On ne parle pas ici des
capitaux empruntés à terme , ou par voie de loterie,
& dontlerembourfement ne devant s'opérer
que dans l'efpace de plusieurs années , entraîne en
attendant qu'il arrive, le paiement des intérêts à
cinq pour cent, ou quelque chofe de plus.
Les rentes qu’on appelle viagères, reçoivent ce
nom 3 parce qu'elles n’ont cours que pendant la
vie des "perfonnes fur la tête defquelles le capital
eft conftitué.
-O n diftinguoit autrefois parmi les rentes v iagères
, les rentes tontines , qui étoient fufcepti-
bles d’aecroiffement à mefureque les années s'ac-
cumuloient 5 mais en 1770 elles ont été converties
en rentes purement v iag è re s , & tou t accroiffe-
ment a été fupprimé. Voye% T o n t in e s .
La première création des rentes viagères a eu
lieu par l'édit du mois d’août 1693 , qui partage
en dix claffes les rentiers, avec une augmentation
d'intérêt diftribuee en dix claffes , intérêt gradué
de dix en dix ans 5 mais en 1699 on en créa pour
quatre cens mille’livres au denier dix , & ce denier
eft le même encore aujourd’hui fur une feule
tête.
En 1758 , on imagina de permettre par l’édit du
R E N
mois de novembre, de conftituer fur deux têtes,
des rentes à huit pour cent : en 1781 , cette confti-
tution fut autorifée à fept pour cent fur quatre
têtes} mais jamais elle n'a été plus favorifée que
par l'édit du mois-de janvier 1782, portant création
de rentes viagères. 11 accorde dix pour cent
fur une tête , depuis la naiffance , jufqu'à cinquante
ans ; onze pour cent, depuis cinquante ans
jufqu'à foixante 5 douze pour cent, depuis foixante
ans & au-deffusj & neuf pour cent fur deux têtes >
fans diélinélion d'âge.
C ’eft ici le lieu de placer les obfervations qu’on
trouve fur les rentes viagères , dans l’ouvrage du
célèbre homme d'Etat dont l'administration pro-.
mettoit tant d’avantages à la nation, & qui nous
a fi fouvent fourni d'excellens morceaux fur les
finances Nous les ferons fuivre du précis* que
nous nous fommes réfervé, au mot Payeur, de
donner fur les payeurs des rentes \ nous, y ajouterons
quelques détails fur les formalités néceffai-
res pour toucher les rentes de toute efpèce, & fut
les époques de leur paiement.
On ne peut raifonnablement approuver ou cri-r
tiquer les emprunts èn rentes viagères, fi l’on n’e-?
xamine en meme-tems la Situation du crédit & les
moyens d'un gouvernement pour lever de l’argent
de quelque autre manière. On doit compter parmi
les malheurs de la guerre , la néceffité de recourir
à des reffources dont on apperçoit les incon-
véniens , &• c’eft dans le calme de la paix qu'il
faut fe mettre en état'de faire le moins de facri-
fices poffibles à l’empire des circonftances.
Après différens emprunts ouverts par la médiation
des pays d'Etats, des villes, du clergé &
de quelques autres corps, mais qui ne fournirent
que des reffources infuffifantes pour fubve-
nir à la guerre qni venoit de s'allumer , il fallut
recourir à des emprunts en rentes viagères , les
uns à neuf pour cent fur une tête, les autres
à dix.
L’on n’avoit jamais emprunté à plus bas prix
en France , même en tems de paix, & c’eft ce
qu'on a vu ci-devant 5 l'on devroit mettre un grand
prix à n'être point contraint de s'écarter de la
propofition ufitée, puifqu'ayec ce ménagement la
confiance étoit maintenue.
D’ailleürs il eft un autre avantage que la ref'-
fource des rentes viagères a procuré , c'eft qu’on
a été difpenfé de multiplier les effets fufceptibles
d'être achetés & vendus journellement, forte de
fonds dont le cours toujours public, devient un
des thermomètres du prédit 5 ainfi dans les tems.
où l'on a befoin de rétablir la confiance » dans
les tems où il faut'la foutenir contre les inquié-
, tudes que la guerre infpire , on doit éviter foigneu-
fement , d’expofer en quelque manière, l’opinion
R E N
des prêteurs, au hafard des fluctuations qui fur-
viennènt néceffairement dans le prix de tous les
effets négociables, quand la maffe en eft trop étendue
: cependant comme il n’eft pas moins vrai que
les rentes viagères ont des inconvéniens, foit qu on
en juge par les calculs de probabilité fur la vie
commune des hommes , foit qu’on confidere cette
iorte d’emprunt, fous un point de vue moral, je pen-
fois qu’il ralloit profiter affez fagement déjà paix*
pour réduire tellement le prix de l'intérêt, qu a
l ’époque malheureufe d’une nouvelle guerre , on
pût fe procurer de grands fecours par la feule
voie des rentes perpétuelles ou rembourfables.
Les rentes viagères font devenues plus onereufes
au roi depuis qu’on ne fe borne plus à les rechercher
comme un moyen d’augmenter fon revenu ,
pendant la durée de fà vie ou de celle de fes en-
fans , mais qu’on en fait encore un emploi de
fimplc fpéculation.
C ’eft à Genève où ce nouvel ufage s’ eft d’abord
introduit, & l’exemple a été fuivi dans quelques
autres endroits : on choifit trente têtes de fept ans
ou à-peu-près , âge où la durée de la vie eft la plus
longue 5 on a foin d'écarter toutes les perfonnes
dont la fanté annonce quelque incertitude , ou qui
n’ont pas encore franchi les dangers de la petite
vérole 5 on pouffe même l’ attention jufqu’ à donner
la préférence au fexe qui , par fa vie tranquille
, femble expofé à moins d'accidens imprévus
y enfin on prend toutes les précautions qui
peuvent répondre de la longue exiftence de ces
trente perfonnes : les capitalises placent alors telle
fomme qui leur convient, fur chaque tête} &
comme de pareils contrats peuvent fe vendre
& fe transférer , on comprend qu’on trouve
toute forte d’encouragement à étendre cette fpéculation.
jji Pour y mettre obftacle, il faudroit établir l’intérêt
des rentes viagères par gradation d’âge , ou
fixer fomme qu'il feroit permis de conftituer
fur la même tête, ou fur celles depuis fept ans juf-
qu à douze ; mais toutes ces gênes & d'autres encore
, on ne peut les impofer qu’en proportion
du befoin où l’on eft , & du crédit dont on
jouit.
A l’égard des payeurs des rentes, ce font des
officiers établis pour payer toutes les rentes dues
par le roi , tant perpétuelles que viagères.
L ’origine des payeurs des rentes remonte à quelques
années après la création des premières rentes
par François premier. On place cette origine en
*576- La déclaration du roi , du 28 janvier de
cette année , qui crée leurs offices , attribue aux
pourvus la qualité de confeillers du roi « tréfo-
ners , receveurs généraux, & payeurs des rentes
Tome III, Finances•
R E N
de l’hôtel-de-ville de Paris, receveurs des configna-
tions , dépofitaires des débets de quittancés , com-
miffaires aux rentes faifies réellement, & greffiers
des feuilles & immatricules. Ces titres font répétés
dans les édits d’avril 1Ç94 & m a i1608 ,
& ils leur attribuent les memes privilèges &
exemptions dont jouiffent les receveurs généraux
des financés.
On voit par ce que nous avons dit de la di-
vifion des rentes de l'hôtel - de - ville de Paris,
en dix parties en 1636 , & en quatorze en
16705 que le nombre -des payeurs étoit égal à
celui des parties de rentes ; mais les rentes ayant
été très-multipliées après la mort de C o lb e r t ,
les payeurs furent également multipliés , au point
que lors de leur fuppieflion en 17 19 , étoient
au nombre de foixante-dix-neuf.
L'année fuivante , les nouvelles créations de
rente, donnèrent lieu àu rétabliffement des douze
payeurs feulement, 8c leur nombre fut fucceflive-
ment porté jufqu’à cinquante, qui a fubfifté pendant
trente-huit ans.
En 1758 , on ajouta* dix - neuf payeurs des
rentes aux cinquante qui fubfiftoient : en 1760 ,
quatre autres, & en 1768 , l'édit du mois de
juin, qui ordonnoit la converfion de tous les
effets au porteur en contrats , créa encore fix
payeurs des rentes, ce qui porta leur nombre à Soixante-quatorze.
• Mais en 1 7 7 1 , un édit du mois de mai les rc-
duifit à trente, de même que les contrôleurs,
Toutes les rentes payées à l'hôtel-de-ville, furent
également réduites à trente parties , & la finance
de chaque office de payeur fut fixée à trois cens
mille livres 3 & comme chacun des payeurs eft
poffeffeur des deux offices , la charge de payeur
relia depuis cet édit, véritablement fixée à fix cens
mille livres , & celle de contrôleur , qui étoit de
cinquante-fix mille livres, le fut 4. quatre-vingt-
dix mille livres. En même-tems il fut attribué
aux payeurs & contrôleurs cinq pour cent de leur
finance 5 neuf mille livres aux premiers pour taxations
& droits d'exercice, & trois mille livres de
frais de bureau ; & aux féconds , outre les intérêts
au denier vingt de leur quatre-vingt-dix mille
livres, deux mille fept cents livres de droits
d'exercice.
Il eft utile de rapporter ici les articles les plus
importans de cet é d it , parce qu’ ilsintéreffentla
claffe des rentiers & des capitaliftes.
A r t . VI*
Les payeurs réfervés par notre préfent édit*,
feront tenus de payer à l'hôtel-de-ville, à bureau
ouvert, tous les huit jours , au jour indiqué pour
leur paiement. N e pourront lefdits payeurs, pour
Q q q