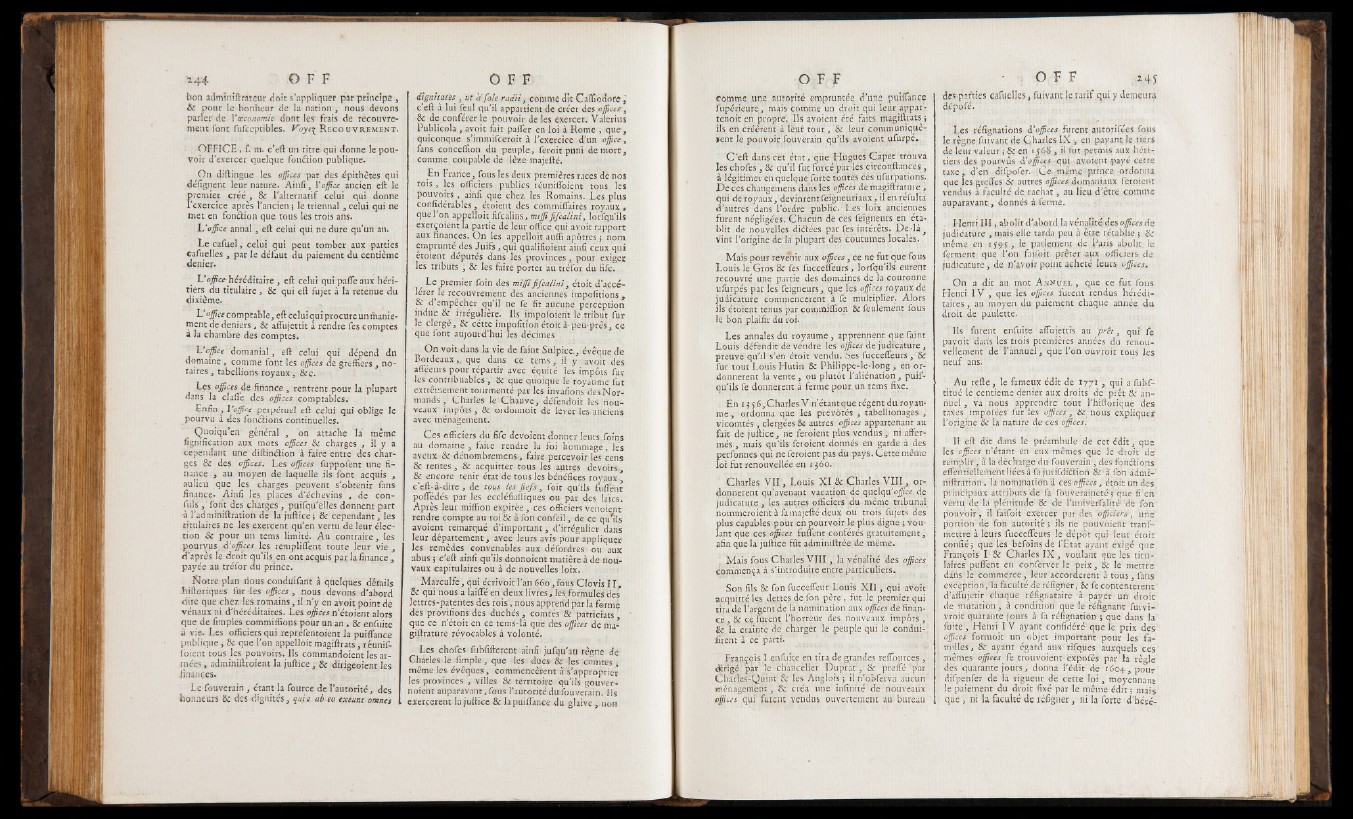
bon adminîftrateur doit s’appliquer par principe ,
& pour le bonheur de la nation , nous devons
parler de Yoeconomie dont les- frais de recouvrement
font fufccptibles. Voye^ R e c ou v rem en t.
OFFICE » f. fît c’eft un titre qui donne le pouvoir
d’exercer quelque fonction publique.
On diftingue les offices par des épithètes qui
délïgnent leur nature. Ainfî, Yoffice ancien eft le
premier créé , & l’alternatif celui qui donne
l ’exercice après l’ancien ; le triennal , celui qui ne
met en fonction que tous les trois ans.
L ’office annal , eft celui qui ne dure qu’un an.
Le cafuel, celui qui peut tomber aux -parties
cafuelles 3 par le défaut du paiement du centième
denier.
L ’oj^ce-héréditaire 3 eft celui qui pafîe aux héritiers^
» & qui eft fujet à îa retenue du
dixième..
I f office comptable, eft celui qui procure un maniement
de deniers, & aflujettit à rendre fes comptes
a la chambre des comptes.
L office domanial, eft celui qui dépend du
domaine , comme font les offices de greffiers , notaires,
tabellions royaux, &c.
Les offices de finance, rentrent pour la plupart
dans la claffe des offices comptables.
Enfin , l ’office perpétuel eft celui qui oblige le
pourvu à des fonctions continuelles.
Quoiqu’en général , on attache la même
fignification aux mots offices & charges , il y a
cependant une diftinélion à faire entre des charges
8c des offices. Les offices fuppofent une finance
, au moyen de laquelle ils font acquis ,
aulieu que les charges peuvent s’obtenir fans
finance. Ainfî les places d’échevins , de con-
fùls , font des charges , puifqu’elles donnent part
à l’adminiftration de la juftice s & cependant, les
titulaires ne les exercent qu’ en vertu de leur élection
& pour un tems limité. Au contraire, les
pourvus^ d’offices les remplirent toute leur vie ,
d’après le droit qu’ils en ont acquis par la finance ,
payée au tréfor du prince.
Notre plan nous conduifant à quelques détails
hiftoriques fur les offices , nous devons d’abord
dire que chez les romains, il n’y en avoit point de
vénaux ni d’héréditaires. Les offices n’étoient alors
que de fimples commiffions pour un an, & enfuite
à vie. Les officiers qui repréfentoient la puiffance
publique, 8c que l’on appelloit magiftrats, réunif-
l'oient tous les pouvoirs. Ils commandoient les armées,
adminiftroient la juftice j 8c dirigeoient les
finances.
Le fouverain , étant la fource de l’autorité, des
honneurs 8c des dignités, quia ab eo exeunt omnes
dignitates , ut a foie radii , comme dît Caflîodore ,
c’ eft à lui feul qu’il appartient de créer des offices',
& de conférer le pouvoir de les exercer. Valerius
Publicola , avoit fait pafifer en loi à Rome , q ue,
quiconque s’immifeeroit à l’exercice d’un office,
fans conceffion du peuple, ferait puni de mort,
comme coupable de lèze majefté,
En France, fous les deux premières races de nos
rois , les officiers publics réuniffoient tous les
pouvoirs , ainfî que chez les Romains. Les plus
confîdérables, étoient des commiffaires royaux ,
que l’on appelloit fifealins, miffi fifealini, Iorfqu’ils
exerçoient îa partie de leur office qui avoit rapport
aux finances. On les appelloit auffi apôtres } nom
emprunté des Juifs, qui qualifioient ainfî ceux qui
etoient députés dans les provinces, pour exigée
les tributs 3 & les faire porter au tréfor du fife.
t Le premier foin des miffi fifealini, étoit d’açcé-
lerer le recouvrement des anciennes impofîtions,
& d’empêcher qu’il ne fe fît aucune perception
indue 8c irrégulière. Ils impofoient le tribut fur
le clergé, & cë.tte impofition étoit à-peu-près, ce
que font aujourd’hui les décimes
On voit dans la vie de faint Sulprce,,. évêque de
B o rd e au xq u e dans ce tems, il y avoit des
afîeeurs pour répartir avec équité les impôts fur
les contribuables , & que quoique le royaume fut
extrêmement tourmenté par les invafions desNor-
mands,: Charles le 'C hau ve, défendoii les nouveaux
impôts, & ordonnoit de lever les anciens
avec ménagement.
Ces officiers du fîfc dévoient donner leurs,foins
au domaine , faire rendre la foi hommage, les
aveux 8c dénombremens, faire percevoir les cens
8c rentes, & acquitter tous lés autres devoirs^,
& encore tenir état de tous les bénéfices royaux,
c ’eft-à-dire, de tous les fiefs, foit qu’ils fuffént
poffédés par les eccléfiaftiques. ou par des laïcs.
Après leur miffion expirée, ces officiers venoient
rendre compte au roi 8c à fon confeil, de ce qiuls
avoient remarqué d’important, d’irrégulier dans
leur département, avec leurs avis pour appliquer
les remèdes convenables aux défordres ou aux
abus j c’eft ainfî qu’ils donnoient matière à de nou-
vaux capitulaires ou à de nouvelles loix,
Marculfe, qui écrivoit l'an 660, fous Clovis I I ,
& qui nous a laiffé en deux livres, les;formules des
lettres-patentes des rois, nous apprend parla forme
des provifîons des duchés , comtés & patriciats
que ce n’étoit en ce tems-là que des offices de ma*
giftrature révocables à volonté.
Les chofes fubfifterent ainfî jufqu’au règne de
Charles le fîmple, que les.ducs & les comtes^
même les évêques, commencèrent à:’s’approprier
les provinces , villes & territoire qu’ils gouver-
noient auparavant, fous l’autorité du fouverain. Ils
exerçerent la juftice 8c la puiffance du glaive , non
comme un,ç autorité empruntés d’une puiffance
fupérieure, mais-comme un droit qui leur appar*
tenoit en propre. Ils avoient été faits magiftrats j
ils en créèrent à leur tour, & leur communiquè-
ïent le pouvoir fouverain qu’ils.avoient ufurpé..
C ’eft dans cét état, q.iie Hugues Gapet trouva
les Chofes ", 8c qu’il fut forcé par les ciréonftancès,
à légitimer en quelque forte toutes ces ufurpations.
De ces changemens dans les offices demagiftraturé,
qui de royaux, devinrentfeigneuriaux, ilèn réfultai
d’autres dans l’ordre public. Les loix anciennes
furent négligées. Chacun de ces feigneurs en établit.
de nouvelles diétées par fes intérêts. pe-là^
vint l’origine de la plupart des coutumes locales.
Mais pour revenir aux offices, ce ne fut que fous
Louis le Gros 8c fes fucceffeurs, lorfqu’ils eurent
recouvré une partie des domaines de la couronne
ufurpés par les feigneurs , que les offices royaux de
judicature commencèrent à fe multiplier. Alors
ils étoient tenus par commiffion 8c feulement fous
le bon plaifîr du roi.
Les annales du royaume , apprennent que faint
Louis défendit de vendre les offices de judicature ,
preuve qu’il s’en étoit vendu. Ses fucceffeurs, 8c
fur tout Louis Hutin 8c Philippe-le-long , en ordonnèrent
la vente, ou plutôt l’aliénation, puif-
qu’ils fe donnèrent.à ferme pour, un tems fixe.
En 13 $63 Charles V:n’étant que régent dnroyau-
me, ordonna que les prévôtés , tabellionages ,
vicomtés, clergées & autres offices appartenant au
fait de juftice, ne feroient plus vendus,» ni affermés,
mais qu'ils feroient donnés en garde à des
perfonnes qui ne feroient pas du pays. Cette même
loi fut renouvellée en 1360..
Charles VII , Louis XL8c-CharIes V I I I , ordonnèrent
qu’avenant vacation de quelqu’o j^ de
judicature, les autres officiers du même tribunal
nommeraient à famajefté deux ou trois fujets des
plus capables polir en pourvoir le plus digne j voulant
que ces offices fuirent conférés gratuitement,
afin que la juftice fût adminiftrée de même.
Mais fous Charles V I I I , la vénalité des offices
commença à s’introduire entre particuliers.
Son fils & fon fucCeffeur Louis X I I , qui avoit
acquitté les dettes de fon père , fut le premier qui
tirade l'argent'de la nomination aux offices de finance
, & ce furent l’horreur des nouveaux impôts ,
& la crainte dé charger le peuple qui le condui-
firent à ce parti.
François I .çnfuite en tira.de grandes reffoprees ,
dirigé, par''Te chancelier Du p r i t , & preffé par
Charles-Quint 2c les Angloîs j il n’obferva aucun
ménagement , & créa une infinité de nouveaux
offices qui furent vendus ouvertement au bureau
deï parties cafuelles, fuivant le.tarif .qtii y demeura
dépofé.
Les réfîgnations d’offices furent autorifées fous
le règne fui vant de Charles IX en payant je tiers
de leur valeur ; & en 15^8 , i-lfut- petipis' aux héritiers
des pourvus d’office f qui avoient payé cette
taxe, d’en difpofer. iÇe même-prince ordonna
que les greffes 6c autres offices?domaniaux feroient
vendus à faculté de rachat, au lieu d’être comme
auparavant, donnés à ferme.
Henri I I I , abolit d’abord la vénalité des offices de
judicature , mais elle tarda peu à être rétablie ; 2c
même et? i f y s , le parlement de-Paris abolit le
ferment que l’on fai foit prêter apx officiers de
judicature, de n’àvoir point acheté leurs, offices.
On a dit au mot A n n u e l , que ce fut fous
Henri IV , que les offices furent rendus héréditaires
, au moyen du paiement chaque année du
droit de paulette.
Us furent enfuite afïujettis, au prêt, qui fe
payoit dahs les trois premières années du renouvellement
de l’annuel, que l’on ouvroit tous les
neuf ans.
Au refte, le fameux édit de 1 7 7 1 , qui a fubf-
titué le centième denier aux droits de prêt 8c annuel
, va nous apprendre tout l’hiftorique des
taxes impoféçs fur les offices'3 & nous expliquer
l’origine & la nature de ces offices.
Il eft dit dans le préambule de cet éd it, que
les offices n’étant en eux mêmes que le droir de
remplit, à la décharge du; fouverain , des:fonélions
e'ffentiellement liées à fa jürifdféHoii 8c à’ fon âdmi-
niftràtion, la nomination à ces offices, 'étoit un des.
principaux attributs de fa fouveraineté-î que fi era
vertu de la plénitude & de l’univerfalité de fon
pouvoir, il faifoit exèreèr par des officiers, une
portion de fon autorité j ils ne pouvoient transmettre
à leurs fucceffeurs le dépôt qui leur étoit
confié} que les befoins de l’Etat ayant exigé que
François I 8c Charles I X , voulant que les titulaires
pufïent en conferver le prix, 8c le mettre
dans le commerce, leur accordèrent à tous, fans
exception,' là faculté de réfîgner, 5c fe contentèrent
d’aflujetir chaque réfignataire à payer un droit
de mutation, à condition que le réfîgnant furvi-
vroit quarante jours à fa réfîgnation 5 que dans la
fuite, Henri IV ayant confidéré que le prix des
offices formoit un objet important pour les fa-
milles, 8c ayant égard aux rifaties auxquels ces
mêmes offices fe trouvoient expofés par la règle
des quarante jours, donna l’édit de 1604, pour
difpenfer de la rigueur de cette lo i , moyennant
le paiement du droit fixé par le même édit ; mars
que , ni la faculté de iéfîgner , ni la forte d’héré